
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
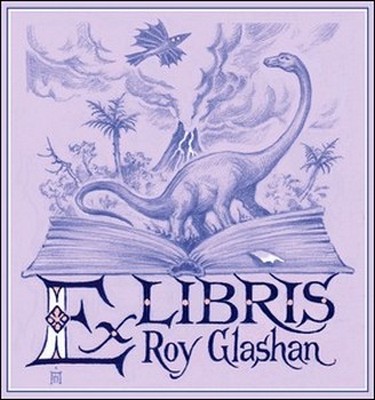

Le corps du Señor Pedro Blas fut jeté
en pâture au troupeau des alligators.

On eût dit un oiseau planeur. Déjà il fendait
l'air après nous avoir frôlés. (Page 582.)

Un journaliste français, reporter au service du grand quotidien l'An 2000, suit et raconte les péripéties de la Guerre Infernale qui met aux prises, d'une part, l'Angleterre, la France, le Japon alliés, avec, d'autre part, l'Allemagne unie à l'Amérique. Après des aventures angoissantes sur terre, dans les airs et jusqu'au fond des mers, le narrateur, prisonnier des Américains, parvient à s'évader sur un navire, le Krakatoa, qu'ont affrété de braves Hollandais pour rechercher le fiancé de leur fille, Miss Ada. Ce fiancé, Tom Davis, est un officier d'état-major anglais chargé d'une mission si mystérieuse qu'il a soudain disparu.
Le Krakatoa dépiste la vigilance de l'escadre américaine qui surveille les abords de Key-West et conduit enfin ses passagers dans la rade de Nassau (îles anglaises de Bahama), où, à leur grande joie, ils retrouvent Tom Davis. Hélas! Cette joie est de courte durée: l'amiral de la flotte japonaise, qui vient rejoindre à Nassau sept croiseurs anglais pour essayer de forcer avec eux les passes de la Floride, exige le départ immédiat de tout bâtiment étranger.
Le Krakatoa est forcé de repartir pour l'Europe, emmenant Miss Ada et sa famille. Mais le correspondant de l'An 2000, doublé de son collaborateur Pigeon, reste avec Tom Davis, dont la mission consiste à décider les nations blanches à renoncer à leur lutte fratricide pour se liguer contre l'invasion jaune. Ils assistent à la lutte gigantesque entre le savant américain Erickson, maréchal des Forces Electriques, et les Japonais sournois qui, d'abord mis à mal par la science du Yankee, finissent par triompher de lui en le poignardant. Tom Davis retourne en Angleterre. Pigeon et son compagnon sont faits prisonniers sur le champ de bataille par des aéronautes japonais qui les emmènent jusqu'à San Francisco dont le Japon s'est emparé.
On les exhibe dans les quartiers populeux, puis on les fait passer devant un conseil de guerre qui les condamne à mort. Mais sur l'intervention de l'officier Wami, qui fut naguère mêlé à leurs premières vicissitudes, un sursis leur est accordé. Le directeur de l'An 2000 cherche à en profiter pour soudoyer leurs geôliers; le cruel Wami découvre le pot au roses... Le narrateur est séparé de Pigeon et se demande ce qu'il est devenu.
Je ne tenais plus en place à l'idée que mon compagnon eût trouvé la mort dans l'aventure. J'interrogeai donc Wami froidement, sans amertume.
Il ne fit aucune difficulté pour me fixer, ce qui m'étonna encore.
— Où est Pigeon?
— Vous le reverrez.
— Vivant?
— Certes.
— A-t-il bu, comme moi?
— Non.
— De sorte que si j'avais été conduit jusqu'au lieu des crémations publiques?
— Vous y fussiez arrivé seul.
— Et qui m'attendait là?
— Oh! du monde! Beaucoup de monde. Plus de cinquante Chinois embrigadés pour vous emporter dans les profondeurs de la Chinatown, où vous eussiez été caché pendant quelques jours, soi-disant, pour être conduit ensuite à Vancouver. Ces Chinois sont des brutes. Je veillais sur vous. Heureusement! Et ce n'était pas difficile.
Le Japonais me faisait des yeux de plus en plus mauvais.
Ayant jugé que cette conversation familière avait assez duré, il accentua l'attitude cassante qui caractérisait sa manière dans le service — contraste singulier avec son ordinaire gentillesse — et il cessa de me parler.
Je l'entendis donner des ordres pour que l'enlèvement des corps fût immédiatement opéré. Le directeur de la prison comparut. Il y eut palabre pendant quelques minutes. Ce fut toute la cérémonie.
Les soldats portèrent au dehors, dans quelque cour, leurs cinq victimes et tout fut dit.
— Pouvez-vous marcher? me demanda bientôt Wami, d'un ton rogue.
— Tout de même, avec un peu d'effort...
— Suivez-moi donc.
Le directeur de la prison, consulté, acquiesça de la tête et je sortis sous escorte. En passant au greffe, on me fit signer une banderole, sorte de décharge pour le gouvernement qui n'aurait plus à me nourrir.
Mais où me conduisait-on?
Quelques minutes de cango, et j'arrivai, toujours sous escorte, dans une sorte de caserne, emplie du va-et-vient d'officiers et de soldats du mikado.
Wami me surveillait toujours de près.
Une salle s'ouvrit. On m'y poussa. Elle était vide.
A peine si j'avais eu le temps d'en examiner les murs nus que Pigeon y faisait son entrée de la même manière.
Tout de même je le revis avec autant de joie que si nous nous fussions retrouvés en pleine liberté, sur les eaux de la Savannah, par exemple, réunis alors par l'active intervention de ce Wami, qui maintenant nous persécutait.
Un instant nous restâmes silencieux, attentifs aux moindres bruits, curieux des moindres taches qui s'apercevaient au long des murs.
Nous appréhendions que derrière les portes il n'y eût des oreilles, et derrière ces taches, trous dissimulés, des yeux attentifs à nos faits et gestes.
Pigeon m'apparaissait comme une statue accroupie de la désespérance. S'il ne me dit rien de la pâleur de mon visage, nul doute qu'il en fût affligé.
Enfin, comme nous ne savions où nous étions, ni ce qu'on allait faire de nous, chacun pensa qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il était urgent d'échanger à voix basse le plus d'idées possible.
Ce fut à peine si nos bourreaux nous en laissèrent le loisir.
— Vous n'avez pas bu, Vous? demandai-je à mon adjudant.
— Je me suis méfié.
— Homme de peu de foi! Du moment que c'était le patron...
— Sans doute. J'ai eu tort. Que voulez-vous? On ne se refait pas.
— Vous aviez bien reçu une lettre?
— De M. Martin du Bois, parfaitement.
— Qui vous l'a remise?
— Un Chinois, arrivé de Vancouver.
— Que disait-elle?
— Faites tout ce que vous dira le geôlier.
— En n'obtempérant pas vous vous condamniez.
— Etes-vous plus avancé?
— Non. Mais je le serais sans la conduite inqualifiable de ce Wami; elle n'était pas à prévoir. C'est lui qui nous surveille à présent. Il ne nous lâchera pas. Savez-vous où l'on nous mène?
— J'ai compris, aux dires de l'officier qui est venu me prendre dans ma cage pour m'amener ici, qu'on va nous embarquer.
— Pour le Japon?
— Il y a des chances. Peut-être aussi est-ce pour une autre destination?
— Quelle idée avez-vous là-dessus?
— Sur ce voyage?
— Oui.
— Que les Japs veulent nous martyriser, très fort, pour commencer...
— Vous ne croyez pas que ce soit l'orgueil qui les fasse agir?
— Quel orgueil?
— Celui qu'ils éprouveraient à nous montrer, comme le disait Wami tout à l'heure, les merveilles de leur armement, de leur attaque et de leur défense.
Pigeon se mit à sourire.
— Quand vous verrez des Japonais montrer à qui que ce soit les merveilles de leur armement, de leur attaque et de leur défense, patron, il fera plus chaud qu'aujourd'hui, et pourtant la température est agréable; il fera beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui... Comment, vous, un vieux voyageur aux pays jaunes, vous donnez là-dedans? Vous admettez que ces Japs nous fassent toucher du doigt — puisque c'est l'expression qu'on nous sert tout le temps depuis le commencement de cette guerre — le fort et le faible de leur armée, de leur flotte, de leurs fortifications!
— Pourquoi pas? Ils sont vaniteux! Le désir de se voir qualifiés, par des voyageurs blancs, à l'égal des grands peuples de l'Europe! C'est quelque chose.
— C'était bon au commencement du siècle, ces accès de vanité! Mais aujourd'hui, en 1937! L'Europe et l'Amérique savent que les Japs ont tout appris, tout retenu de nos méthodes et sont fort capables de faire aussi bien que n'importe quel peuple blanc, pourvu qu'il s'agisse de la guerre et de sa préparation, de la fabrication des explosifs, des poudres, des projectiles. Ils n'ont pas changé leur méthode de sournoise prudence pour cela. Ils n'ont nulle envie de montrer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je les en approuve, entre nous. A mérite égal, leur système vaut mieux que celui des Américains, trop confiants dans leur supériorité... Il faut chercher ailleurs.
— Mais où? Mais quoi?
— Je n'en sais rien. Disons-nous que c'est avant toute chose un raffinement de cruauté et nous ne nous tromperons pas de beaucoup. Maintenant quel est ce raffinement? Sous quelle forme Wami, représentant les seigneurs japonais mortifiés par la désertion de l'Angleterre et de la France, et tout le Japon affolé par les miracles d'Erickson veulent-ils assouvir sur nous une vengeance que le peuple entier réclame sans doute?... Voilà... Si vous désirez mon impression sincère, je vous confesse qu'elle n'est pas bonne. Il eût mieux valu pour nous, je crois, rester sous le coup de la condamnation pure et simple et attendre les événements dans notre cage que d'être emmenés je ne sais où par ces gaillards-là.
— Que peuvent-ils donc imaginer pour augmenter notre supplice?
— Un raffinement, vous dis-je un raffinement de cruauté: ne cherchons pas ailleurs. N'oubliez pas que nous sommes ici deux personnages, amis d'Erickson, complices — ils nous l'ont dit — des catastrophes que celui-ci leur a si magistralement servies. Par conséquent on a les yeux sur nous. Dans les trois mille îles du Japon nous sommes connus aujourd'hui, suivis de loin comme des prisonniers de marque. Il nous faut un calvaire spécial. Croyez-moi, c'est dans cet ordre d'idées qu'il faut nous préparer à souffrir. Ce qui n'empêchera pas qu'on nous montre, en passant, de curieux tours de force, pour masquer précisément la sauvagerie du procédé.
Pigeon s'arrêta. Je compris qu'il avait raison.
Puis, plus bas, il me demanda si j'avais reçu un morceau de journal, avec la lettre.
— Aucun.
Il me confia rapidement alors qu'au billet de Martin du Bois, reçu par lui, une minuscule découpure de journal était jointe. C'était un extrait du Vancouver Daily News.
— On y lisait, poursuivit Pigeon, ces quelques lignes; je les ai logées dans ma tête pour vous les redire à la première occasion: « De stupéfiants résultats sont obtenus depuis quelques jours au-dessus de notre rade — il s'agit évidemment de Victoria, la capitale de l'île — par une dizaine d'aéroplanes arrivés de Milwaukee. L'inventeur de ces engins, supérieurs à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, paraît-il, n'est autre que Will Keog, le propre frère du regretté Jim, notre compatriote, si malheureusement tué au-dessus de Londres au début d'une guerre absurde, devenue à présent une guerre sainte. L'un de ces aréoplanes est depuis quelques jours la propriété d'un riche Français, M. Martin du Bois, directeur de l'An 2000, qui l'emploiera, dit-on, à rechercher deux de ses rédacteurs faits prisonniers à Tucson, dans l'Arizona, par les survivants de la première armée japonaise, après les tueries scientifiques que dirigea si magistralement le maréchal des Forces naturelles. »
— Diable, répondis-je, voilà une note qui est bonne et mauvaise! Elle nous informe de ce que prépare Martin du Bois à Vancouver; mais elle prévient aussi les Japs!
— N'ayez crainte. Les Japs savent ces choses depuis la première heure...
Pigeon n'eut pas le temps d'en dire davantage car un cortège s'avançait vers nous, qui commençait à nous être familier: un sergent et dix soldats.
Toutefois, ce détachement apportait du nouveau.
Le sergent tenait dans sa main droite deux bandeaux noirs. Il nous les plaça sur les yeux en marmottant des mots qui restaient pour nous incompréhensibles, comme à l'ordinaire.
Du coup j'étais aveugle. Il ne manquait plus que cette infirmité-là!
Devant mes yeux des bouillonnements désordonnés se produisirent pendant quelques secondes. Puis ce fut du noir, du rose, du bleu, en nappes opaques, rapidement déroulées, que je crus apercevoir.
Finalement j'étendis les mains avec inquiétude, ne sachant où ces soldats voulaient en venir.
Alors une supposition affreuse me hanta.
Si cette histoire de voyages qu'on nous avait racontée n'était qu'une frime?
N'allait-on pas nous tuer là, dans cette salle?
Et par un accidentel sentiment de pitié, Wami — c'était toujours lui que je voyais à présent au fond de la moindre action japonaise — ne nous faisait-il pas bander les yeux, comme on met des masques sur le front du bétail pour le tuer dans l'abattoir?
— Que pensez-vous de ça, Pigeon? demandai-je à mon coadjuteur tandis que le sergent l'accommodait.
— Je pense, patron, que mes pressentiments se confirment. Pour qu'on nous bande les yeux il faut qu'on ait formé le projet de nous conduire quelque part sans que nos yeux soient capables d'y voir...
Des mots furent échangés entre le sergent et l'un de ses soldats. Aussitôt je sentis une corde me serrer le cou.
Tant que je vivrai je me rappellerai l'effroyable sensation.
Cette corde au cou, c'était la mort par pendaison qui se préparait!
Où allions-nous chercher tant d'hypothèses? Il n'y en avait qu'une à retenir et nous ne l'avions pas envisagée! Dans cette vaste salle où nous étions accroupis tout à l'heure, on avait oublié de regarder au plafond.
Sûrement il y avait au plafond quelque crochet, un crampon solide où le sergent allait nous pendre tous les deux.
Il me fut impossible d'articuler un son, tant j'étais affolé par l'idée de ce supplice imprévu. Et dire que ni Pigeon ni moi nous n'étions capables de nous faire comprendre de ces soldats, encore moins d'être compris d'eux!
Eh bien, croiriez-vous qu'à cette seconde affreuse, faite d'épouvante et de tremblements convulsifs, l'idée de l'espéranto vint me traverser la cervelle?
Oui, on allait nous pendre — nous le pensions du moins — et la désolation où j'étais de ne rien comprendre à ce qu'on préparait me faisait dire en moi-même:
— Que ne savons-nous, ces Japs et nous, l'espéranto? Si l'espéranto avait fait des progrès plus rapides depuis Zamenhof, qui le prêchait en 1900, nous serions fixés...
Ce mot m'ayant paru macabre, dans une acception où le plafond de la salle devenait le fixateur, j'eus un mouvement de répulsion.
Mais le sergent me prit par le bras pour me faire comprendre qu'il fallait marcher à côté de lui.

Pigeon, attaché de la même manière,
me suivait à quelques pas. (Page 580.)
Je démarrai, lentement, comme un animal résigné. Aussitôt j'eus la sensation que la même corde réunissait nos deux cols, et que Pigeon, attaché de la même manière, me suivait à quelques pas.
On sort dans une cour, puis dans la rue. Les clameurs recommencent, comme au jour de notre exhibition en palanquin.
Au bout de quelques minutes, arrêt.
On nous hisse dans deux cangos que les coulies tirent de front, assez lentement. Je suis à gauche de la route, Pigeon est à droite.
Les djinn rickchaus ou porteurs de chaises, font de leur mieux, à ce qu'il me semble, pour ne pas allonger la distance qui nous sépare l'un de l'autre. Autrement, chaque fois qu'un cahot tend la corde, je suis entraîné par le cou; mon compagnon est de même, solidaire, et ce sont de vives appréhensions chez tous les deux.
Dix minutes de cango et nous pénétrons dans une cour pavée. On y devine une atmosphère plus calme qu'en pleine rue de la ville.
Ordre de descendre, accompagné d'un geste, pour aider les patients à toucher terre.
On nous conduit, toujours attachés, à travers la cour. Il y a du monde, beaucoup de monde même. Mais à la discrétion des colloques je reconnais que tout ce monde est discipliné. C'est une troupe; il y a des officiers, tout un état-major, qui bourdonne légèrement sur notre passage.
Halte! On nous délivre. On nous enlève les bandeaux et la corde. Où sommes-nous? Dans une forteresse imposante, dont je ne peux déterminer l'emplacement exact parce que je ne connais pas assez San Francisco. Le ciel est bleu, le soleil brille. Des bâtiments semblables à des casernes nous entourent; aussi des usines, avec de grandes cheminées.
Nous remarquons sans tarder une analogie entre ce décor industriel et les stations électriques du regretté maréchal. Devant nous un groupe d'officiers japonais de tout grade cause avec animation, regarde en l'air, cherche à y découvrir je ne sais quoi.
Pigeon est là, tout hébété, mal remis de l'alerte. Il ose à peine me regarder. Quant à dire une parole, il n'y faut pas songer. Soit en anglais, soit en français nous serions compris par l'un quelconque des trente ou quarante officiers japonais qui sont là. Et il est inutile de leur faire connaître la plus banale de nos pensées.
Je cherche des yeux Wami. Invisible! Sans doute il est remonté en l'air pour y prendre un poste de surveillance ou de combat.
Mais qu'attendons-nous dans cette cour, en plein soleil, à quelques pas de ces officiers? Et pourquoi nous a-t-on fait venir? Sans chercher beaucoup je découvre que ce doit être pour nous mettre en présence d'un spectacle.
A quel spectacle l'autorité nipponne veut-elle donc nous faire assister?
Je ne peux m'empêcher de grommeler à l'oreille de Pigeon, dont je me suis ostensiblement rapproché:
— Vous voyez que j'avais raison! Ils tiennent à nous montrer quelque chose.
A ce moment un jeune officier, sous-lieutenant d'artillerie, nous fait avancer. Il nous dit en français presque correct:
— Vous êtes les deux espions dont le lieutenant Wami a obtenu la grâce pour trois mois?
— Espions? protestai-je. Que non pas!
— Je sais. Vous rougissez de ce mot en France. Chez nous, il est en grand honneur. Mais peu importe. Je suis chargé par le lieutenant Wami de vous faire assister à une expérience de notre Maëlstrom aérien.
Je tendis le cou avec curiosité, et mes yeux durent s'ouvrir démesurément.
Ceux de Pigeon sortaient de leurs orbites à ces mots bizarres.
Le petit officier poursuivit:
— Vous pourrez voir que si nous n'avons pas eu un Erickson pour installer notre usine électrique, nos officiers du génie ont su emprunter aux Américains tout ce qu'ils ont découvert d'utile, et ne se sont pas trop mal tirés d'affaire.
— C'est une consolation dans notre malheur, dis-je, que d'entendre parler aussi correctement par un officier japonais la langue de notre pays. Pouvons-nous vous demander, lieutenant, où nous sommes?
— Je suis chargé, messieurs, d'avoir l'honneur de vous le dire par le « chef des batteries de l'air ».
C'était le titre qui revenait à Wami, l'équivalent de notre « aéramiral ».
Ce petit Nippon pétillait de malice. Il débordait surtout de politesse.
Il avait en tout cas l'air enchanté de nous servir d'interprète.
Seul, à ce que je vis, il parlait le français, de tous les officiers qui se trouvaient là; aussi cambrait-il la taille.
Il poursuivit:
— Vous êtes ici, par une tolérance exceptionnelle, dans la forteresse de Santa Maria. Nous attendons la visite de vos amis les Yankees, montés, paraît-il, sur des appareils plus lourds que l'air tels qu'on n'en a encore jamais vu. Et comme la façon dont nous allons les recevoir est originale et digne de leur maréchal défunt, à mon avis, le chef des batteries de l'air a ordonné qu'on vous fit assister à cette opération! Vous pourrez établir ensuite des comparaisons qui seront peut-être à notre avantage. C'est de la coquetterie patriotique.
Encore que nous fussions attristés d'apprendre que ces gaillards avaient organisé à San Francisco tout un système de défense aérienne contre les Américains redevenus nos amis, comme autrefois, comme toujours depuis qu'il y a une Amérique colonisée par des Européens, l'idée de voir aux prises Jap et Sam ne pouvait que m'intéresser.
Bien entendu je formais des voeux pour que Sam fût victorieux.
Mais comment pouvait-il espérer l'être à San Francisco?
Qu'est-ce qu'une flottille aérienne pouvait bien faire au-dessus de cette grande ville remplia de troupes japonaises et de canons monstres. L'entreprise me parut téméraire.
— A moi aussi, dit Pigeon.
— Et à moi donc, renchérit le jeune sous-lieutenant. Quand vous m'aurez fait l'honneur de voir ce que je vais avoir l'honneur de vous montrer, Messieurs, vous serez d'avis qu'elle est folle, l'entreprise.
— En quoi consistera-t-elle donc? Vous en connaissez les détails?
— Oh! oui, depuis ce matin. Avant une heure nous aurons au-dessus de nos têtes une dizaine d'aéroplanes que commande le fameux Hibou de l'Océan... Réputation naissante, Messieurs. C'est ainsi qu'on surnomme Will Keog, le frère de Jim, celui-là même qui, paraît-il, a fait un arrangement avec votre directeur, à Vancouver, pour vous enlever d'ici sur l'un de ses appareils.
Nous étions un peu penauds de voir ainsi dévoilée une tentative qui devenait, par ce fait, inutile, puisque l'adversaire était prévenu.
Néanmoins nous fîmes tous les deux contre fortune bon coeur.
— Veuillez prendre la peine et me faire l'agrément de m'accompagner, dit le lieutenant avec cette superfétation de mots qui caractérise la politesse japonaise.
On n'eût guère supposé, à l'entendre, que cet officier d'artillerie parlât à deux étrangers, condamnés à mort, amenés devant lui les yeux bandés et la corde au cou.
Il fit signe à l'escorte de rester là où elle se trouvait.
Quelques officiers au contraire se joignirent à nous pour faire la visite du fort.
On se mit en route pour descendre dans des batteries souterraines, où de temps en temps apparaissaient des sentinelles, éclairées par le reflet d'une lampe électrique. Puis des galeries et encore des galeries, des canons qui pointaient sur le ciel, et dont les projectiles allaient frapper à quarante kilomètres...
C'était grandiose et furieusement menaçant. Sûrement, en fait de gros canons, l'oncle Sam n'avait pas mieux. Nous le pensions bien, mais devant les dix ou douze officiers qui nous accompagnaient je n'osai faire aucune réflexion, ni demander à Pigeon — contrairement à l'habitude — ce qu'il en pensait.
Comme nous remontions au jour je vis une grande galerie circulaire en forme de canal, assez semblable à la voie de notre chemin de fer métropolitain s'il était débarrassé de sa voûte... Ebloui par la lumière, à laquelle mes yeux n'étaient plus habitués depuis près d'une heure, je ne m'expliquai pas tout d'abord le but de cette galerie.
Peut-être un fossé inondable, pour noyer les poudrières dont on apercevait les portes, de distance en distance, dans la paroi intérieure?
Des grilles larges, placées çà et là sur le radier, entre les rails, montraient des caniveaux d'écoulement sous plusieurs formes.
Le lieutenant, qui depuis une grande heure n'avait pas dit un mot, commença dès lors à nous donner des explications.
— Vous venez de voir, dit-il, ce fort souterrain, où toutes les pièces et chambres de munitions sont protégées contre le tir par des remparts de terre et de ciment armé. C'est la protection ordinaire, connue, classique. Nous en avons imaginé une autre contre les Yankees de l'air, persuadés que nous étions de les voir arriver à quelque jour avec des appareils encore inconnus. C'est le typhon. Erickson a détruit devant vous deux de nos aérocars à Key-West par la pluie en cercle. Eh bien, nous, modestes ingénieurs et artilleurs japonais, c'est le typhon, que nous sommes parvenus à créer dans l'atmosphère. Nos appareils, que vous verrez tout à l'heure, déterminent en chassant des gaz à la rencontre l'un de l'autre, des remous circulaires qui atteignent une hauteur de quatre mille mètres et un diamètre d'au moins cinq cents... Dans ce remou, le fluide est brassé avec une telle énergie que les corps qui s'y trouvent pris échappent aux lois de la pesanteur, de la cohésion et de l'attraction... Ce sera, je pense, une salade japonaise!
Un peu distrait au début, j'avoue que je prêtais bientôt une oreille intéressée aux développements du jeune artilleur. Il faisait de l'esprit, par surcroît.
— Rien ne saurait résister, poursuivait-il, à cette masse gazeuse animée d'un mouvement circulaire, qui agit dans l'atmosphère et sur terre comme une gigantesque fraise mécanique. Elle découpe et fauche sur son passage tout ce qui offre une résistance à son mouvement giratoire. C'est un véritable maëlstrom aérien, comme nous disons. Le Japon a dépensé ici des sommes énormes pour établir toute la machinerie que vous allez voir. Nous lui avons donné un nom significatif, du reste: le maestromilo. Dans cette galerie circulaire construite à ciel ouvert autour du fort, de gigantesques ventilateurs — vous les apercevez — vont puiser de l'air et le précipiter dans un mouvement circulaire en tout comparable à celui que leur Erickson déterminait à Key-West avec de l'eau sous pression...
Mais le jeune homme ne put achever.
A peine eut-il le temps de lever les yeux — et nous aussi — et tous ceux qui étaient là, pour voir disparaître à une vitesse incroyable le plus bizarre des engins.
On eût dit une sorte d'oiseau planeur. Et il fendait l'air avec une aisance incroyable, après nous avoir frôlés.

On se mit en route pour les batteries souterraines. (Page 584.)
Ce fut le signal d'un branle-bas général. Tous les officiers couraient à leur poste dans les réduits souterrains. Jusqu'à nos convoyeurs, le sergent et ses dix hommes, qui disparaissaient dans les batteries. Seuls nous restions bien en vue, au milieu de la cour, avec le jeune sous-lieutenant si poli. Je compris que l'ordre de se mettre à l'abri n'était pas fait pour nous.
— Au contraire, dit courtoisement l'officier. J'ai pour consigne de vous montrer la manoeuvre du maëlstrom aérien dans toute sa beauté. Et pour la bien observer il faut rester dehors.
Pigeon me regardait avec un air si désespéré que je perdis, ou à peu près, tout ce qui me restait d'énergie
A coup sûr on nous exposait à recevoir les coups. Premier raffinement de cruauté. Une action meurtrière allait s'engager. Pour nous apprendre à vivre on nous exposait à une mort probable, et ce serait de la main de nos nouveaux alliés que nous serions frappés.
Le sacrifice du sous-lieutenant n'en était pas moins consenti d'avance, et le sourire de cette victime innocente, placée là sans raison, me rappela pendant une seconde les héroïsmes de nos anciens amis, à bord de l'Austral.
Je jetai un regard de tous côtés. Plus un soldat n'apparaissait.
Les combattants japonais de tout grade étaient sous la coupole, attentifs à la manoeuvre des canons géants, tandis que du maestromilo s'échappaient des bruits stridents, comme de longs coups de sirène. Le gaz était lancé dans l'espace et y commençait le mouvement giratoire annoncé.
— A partir de cent mètres en hauteur, nous dit le jeune officier, c'est maintenant la tornade. Voyez les pailles, les herbes arrachées du sol qui se précipitent à grande vitesse dans le tourbillon.
Bientôt au milieu des ronflements assourdissants du cyclone atmosphérique nous vîmes s'avancer dix longues machines volantes, dont le gabarit m'était tout-à-fait inconnu.

A partir de cent mètres en hauteur,
c'est maintenant la tornade.
Pigeon redevenait lui-même à cette vue, et me jetait des mots hachés, des termes scientifiques auxquels je ne comprenais rien. Je devinais.
Ses souvenirs techniques rattachaient ces formes nouvelles à d'autres silhouettes déjà vues, essayées en France, par nos Voleurs, notamment.
Tout préoccupé que je fusse de sauver ma vie en me défilant, je ne savais encore comment, dès que les échanges de coups commencèrent, je regardais au fond du ciel ces dix points noirs, moins visibles à coup sûr, à mille mètres en l'air que ne l'eussent été dix tortues noires de Jim Keog.

C'était comme une volée d'oiseaux. (Page 585.)
C'était comme une volée d'oiseaux, car il y avait dans l'air des ailes étendues, tout au moins des plans allongés qui donnaient cette impression.
Les malheureux! pensais-je. Ils arrivent en plein dans le tourbillon, qui va les saisir et les broyer!
Or, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire tous les engins, se gardant bien d'entrer dans le maëlstrom dont ils connaissaient la terrible puissance et le rayon d'action, tombaient littéralement à terre. Ce fut comme s'ils avaient été tous en même temps désemparés de leurs moteurs. On ne les voyait plus. Une décharge d'artillerie muette eût fracassé leurs ailes ou leurs cylindres qu'ils n'eussent pas été précipités autrement du zénith sur le sol.
Mais ce n'était là qu'une manoeuvre audacieuse. Will Keog savait que le maëlstrom aérien ne commençait son oeuvre tournoyante qu'à cent mètres au-dessus du fort.
A douze ou quinze mètres au plus, très bas, touchant presque les toits des casernes, puis descendant encore plus bas, l'un de ces corsaires aériens passait à côté de nous à toute vitesse, comme il avait déjà fait tout à l'heure, cependant que des détonations éclataient de toutes parts, impuissantes, parce que les projectiles étaient pointés trop haut.
Habitués au vol des ballons de Wami et de ses confrères, les artilleurs japonais s'attendaient à faire feu dans les nuées. Or, voici qu'à hauteur du sol, rasant les cailloux et les herbes, au risque de toucher terre avec leurs antennes directrices, les aéroplanes se précipitent au milieu de la cour, virent et repartent en quelques secondes, sans qu'on ait trouvé le temps de leur tirer un coup de feu à bout portant.
Outillé pour les atteindre à quatre mille mètres de hauteur, le fort de Santa-Maria n'est pas en mesure de les combattre corps à corps, pour ainsi dire.
Alors se produit la plus épouvantable des explosions. Deux ou trois de ces oiseaux, rapides comme le vautour quand il fond sur sa proie du haut de la nue, ont laissé tomber dans la batterie colossale qui tire sur eux, bien trop haut, des bombes dont les effets sont aussi terribles qu'immédiats.
Tout saute. La terre, les murailles, les ateliers où sont installées les machines génératrices. Je remarque au milieu des énormes oiseaux qui vont et viennent, lançant partout des projectiles à grande capacité d'explosifs, un aéroplane qui ralentit sa course et semble pointer sur nous. La vision de Kooenigsdorf me revient à l'esprit, comme un pressentiment.
C'en était un! A peine si nous avons le temps de regarder en face l'engin, blindé de toutes parts, insensible aux balles des tirailleurs hâtivement échelonnés, que le petit sous-lieutenant, surpris, tombe sur la face, tué d'un coup de fusil à air, cependant que deux bras vigoureux me saisissent et m'enlèvent, laissant Pigeon seul au milieu de la cour, dans l'attitude du désespoir le plus pitoyable.

Mon sauveteur était un homme à tête de hibou. (Page 585.)
En une seconde l'appareil sur lequel je suis maintenu par mon sauveteur, un homme à face de hibou, vraiment, qui ne peut être que Will Keog —il a la barbe roussâtre de son frère et je le reconnais à ces
détails sans l'avoir jamais vu — s'est élevé à travers l'espace, où nul typhon n'est plus à craindre puisque les appareils perturbateurs ne fonctionnent plus...
Hébété, ne sachant si je n'eusse pas été moins malheureux en restant à côté de mon pauvre ami, je n'ose faire un mouvement ni un geste.
L'engin vole avec une rapidité foudroyante, que l'autre Keog n'obtenait certainement pas avec son Sirius. Cette fois c'est bien le plus lourd que l'air qui m'emporte. Je suis couché en travers d'une étroite plate-forme et l'idée d'une chute affreuse m'obsède au point que je ferme les yeux pour ne rien voir.
Mais un cri du Hibou me force à les rouvrir. Il a commandé à son barreur de changer la direction. Nous étions partis pour le Nord. Voilà que l'oiseau qui nous porte a mis le cap à l'Ouest.
Et l'Ouest c'est la mer.
C'est l'Océan Pacifique avec des dangers immédiats: l'immensité liquide d'abord; la flotte japonaise ensuite; tout au moins les trois ou quatre navires de guerre qui sont à l'ancre sur la rade, et qui ont pris leurs dispositions pour nous donner la chasse aussitôt qu'ils nous ont aperçus.
Les explosions ont tout révolutionné à terre; il ne faut pas s'en étonner. Que va faire dans cette direction l'homme acheté par Martin du Bois? Car il n'y a pas à douter non plus de son identité. Cette espèce de grand diable à barbe rouge, avec ses sourcils en accent circonflexe, son nez crochu, sa bouche rageuse, ses yeux fauves, c'est bien Will Keog l'homme dont Erickson m'avait un jour parlé.
Je comprends qu'il regarde au lointain, derrière nous, à la façon dont sa voix m'arrive, affaiblie et rauque.
Ce n'est pas le moment de l'interroger.
Je me borne à jeter un regard dans l'Est que nous fuyons.
Tout s'explique. Une véritable bataille est engagée dans les airs entre les aéroplanes américains et les ballons de Wami. Je frémis en songeant aux épisodes qui vont encore signaler celle-là. Les interjections de Will, ses cris de joie ou de rage me communiquent, seconde par seconde, les impressions que lui-même ressent.
A l'abondance des jurons et des blasphèmes, je comprends vite que les affaires de sa flottille ne vont pas bien.
Il me semble que je l'entends dire:
— Il restait trois retardataires. Cette canaille de Wami vient de les abattre tous les trois à coups de grenades.
Notre vitesse, réduite un instant, s'accélère.
Nous franchissons le front de mer et nous voilà partis, à je ne sais combien de kilomètres à l'heure, vers le large.
Je suis bien placé à présent, en dépit de l'attitude périlleuse qu'il me faut conserver, pour apercevoir devant nous les croiseurs japonais.
Ils ont levé l'ancre et se préparent à nous poursuivre, le cap à l'ouest.
En vérité c'est à notre perte que nous allons courir. Que peut espérer, en effet, un appareil aussi fragile des solitudes de la haute mer? A moins qu'un navire canadien, affrété par Martin du Bois comme le fut le Krakatoa, d'heureuse mémoire, ne croise à vingt milles d'ici pour nous y attendre?
Mais encore, les croiseurs seront derrière nous. Ils peuvent nous suivre jusqu'aux îles Hawaï. Et sûrement, c'est nous qui succomberons les premiers. Martin du Bois m'a sauvé, c'est un fait. Mais pour combien de temps? Mon angoisse redouble quand je songe au pauvre Pigeon. J'en viens à me demander encore si je n'eusse pas mieux fait de rester avec lui.
Cette fois je l'ai bien abandonné. Il est vrai que le crime de cet abandon ne peut m'être imputé. Aussi j'en veux à mon Keog, deuxième du nom.
Bientôt je l'entends qui redouble d'imprécations. Il échange des vues avec son aide sur l'arrivée de Wami, qui décidément nous suit de son mieux et va coopérer avec les croiseurs à la chasse qui commence.
En pleine mer! Nous avons évité le premier croiseur. Les projectiles qu'il nous envoie sifflent tout près de notre oiseau cuirassé; mais ils ne le touchent pas.
Wami, d'autre part, ne semble pas pouvoir lutter de vitesse.
Nous descendons plus près de l'eau pour gêner le plus possible sa poursuite, à ce que je comprends, lorsque se produit à la surface de la mer une succession étrange de ricochets dont je cherche un instant l'explication. Il ne me faut guère que dix secondes d'examen pour la trouver. Mais Will Keog l'a découverte avant moi. Il l'a même devinée, car je l'entends qui murmure en jurant comme un possédé:
— Voilà ce que je craignais. Nous n'irons pas loin à présent.
Ces ricochets, qui s'apercevaient nettement à la surface de la mer unie comme un lac, étaient provoqués par de curieux petits bateaux plats, sortis tour à tour, sans qu'on les eût d'abord aperçus, du flanc des croiseurs.
Leur forme était assez semblable, au-dessus de l'eau, à celle des canots ordinaires. En dessous c'était tout autre chose: ils n'avaient pas de quille. Ils étaient plats comme des palets qu'une main colossale eût lancés à fleur d'eau. Ils bondissaient de même sur la mer, animés d'une vitesse folle par un moteur extrêmement puissant sous la forme la plus légère.
Longtemps ce genre de bateaux, baptisés hydroplanes dès leur apparition en France, étaient restés de véritables jouets pour les amateurs de locomotion fantastique. Je me rappelai que jadis on les voyait glisser sur nos fleuves — la Seine avait connu leurs premiers ébats — soulevant des lames d'écume, franchissant des espaces de plusieurs mètres comme des sauterelles, reprenant contact avec l'eau, si peu que point, glissant encore, et toujours s'avançant vers leur but à des vitesses désordonnées.
Mais il me semblait qu'aucune marine militaire n'en eût fait encore usage. Les Japonais, d'après ce que j'apercevais au-dessous de moi, n'étaient pas en peine de trouver un emploi à ces acridiens aquatiques. Ils en faisaient des chasseurs d'aéroplanes à la mer.
Sans compter que pour exécuter des courses de vitesse d'un port à un autre, ou d'un navire en marche à un port, les hydroplanes, perfectionnés comme ceux-là semblaient l'être, réalisaient le maximum de la vitesse.
Je jugeai qu'ils sautaient sur la mer à raison de cent cinquante kilomètres à l'heure
Will Keog marmonna dans mon dos:
— Ils vont aussi vite que nous.
La course s'engageait, surprenante, entre les quatre types d'esquifs, les nautiques et les aériens: le croiseur, taillé pour faire bien des choses tout en maintenant une allure voisine de soixante kilomètres, le ballon dirigeable, capable d'en atteindre quatre-vingts, l'aéroplane qui en faisait cent cinquante, et l'hydroplane, aussi accéléré.
N'eût été le moment cruel et l'appréhension de tomber de là-haut, la joute eût mérité toute l'attention d'un connaisseur.
Je ne me préoccupais à vrai dire que d'une chose: lequel des concurrents en sortirait victorieux. Pourvu que ce fut mon sauveteur, quitte à savoir ensuite ce qu'il espérait devenir en plein océan!
Mais ma surprise ne devait pas se borner là.
Un cinquième genre d'esquif venait d'apparaître, à trois exemplaires aussi.
Tous trois avaient mis plus de temps que les hydroplanes à sortir du flanc des croiseurs. Je reconnus avec dépit qu'ils regagnaient vite les minutes perdues. Moins familier avec ceux-là, je les reconnus pourtant en me rappelant certaines descriptions que j'en avais lues jadis. C'étaient les hydrovolants!
Les hydrovolants, perfectionnement logique des hydroplanes! Autrement dit des hydroplanes pourvus d'un moteur qui continue à les propulser dans le vide.

Les hydrovolants japonais, perfectionnement
logique des hydroplanes. (Page 587.)
De là-haut je les voyais m'apparaître, tout gris sur l'eau bleue de la baie, comme des moustiques.
Les pattes perpendiculaires au plan de l'eau, ils ne naviguaient déjà plus, ils volaient. Ils filaient vers l'ouest à quelques mètres au-dessus de la nappe liquide.
Leurs ailes, car ceux-là étaient pourvus d'ailes, ou plutôt d'ailettes, superposées comme des lattes de jalousies, se divisaient en trois rangs, pour se réunir à l'avant et à l'arrière des bateaux, construits en forme de cigares. On eût dit les coques de nos dirigeables renversées sur l'eau.
Chaque fois que les hydrovolants quittaient la mer pour s'élever, leurs centaines d'ailettes se mettaient à battre, ce qui demeurait tout à fait imperceptible d'ailleurs, à la distance qui nous séparait et à la vitesse où elles battaient; mais je devinais bien leur office.

Les hydroplanes perfectionnés réalisaient
le maximum de la vitesse. (Page 588.)
A la vérité ce fut l'intervention de ces tard-venus qui nous perdit, car je remarquais déjà de l'essoufflement ici et là. Les hydroplanes faiblissaient; les croiseurs étaient distancés; le ballon n'avançait plus aussi vite. Déjà l'horizon marin s'arrondissait partout. Je n'apercevais plus que l'eau bleue et le ciel, sur la droite, sur la gauche et en avant.
San-Francisco restait loin derrière nous, et nous accélérions notre fuite dans de bonnes conditions pour échapper, lorsque les hydrovolants entrèrent dans la course pour la dominer.
Sûrement c'était en eux que nous avions de sérieux adversaires. Si sérieux que je perdis peu à peu tout espoir de leur échapper. Dans le grand calme de l'air, nous avancions silencieusement. On n'entendait que le ronflement du moteur endiablé. A vingt mètres au plus de l'eau nous étions les premiers, de plus de cent longueurs, et nous allions agrandir mathématiquement le jour qui s'était fait entre l'aéroplane et ses adversaires, lorsque les trois implacables chasseurs d'écume s'acharnèrent sur nous.
En quelques minutes ils nous dépassèrent. Will Keog jurait sans arrêter.
Je ne lui avais pas encore adressé la parole, par crainte de le troubler dans ses manoeuvres. Cette fois ce fut plus fort que moi.
— Pensez-vous que nous échappions à ces coquins? lui demandai-je.
— S'il n'y en avait qu'un, répondit-il sourdement, je m'en arrangerais encore. Mais ils sont trois. Il n'y a plus qu'à périr.
Cette déclaration me fit passer dans tout le corps un frisson singulier. Il me semblait qu'on m'arrachât les cheveux l'un après l'autre. Et pourtant, en dépit de la dépression physique et morale qui m'accablait, j'eus une réminiscence dont, en vérité, la raison eût pu dire: non erat hic locus.
La riposte de Will Keog m'avait fait penser aux vers fameux de Corneille dans Les Horaces:
— Que vouliez-vous qu'il fît contre trois?
— Qu'il mourût!
L'Américain venait d'émettre une idée cornélienne sans y penser! S'il n'y en avait qu'un, avait-dit, je m'en arrangerais encore. Mais ils sont trois. Il n'y a plus qu'à périr. Je trouvais qu'il était trop cornélien, Will Keog, car le second vers, correctif du premier, chantait aussi dans ma mémoire:
Ou qu'un beau désespoir alors le secourût.
Mais voilà! Quel beau désespoir pouvait, à cette heure tragique, nous secourir sans qu'il en coûtât la vie?
De toutes façons, pensais-je, notre sort est réglé. Nous allons être à bout de forces dans une heure, dans deux heures, alors que ces trois lévriers seront encore bons pour une course plus longue. Et ce sera la capitulation finale. Comment s'opérera-t-elle? Ce diable d'homme va-t-il encore m'offrir le pistolet, ou le mauvais flacon, à la japonaise? Dieu que les occasions de se suicider sont donc fréquentes dans ce pays!
Je me cramponnais de mon mieux, en émettant cette pensée mélancolique, à l'avant du fragile appareil, lorsque ce qui devait arriver arriva.
Le moteur ralentit, puis s'arrêta. Le combustible manquait. Will Keog courait les airs depuis le matin. Il le criait aux mouettes qui passaient, entre deux demi-douzaines de jurons.
L'aéroplane tombait, tombait. En une demi-minute nous fûmes tous trois dans la mer, où chacun se mit à nager de son côté, sans autre souci de la solution cornélienne.
Le mécanicien plongea comme un poisson et disparut. Sans aucun doute il ne put aller loin. Keog relevait la tête au-dessus de l'eau pour se rendre compte de la position lorsque le plus rapide des hydrovolants arriva sur lui. D'un geste synchronique, trois mains s'abattirent et le happèrent.
J'attendais quelques coups de fusil, tout en me soutenant sur l'eau, les yeux fermés, ne voulant pas que les Japs pussent dire que j'implorais leur secours.
Un commandement se fit entendre. Ce n'était pas encore celui de la fusillade. Le moteur de l'esquif amphibie s'arrêta.
Je me sentis empoigné par le col de mon kimono, et hissé avec précaution à bord, tel un repêché de marque dont on doit prendre soin.
Autour de moi, sur le frêle appareil, quatre ou cinq Japs étaient penchés curieusement quand je me décidai à rouvrir les yeux, car il m'était impossible de faire ainsi l'aveugle plus longtemps. Tous me lancèrent des injures, à ce que je crus comprendre. Mais leur chef imposa le silence, et l'on mit le cap sur le premier croiseur qui se présenta.
C'était le Saïtama, me dit le petit patron de l'hydrovolant, avec une insistance d'autant plus fière qu'il appartenait, ainsi que ses compagnons, à l'équipage de ce navire.
Je fus hissé plutôt que je ne montai à bord. Un cercle d'officiers m'attendait pour me regarder une fois de plus comme une bête curieuse.
Puis on me donna des habits de matelot moderne en toile, comme naguère avait fait le commandant du Minnesota dans la mer des Sargasses.
Dès que je fus pourvu de vêtements secs une escouade me fit descendre dans la geôle.
Une fois de plus j'étais en cage, avec un factionnaire devant mes barreaux.
Le croiseur avait stoppé dix minutes. J'entendis les turbines qui recommençaient leur chanson. Nous étions en route. Mais pour quelle direction?
Le Saiïtama retournait-il à San- Francisco? C'était probable. Avant le soir je serais débarqué, et peut-être soumis à un nouveau jugement pour avoir tenté une évasion dont je n'étais pourtant pas responsable.
Mais les heures s'écoulèrent et tout me faisait croire que nous avions gagné la pleine mer. Alors c'était au Japon qu'on nous transportait. Sur quelque côte qu'on abordât, l'américaine ou l'asiatique, mes jours étaient comptés. Je retombai dans la prostration la plus complète. Tout en rendant hommage aux efforts que M. Martin du Bois avait multipliés pour me sauver, je ne pouvais guère conclure qu'à son impuissance. Même aidé de la nouvelle force aérienne que les Yankees tenaient en main désormais, il avait échoué dans une tentative qu'il devenait impossible de renouveler.
C'était bien fini, cette fois, et le Laschiate ogni speranza (*) du Dante bourdonnait comme un insupportable frelon à mes oreilles.
(*) Abandonnez tout espérance.
Après avoir longuement médité sur l'enchaînement si rapide des événements qui m'avaient conduit dans cette geôle d'un navire de guerre japonais, je me pris à en examiner les parois.
C'étaient de véritables murailles de fer. Le jour y pénétrait par un hublot minuscule, assez semblable au trou que nous avions tant apprécié avec Marcel dans la cheminée du Krakatoa. On eût pu y passer le bras, mais rien de plus.
Il n'en était pas moins rivé à la muraille métallique du navire. L'air m'arrivait par le devant de la cage, où la sentinelle faisait son office, comme si elle eût été enfermée elle aussi, de gauche à droite et de droite à gauche, sous un reflet blafard de la lumière péniblement empruntée à l'entrepont par un panneau ouvert.
J'imitai le soldat; je marchai.
Il me regarda curieusement, comme si le besoin de marcher dans un espace aussi étroit lui eût paru ridicule. Dépité, je m'accroupis à nouveau. J'avais pris l'habitude de la posture chère aux Nippons. Un rayon de soleil vint à ce moment étinceler sur le verre épais de ma lucarne ronde. Je considérai le soleil. Il descendait dans la mer, sur ma droite.
Si le soleil descend à tribord, me dis-je, c'est que nous allons vers le Sud. La réflexion n'avait rien de transcendant. Elle me surprit néanmoins.
Pourquoi vers le Sud?
Je ne cherchai pas longtemps. La déduction s'imposait. Le Saïtama rejoignait la flotte Japonaise qui croisait, d'après ce que nous savions de puis le commencement de la guerre, aux abords du canal de Panama, dans l'Océan Pacifique.
Cette constatation n'enlevait rien à l'amertume de mes pensées. On allait là parce que le commandant avait des ordres. On y resterait quelque temps, après quoi le voyage au Japon s'imposerait, ou le retour à San Francisco. Je sentis que mon individu comptait pour bien peu de chose à bord de ce grand bâtiment, où les commandements au sifflet ne cessaient de se faire entendre, comme si les marins se fussent exercés au-dessus de ma tête. J'entendais en effet des pas cadencés, des ordres brefs, tout ce qui constitue l'ordinaire accompagnement des mouvements d'un équipage à la mer.
La nuit vint sans que rien eût changé, pas même la route, car à ma droite rougeoyait à présent le crépuscule. Le quart de huit heures fut piqué comme un matelot venait m'apporter du riz et de l'eau. Je lui demandai en anglais s'il pouvait me dire où nous allions, mais pour toute réponse le vilain singe prit ma vareuse entre le pouce et l'index, la secoua dédaigneusement et me fit comprendre qu'elle était désormais souillée, puisqu'elle recouvrait le corps d'un blanc.
Une heure plus tard le même matelot revint, pour me jeter une natte crasseuse et une couverture de cotonnade, comme on jette deux os à un chien.
Je dormis à peine, et cet aveu n'étonnera personne.
Le jour me trouva tout courbaturé, le spleen dans le cerveau, les veines glacées. J'avais eu le temps de faire le compte des heures et des jours. Il me semblait que je rendisse ma peine moins dure en répétant à demi-voix, devant la sentinelle quatre fois relevée depuis la veille:
— Aujourd'hui 5 décembre. Aujourd'hui 5 décembre...
Une seconde nuit se passa. Et rien n'était venu modifier la vie monotone du bord, que des exercices nouveaux, répétés à satiété sur les ponts, avec des commandements rauques, lancés par de petites voix flûtées.
Le 6 au matin, un grand bruit se fit dans la mer. Je reconnus le tintamarre des deux lourdes ancres mouillées à la même seconde, brutalement.
Je poussai un soupir. Enfin, pensai-je, on va savoir, quelque chose! Mais pour la centième fois, ayant appliqué mon oeil au petit hublot, je ne vis à tribord que la mer immense, très bleue et le ciel aussi bleu qu'elle. J'occupais le mauvais côté du croiseur pour apercevoir le rivage et tirer de son aspect une conclusion géographique.
Attendre, il n'y avait pas d'autre parti à prendre, et pour cause. J'attendis donc.
Lorsque la poignée de riz m'eut été apportée à midi par mon surveillant, un remue-ménage caractéristique me fit comprendre que des hommes se préparaient, sur le pont, pour descendre à terre.
Un second maître d'équipage vint ouvrir la cage et me fit signe de le suivre. Allais-je donc débarquer aussi?
J'arrivais sur le pont, encombré de caisses, de colis superposés en une pyramide imposante. Les officiers se tenaient en groupe compact autour du commandant qui leur adressait des paroles bien senties au milieu d'un religieux silence. A peine si mes yeux eurent enveloppé ce tableau qu'ils allèrent à la côte: une grève basse, jaunâtre, sur notre gauche, sans une cabane qui permit de croire à l'existence d'êtres vivants.
Je revins au groupe de l'état-major. Le commandant semblait s'adresser plus spécialement à un lot d'officiers.
L'un d'eux portait les galons de médecin. Un autre, qui se tenait en tête, était commandant de croiseur comme celui qui pérorait. Il me parut plus âgé; sa barbe était toute grise.
J'eus un haut-le-corps en dévisageant Wami, qui dans une attitude aussi déférente que les autres, écoutait la harangue du grand chef. L'impression que j'éprouvai fut très nette.
Cette espèce de mission allait descendre à terre; c'était comme une délégation que le Saïtama déposait clandestinement sur la côte américaine. Et avant le départ, le commandant du bord donnait à chacun les conseils que lui suggéraient son devoir et son expérience.
Wami à bord de ce navire! Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Je supposai aussitôt qu'il allait à terre pour y installer un poste d'aérotactique.
Mais la nature des colis qui s'entassaient là ne correspondait guère à cette supposition. Presque tous renfermaient, à ce que je devinai, des projectiles, des explosifs ou des matières dangereuses, car on lisait sur les caisses d'uniformes recommandations peintes en rouge. J'en avais vu tant et plus dans les batteries souterraines de San-Francisco et sur les champs de bataille de l'Arizona!
Wami n'était donc pas là comme aérotacticien. Il redevenait officier de la marine. A quelque titre que ce fût il faisait partie de la mission, voilà ce que je devinais facilement; il y occupait même le second emploi. Il était le coadjuteur du commandant à barbe grise.
Au surplus, me demandai-je aussitôt, qu'est-ce que je venais faire là? Pourquoi m'avait-on extrait de ma niche?
Je l'apprenais au même instant.
L'apparition de Wami n'était pas la seule surprise qui me fût réservée. N'amenait-on pas aussi dans le demi-cercle formé par les missionnaires, Pigeon et Will Keog, vêtus en matelots, comme moi-même?
Nous échangeâmes des regards furtifs où nos geôliers, si prompts à lire dans les yeux, n'eurent pas de peine à découvrir la joie farouche d'être réunis.
Will Keog ne m'intéressait encore qu'à moitié. Mais Pigeon!
On nous donna une brusque poussée dans le dos. Alors, à cinq pas du commandant, les yeux bravement fixés sur son faciès farouche, nous l'entendîmes prononcer notre sentence. Elle concordait assez, avec ce que Wami m'avait annoncé, après l'échec de ma première tentative d'évasion.
— Misérables blancs, nous dit-il, vous prétendez que dans cette guerre, ce sont vos pareils qui ont jusqu'ici trouvé les moyens les plus audacieux pour combattre vos adversaires. L'honneur du Japon, par vous attaqué, exige que nous fassions la preuve du contraire. Cette preuve, nous allons la faire sous vos yeux. Vous allez descendre à terre avec la mission que j'y envoie pour étonner le monde. Vous ferez en sorte de vous comporter au cours de l'expédition qui commence en prisonniers dociles, en travailleurs consciencieux. Si vous avez la chance d'arriver sains et saufs au terme du voyage que mon gouvernement a décidé de confier aux officiers supérieurs que voici, ces Messieurs ont pleins pouvoirs pour disposer de vos existences. Ils en useront comme bon leur semblera. Rappelez-vous à toute heure que le Japon, que vous avez tant de fois raillé, est le premier pays de l'Asie, misérables blancs, en attendant qu'il devienne, et ce ne sera pas long, le premier du monde entier.
Ce fut tout. Les auditeurs rompirent.
La manipulation des caisses commença.
Prudemment des Chinois que je n'avais pas aperçus, les descendaient par les échelles dans les canots de tout gabarit qui se balançaient des deux côtés du Saïtama.
J'espérais que Wami se montrerait humain. J'attendais qu'il eût eu pour moi, tout au moins, un regard de commisération. Mais ce fut le contraire. Avec arrogance il nous bouscula tous les trois.
Et comme un quartier-maître nous ordonnait de descendre, à notre tour, de lourds objets en caisse.
— Prenez vos précautions pour éviter les chocs, nous dit-il sèchement, sinon vous êtes morts! Et je veux vous conserver vivants jusqu'au bout, pour vous faire souffrir comme vous le méritez.
Une heure après nous allions à terre. Mais quelle subite transformation! Depuis le commandant jusqu'au dernier matelot toute expédition, avant de descendre du croiseur, s'était affublée des costumes les plus baroques.
Ce n'étaient plus des marins japonais que nous avions autour de nous, mais une trentaine d'aventuriers hispano-asiatiques, drapés à la mode mexicaine ou colombienne, en des hardes qui certainement avaient été collectionnées pour ce travestissement.
Quand nous nous présentâmes à la coupée pour embarquer dans une baleinière déjà chargée de colis, nous ne pûmes nous empêcher de remarquer que nos costumes de toile blanche nous donnaient à tous les trois un air autrement cossu. Nous pouvions passer pour les chefs de la troupe, d'autant mieux qu'un officier d'habillement nous enleva nos bérets au passage, et les remplaça par trois chapeaux de paille qui venaient certainement d'en face, car c'était bien sur une dune déserte de l'isthme de Panama que nous abordions à la muette, comme des gens qui vont commettre un mauvais coup.
Seuls les Chinois n'étaient pas maquillés. C'eût été se donner une peine inutile.
Wami, passant auprès de nous, sortit de sa poche une carte du pays et nous la remit en nous invitant à l'étudier, dans notre intérêt.
C'était une carte de l'isthme. Les noms y étaient imprimés en caractères plus ou moins romains, mais l'échelle était de belle dimension et la lecture des plus faciles, en dépit de fautes grossières dans la typographie.
Nous n'avions pas besoin de nous concerter pour tomber d'accord sur le caractère offensif et sournois de ce voyage. Il était clair que nous allions à quelque coup de main. Contre qui? Contre quoi?
Le dénombrement approximatif des marins japonais mis à terre nous donna trois officiers et vingt cinq sous-officiers ou matelots.
Les cent Chinois amenés de Frisco (1) serviraient évidemment de coulies pour monter les bagages et tout l'attirail de la mission dans l'intérieur du pays.
(1) Nom familier que les Américains donnent à San Francisco, pour abréger.
On était au 6 décembre, en plein été panamien. Pigeon consentit, en dépit de la tristesse du moment, à nous renseigner sur cette anomalie apparente.
Dans l'isthme, comme dans les autres pays intertropicaux, l'année se partage en deux saisons bien distinctes: l'été (verano) ou saison sèche, et l'hiver ou saison pluvieuse.
Les pluies commencent en mai pour durer jusqu'à la fin de novembre, avec, aux environs de la Saint-Jean, un répit de quelques jours appelé le verantito. La belle saison s'inaugure en décembre, par un régime de vents du Nord, et se prolonge jusqu'à la fin d'avril.
Nous arrivions donc au début de la saison sèche. Cette constatation me fit plaisir.
Quel que fût le rôle que notre persécuteur allait nous imposer il serait toujours préférable pour vivre en plein air, des jours ou des semaines peut-être, de n'être pas mouillés.
Au demeurant une campagne comme celle que nous allions entreprendre n'eût pas été possible pendant la saison diluvienne. Le hasard servait done bien les desseins de nos Japs, pour commencer.
Il était près de midi. Un soleil brûlant, déjà insupportable, dardait ses rayons sur la longue bande de terre jaunâtre qui s'étend du Pacifique à la Cordillière dont nous apercevions les bosses accentuées dans le lointain. On dressa des tentes. Seuls les Chinois restèrent en plein soleil, accroupis dans le sable.
Les officiers tenaient conseil.
La distribution du riz fut faite, comme chaque jour. L'ordre de se mettre en marche n'allait pas tarder à venir, car ce n'était pas ce rivage qui nous attirait. Le but était incontestablement plus loin.
J'appréciai vite les qualités de Will Keog. Il était au surplus impossible qu'un inventeur de sa valeur ne fût pas attentif aux moindres choses. Comme nous n'avions pas encore eu le temps de causer depuis San-Francisco, qu'il m'avait fait si brusquement quitter, on profita de la pause pour lier connaissance.
A distance égale des escouades japonaises et des Chinois, c'est-à-dire à cent mètres des unes et des autres, nous l'écoutâmes nous donner, sous un méchant carré d'étoffe, des nouvelles de M. Martin du Bois et de la guerre.
Depuis quinze jours étions-nous assez sevrés de renseignements!
Le directeur de l'An 2000 était arrivé, comme nous le savions déjà, dans l'île de Vancouver avec la résolution de nous faire enlever. Il avait fait marché avec Will Keog, sans ambages, comme si je n'eusse pas été, moi, sur son Austral, le meurtrier de Jim.
— La guerre est la guerre, dit l'Américain avec philosophie, et les affaires sont les affaires. M. Martin du Bois m'a promis un million si je vous ramenais à Vancouver. Je n'ai pas gagné, tant pis pour moi. Au surplus la manoeuvre coïncidait avec une attaque d'ensemble qui n'a pas été si mauvaise. Vous verrez que bientôt nos aéroplanes feront parler d'eux.
— Et l'Europe? demandai-je d'une voix prudente.
— L'Europe? répondit de même le Hibou de l'Océan. Elle est en route. Aux dernières dépêches, ces jours-ci, les quatre flottes de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne et de la Russie, en tout cent cinquante navires de premier ordre, suivis de deux cents transports chargés de troupes devaient se réunir à l'entrée de la Manche pour se diriger en masse vers le Japon et la Chine. A propos vous ne savez pas qu'il y a depuis quelques jours une république, en Chine?
— En Chine? ne put s'empêcher de demander Pigeon, soulevé sur son séant par cette nouvelle singulière. En Chine? Il y a une république? Il y a maintenant une république chinoise?
— Je crois même qu'il y en a plusieurs.
— Cela vaudrait mieux pour nous, marmottai-je.
— Sous réserve d'une confirmation que nous aurons bientôt, gentlemen, le parti des réformes a décrété là-bas l'abolition de la monarchie. Et ce n'est pas à l'Europe que ces Chinois républicains vont offrir leurs quarante millions de soldats, vous le pensez bien. Ils les ont mis dans la main des Japs. Ceux-ci les traitent comme des esclaves; mais ils marchent, c'est l'essentiel. Contre cette union, contre cette fusion de deux forces sans parler d'une troisième, celle de l'Inde, l'Europe repentie fait bloc aujourd'hui. C'est à cette union qu'elle va porter le coup décisif.
— Et pour aller là-bas, les flottes alliées vont prendre la route la plus courte.
— Naturellement.
— C'est-à-dire le canal de Panama.
— Autrement à quoi servirait de l'avoir ouvert, ce canal superbe, voilà vingt-deux ans déjà, au trafic des deux mondes? C'est là encore une belle oeuvre à l'actif de l'oncle Sam...
Pigeon nous saisit le bras à tous d'eux, puis après un silence, déclara, comme si une idée subite l'eût éclairé:
— J'y suis!
— Et moi donc? fit le Hibou. Nous y sommes tous les trois.
Je confirmai par un signe de tête. Les Japs nous amenaient avec eux là, c'était clair, pour manigancer contre les flottes, à leur passage dans le canal, quelqu'un de ces coups sournois dont ils ont le secret... C'était l'évidence même.
Mais la pause prenait fin. Un gradé, qui me parut être désigné pour surveiller spécialement nos trois personnes, vint nous commander en anglais de plier la tente et de le suivre, nos effets de couchage sur le dos.
— Va-t-on nous faire porter aussi des caisses, demandai-je en maugréant, comme aux coulies?
Nous étions assimilés aux matelots. On nous fit la grâce de ne point nous charger trop pour commencer ce voyage vers l'inconnu.
Alignés à côté des Japs, entre les deux sections de l'expédition, nous regardions les fourriers de la caravane objurguer les cent Chinois.
Ceux-ci, au moment où nous allions comparaître une fois de plus devant les trois officiers, méconnaissables sous leurs déguisements, faisaient entendre un vacarme de protestations qui chez d'autres humains eût présagé une révolte. Mais cent coulies chinois, sous le bambou de trois officiers japonais seront-ils jamais capables de se révolter?
— Au demeurant, ceux-ci ne se révoltent pas, nous dit Will Keog, qui entendait quelques bribes de leur langage. Ils disent leur effroi.
— Leur effroi?
— Oui. Les Japs les ont embarqués à San-Francisco de force, raconte l'orateur qui les excite — voyez-le là-bas, ce grand... — pour travailler dans l'isthme de Panama. Le même les adjure — dans une espèce d'aboiement qui ne vous dit rien, mais que je comprends à demi-mot — de ne pas obéir. Cent mille Chinois, dit-il, sinon cent cinquante mille et davantage, sont morts de misère et de maladie, sur cette terre maudite, depuis le jour où les gens de Fa eurent les premiers l'idée d'y creuser un canal. Ils ont été punis d'être venus car beaucoup de ceux qui ne sont pas morts de leur mal se sont pendus aux branches des arbres. La première forêt qu'on va rencontrer est pleine de leurs fantômes. Ecoutez-les... Des entrailles de la forêt sortent les mauvais esprits.
Les Chinois imitaient à l'envi des plaintes macabres, levaient les bras, gloussaient comme aux jours de deuil.
Les officiers japonais s'étaient dirigés vers la cohorte récalcitrante, mais ni leurs menaces, ni leurs promesses n'avaient pu fléchir la résolution des Célestes.
La transformation de leurs maîtres en vulgaires boys ou en flibustiers panamiens avait aussi porté quelque atteinte au prestige des Japs.
Aussitôt les télégraphistes de l'expédition firent des signaux à bras pour demander des ordres au croiseur. Ce fut pour les Chinois l'équivalent d'un arrêt de mort.
— Plutôt que de faire un seul pas sur cette terre maudite, nous traduisit Will Keog, ils ont décidé de se noyer en masse. Et tenez, tenez! Voici qu'ils mettent leur projet à exécution. Quels drôles de corps!
En effet, nous eûmes bientôt devant les yeux ce spectacle auquel je n'eusse jamais voulu croire si quelque voyageur me l'eût décrit: les cent Chinois, résolus à se donner la mort plutôt que de s'exposer dans l'isthme aux maléfices des esprits qui ne cessent d'y persécuter les vivants jusqu'à ce que ceux-ci deviennent des morts à leur tour, entrèrent dans la mer comme un seul homme et marchèrent droit devant eux, vers le large, en poussant des hurlements de résignation, jusqu'à ce qu'ils perdissent pied.
Personne ne se préoccupant de leur porter secours — ils étaient trop — nous eûmes devant les yeux ces cent agonies, comme aux premières places d'un théâtre.

Avec une stupéfiante indifférence les cent Chinois entrèrent
dans l'eau comme un seul homme, et s'y noyèrent. (Page 595.)
Les uns coulèrent à pic, les autres surnagèrent, un bras en l'air, ou les deux, pour n'être pas tentés de regagner la terre à la nage.
De leurs gosiers sortaient des cris rauques qui me faisaient songer assez sottement aux otaries du Jardin d'acclimatation.
En quelques minutes ces cent hommes, entrés dans l'eau comme pour y prendre un bain, n'étaient plus que des cadavres au visage convulsé, boursouflé, que les lames, de petites lames courtes, ramenaient déjà au rivage avec une parfaite régularité, car la mer montait.
Du navire on avait vu l'horrible scène. Plusieurs canots arrivèrent en toute hâte, amenant des officiers.
Après un rapide conseil de guerre ils regagnaient leur bord, et l'expédition s'installait à nouveau sous les tentes pour y passer la nuit, tandis qu'une escouade de débrouillards allait recruter des porteurs indigènes dans les cases, ranchos ou misérables tambos des environs.
Le gradé nous conduisit à la tente des officiers. Là le commandant, méconnaissable sous l'accoutrement d'un vieux vaquero ou bouvier, nous fit entendre devant Wami, grimé en négrillon (c'était décidément sa spécialité) que pour la sécurité de la caravane on nous attribuerait à nous, les blancs, un triple rôle de chefs.
— Nous allons accomplir dans les montagnes, au delà de la forêt vierge qui commence à peu de distance d'ici, une oeuvre de défense personnelle qui vous frappera d'admiration, et qui ennuiera beaucoup vos pareils. Je vous informe que pour faciliter l'exécution de nos projets, nous avons décidé de vous faire passer, aux yeux de tous, pour trois Yankees prospecteurs de mines. Il y a, dans une zone assez rapprochée de ce rivage, des mines d'émeraude. Vous êtes venus, direz-vous, avec des porteurs, des domestiques originaires de tous pays. J'espère que vous m'avez compris. Vous êtes nos chefs, censément pour découvrir quelque part dans l'isthme, entre la côte et Alhajuela — vous examinerez ce point sur la carte — des gisements de nature diverse; au besoin vous serez intéressés, l'un ou l'autre, dans une affaire de reboisement des forêts par l'arbre à caoutchouc, qui a été saccagé depuis trop d'années. Si quelque espion des Yankees, ou par extraordinaire une colonne volante détachée des troupes qui gardent les bords du canal se permettait de discuter la présence de Japonais dans cette région, empressez-vous de démontrer l'absurdité d'un soupçon de ce genre. Vous êtes Américains tous les trois. Vous êtes les organisateurs d'une expédition minière et industrielle, extra-pacifique. Les Asiatiques qui travaillent avec vous ne sont pas Japonais, mais Siamois, Annamites, Chinois même. Au surplus, depuis trente années tant de nos concitoyens ont su pénétrer ces forêts et ces savanes comme ils pénétreront à la longue l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud que nous pouvons être à votre service depuis longtemps; vous nous connaissez; nous sommes de braves gens qui gagnons notre vie en trochant (1) pour votre compte, et c'est tout.
(1) Trocher, créer un chemin à travers la forêt vierge, de rocha qui signifie creux, trou, brèche, en espagnol.
Le commandant, après une pause, ajouta:
— Je connais ce pays aussi bien que le Japon. J'y ai passé dix-huit mois voilà vingt-cinq ans, de 1914 à 1915, tandis que les Américains achevaient de creuser leur canal, qui deviendra le nôtre. C'est vous dire que je suis là pour donner à l'expédition la direction qu'il convient. Si les circonstances l'exigent, on vous fera part de mes décisions et vous devrez les communiquer à qui de droit, comme émanant de vous. Retenez que vous êtes soi-disant les maîtres, et que nous sommes, nous, les serviteurs. Enfin, à la moindre tentative que vous pourriez faire pour nous trahir, la mort.
Sans nous demander même un acquiescement, le vieux vaquero nous congédia.
On nous reconduisit sous la tente et à partir de ce moment nous eûmes toute liberté pour aller et venir dans le camp.
Situation singulière, on en conviendra, qui nous exposait à des quiproquos dont la solution pourrait être risible à l'occasion, tragique aussi.
Longtemps nous restâmes accroupis, à regarder le va-et-vient des embarcations du croiseur. Chacun de nous poussait des soupirs qui ne finissaient pas. Le rôle que les Japs nous donnaient à jouer dans cette comédie audacieuse nous inquiétait au delà de toute expression. Chacun de nous eut vite exprimé le désir qu'il formait de se tirer de là. Mais par quel moyen? Et que faire si les circonstances voulaient que nous fussions amenés à couvrir ces Jaunes de notre peau blanche, comme disait Pigeon?
Car enfin ce n'était pas autre chose que cela, leur combinaison! Ils s'abritaient derrière trois blancs qu'on n'irait pas suspecter en cas d'aventure.

Pour sauver les apparences, c'est nous qui
devenons les chefs. Amère ironie! (Page 595.)
— Croyez-vous qu'ils ont des aptitudes pour les coups de ce genre! dis-je à mon tour. Prendre ainsi des habits de domestiques, des caleçons de nègres et de métis! Jamais un blanc ne descendrait aussi bas. Voilà pourquoi ils tenaient tant à nous emmener! Il leur fallait deux ou trois blancs pour sauver la face. C'est nous qui couvrons leur marchandise!
Si ingénieux que nous fussions, nul de nous ne pouvait imaginer ce qui allait se passer.
Avec un peu de ce fatalisme qui nous envahit quand la malchance nous persécute, chacun se mit à fumer de mauvais cigares, offerts par l'intendance japonaise; car nous n'avions pas un sou à nous trois pour en acheter. Au surplus le plus proche débit de tabac était loin.
La nuit s'écoula sans incidents. Les canots du bord nous avaient amené des sentinelles qui firent bonne garde sur les bagages.
Par exemple au petit jour le Saïtama reprenait le large, après avoir salué la mission de son pavillon blanc à lune rouge, hissé et redescendu trois fois.
Des kyrielles de porteurs indigènes nous arrivaient de l'intérieur, avec les recruteurs qui nous avaient quittés la veille.
C'étaient des noirs, des rouges, des demi-rouges, des demi-jaunes, toute une exposition des races inférieures, dit Pigeon: enfants d'esclaves marrons, nègres, croisements d'Indiens et de mulâtres, métis de Blancs, d'Hindous, de ces Chinois mêmes qui étaient venus chaque année travailler au canal et mourir sur la place, pioche en mains.

C'était l'évident prélude d'une expédition (Page 591.)
Will Keog entama tout de suite la conversation avec quelques-uns de ces clients. C'est qu'il parlait admirablement le jargon d'origine espagnole qu'on emploie dans l'isthme de Panama.
— Une vraie collection de bonshommes en biscuit, n'est-ce pas? Il y a bien peu de sang bleu dans tout cela, mais il y en a encore. Voyez ceux-ci, avec leurs cheveux lisses et fins. Ce sont des Cholos, des aristocrates; aux racines de leur arbre généalogique il y a des Blancs, ou des Blanches. Voici maintenant la monnaie courante du pays: messieurs les Zambos, fils des Colorados ou Pardos, que nous appellerons tout simplement des nègres, entre nous, parce que si nous qualifions ainsi ces citoyens, ça les fâche... Il y a dans le Zambo du nègre et de l'Indienne rouge du Pérou, parfois de l'olivâtre du Chiriqui. Voyez ceux qui sont les plus grands, ce sont des Indiens Dô. Considérez ceux qui sont moins grands, ce sont des Indiens Ti.
Pigeon, cette fois, avait trouvé son maître.
— J'ai étudié, moi aussi, le canal, dit Keog, sans m'écarter de sa ligne à peu près droite, voilà déjà quelques années. C'est aujourd'hui une espèce de pèlerinage pour les Américains. On s'amuse à faire le tour: Colon, Panama, Vancouver, Niagara-Falls, New-York. J'ai donc un peu fréquenté ce peuple-là. Ce sont des doux, des faibles même. Vous allez les voir à l'oeuvre. Ils sont d'une politesse gênante. Ils disent toujours oui parce qu'ils n'ont aucune volonté. Le bonze le sait bien.
Keog désignait ainsi le vieux commandant, dont le nom exact était, je le sus bientôt: Sakatani Yochiro.
Il nous arrivait ainsi plus de deux cents porteurs indigènes, pour remplacer les cent Chinois dont nos Japs avaient trop escompté la docilité.
Le bonze nous fit dire de les embaucher tous à des conditions ridicules de bon marché. Mais ils se contentent encore de peu dans ce pays-là, pourvu qu'à l'étape on leur distribue la ration d'anisado dont ils meurent chaque jour.
D'un commun accord, nous décidâmes, sous réserves pour l'avenir, bien entendu, que le rôle de chef suprême de l'aventure serait dévolu à Will Keog. D'abord il était de sang américain, ce qui entrait bien dans le programme; de plus il connaissait le pays; il en parlait la langue, et puis c'était quelqu'un. Je ne voyais guère Pigeon, non plus que moi-même au premier plan dans cette parade.
Nous décidâmes donc de jouer les comparses, et Keog accepta d'humeur assez joviale l'honneur que nous lui décernions. J'en informai le vaquero, qui acquiesça.
Wami ayant dicté à notre Américain les conditions qu'il convenait de faire aux porteurs, celui-ci organisa une sorte de palabre où il nous stupéfia par sa faconde.
A la manière des demi-sauvages qu'il avait devant lui, on le vit bavarder à perte de vue pour fixer les conditions, obtenir des rabais, bref instituer ces contrats verbaux en vertu desquels on peut compter à demi sur des hommes qu'on engage aux pays intertropicaux.
Tout étant réglé, les Japs prirent chacun un poste dans la caravane. Ils groupèrent les porteurs par sept et huit, et l'on partit.
Le commandant, bouvier sans boeufs, s'occupait plus spécialement d'un lot de caisses où devaient se trouver quelques objets plus précieux que le reste, ou plus dangereux, car il ne quittait pas des yeux son lot de bagages.
Nous avions repéré notre point de départ sur la carte au bord du Rio Matias Hernandez, qui se jette dans le Pacifique à quelques kilomètres à l'Est du vieux Panama, un tas de ruines assez éloigné de la grande ville moderne où aboutit le majestueux canal inauguré en 1915.
Notre direction était au Nord, avec pour objectif, dans deux jours ou trois, la traversée de l'antique route pavée par les Espagnols, qui relie, plutôt mal que bien, Panama à Porto-Bello, sur l'Atlantique.
Ensuite? Mystère.
Nous devions nous contenter de ces données premières, mais il ne nous fut pas malaisé de deviner. Nous montions droit vers la vallée du Chagres, le fleuve capricieux dont les Américains ont fait, avec beaucoup d'argent, de travail et de temps, le régulateur indispensable de leur canal à écluses.
L'isthme ne mesure pas soixante kilomètres. Le cours supérieur du Chagres occupe à peu près une ligne médiane qui va du Sud au Nord. Nous l'atteindrions donc en franchissant trente kilomètres environ.
C'eût été peu de chose que trente kilomètres sur une bonne route de France, bien entretenue par nos cantonniers, voire le long des sentiers ombreux qui serpentent dans nos Vosges ou dans notre Morvan. Mais en pleine forêt vierge, il fallait compter sur une marche très lente.
Keog estima que la montée, par des sentes que nous devrions ouvrir en trochant, la machete à la main, prendrait au moins cinq ou six jours. Il ne se trompait guère.
Le soleil était déjà haut lorsque la caravane se mit en route.
Yochiro marchait en avant, avec trois de ses marins déguisés.
Douze indigènes portaient les caisses auxquelles il tenait tant.
La masse des mercenaires suivait, flanquée de Japonais accoutrés de toutes les manières. Nous fermions le cortège avec Wami et le médecin, qui s'était affublé de hardes dépenaillées comme un peon sans place.
Courbés sous nos paquetages, nous avancions dans la savane. Elle n'avait guère sur ce point que trois kilomètres de large. La vue s'égarait au loin sur un chaos de mamelons verdoyants, pas très hauts, mais innombrables.
Dès qu'on abandonna les terres du littoral, après une ascension douce, la forêt vierge commença. Il était temps pour nos corps trempés de sueur, car jusqu'alors nous avions marché en plein soleil.
On fit une halte prudente de quelques minutes, avant de pénétrer dans les halliers qui depuis le commencement du monde s'enchevêtraient là, sur quinze ou vingt kilomètres de profondeur peut-être.
Il ne fallait pas être grand clerc pour se rappeler que les Espagnols n'ont jamais pu rien faire de pratique ni d'utile sur ce continent que d'audacieux navigateurs avaient livré à leur rapacité.
Territoires de Panama, de Colombie, de la Nouvelle-Grenade, du Mexique, et tant d'autres! Autant de conquêtes lamentablement compromises et gâchées!
Dans cet isthme où l'impérieux besoin de réunir l'un à l'autre deux océans eût dû provoquer la création de dix routes pour une entre l'Atlantique et le Pacifique, les Espagnols avaient trouvé tout juste le moyen de tracer et de paver la misérable chaussée qui va de Panama jusqu'à Porto-Bello. Et c'était tout.
Pour le reste les vestiges de leur incapacité colonisatrice demeuraient sous nos yeux tels que les avaient constatés avant nous maints explorateurs venus d'Europe, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, lorsqu'on étudiait le percement de ce canal, acquis enfin au commerce depuis 1915 par la ténacité yankee!
En m'épongeant le front, je ne pus m'empêcher de dire à Pigeon toute ma surprise de faire ainsi halte en sa compagnie à l'orée d'une forêt vierge.
— L'eusses-tu cru? m'écriai-je en posant mon ballot sur l'herbe.
J'avoue que cette calembredaine me parut aussitôt déplacée.
Le Hibou n'avait pas compris, mais Pigeon, comme s'il eût été inquiet pour la marche rationnelle de mes idées, me regarda en homme étonné.
Je m'en voulais déjà d'avoir été si léger, sans m'expliquer comment mon esprit s'était à ce point écarté des préoccupations graves qui le poursuivaient. Et elles ne manquaient pas. Pour me replacer sous leur immédiate influence il me suffisait de regarder ce négrillon et ce valet d'écurie aux yeux fendus en amande, qui fumaient des cigarettes à côté de nous.
Dire que nous étions leurs victimes et que pour la galerie, si l'on venait à rencontrer une « galerie » dans la forêt vierge, nous devions être soi-disant leurs chefs, ce qui les délivrait d'un gros souci et nous en accablait à leur place!
Il pouvait être dix heures du matin au méridien de Panama lorsque la caravane entra dans la forêt vierge.
Pour Pigeon et moi, qui n'avions jamais rien vu de semblable, ce spectacle apparut comme une évocation grandiose des âges rudimentaires du monde.
Nous entrions pour la première fois de notre vie dans un de ces temples gigantesques de la nature où l'homme ne parvient à passer que s'il est en nombre, patient et bien armé, pour l'attaque des végétaux et pour la défense contre les bêtes.
Yochiro, en tête de notre petite légion, faisait trocher par ses Japs et trochait lui-même à coups de « machete », dans les lianes, les fourrés, les branches basses des arbres, les plus hauts que nous eussions jamais vus.
D'innombrables arbustes s'abritaient à l'ombre de leurs bois géants. Par poussées convulsives les parasites envahissaient tout, reliaient ensemble les arbrisseaux et les essences séculaires. Le soleil était incapable de percer le feuillage épais qui demeure sur les végétaux, en ces ténèbres, d'un bout de l'année à l'autre.
Nous avions reçu au départ chacun notre machete, et Wami, de ce ton rogue qu'il affectait avec moi depuis les derniers événements, nous invita sans autres explications à en jouer comme les camarades.
Jusqu'à midi nous avançâmes ainsi péniblement, en faisant chacun sa part de la trocha.
Les porteurs, surveillés par les marins japonais, levaient les bras avec précaution, car il fallait éviter la chute de leurs colis. L'extraordinaire sollicitude que les convoyeurs portaient à ces caisses de toute forme et de tout poids nous eussent indiqué suffisamment ce qu'elles contenaient, si nous ne l'eussions deviné dès le départ.
Ce n'est pas un métier pour un écrivain, si modeste soit-il, que de trocher sans repos pendant des heures à portée de sa main, pour se frayer une voie de quelques centimètres à travers les enchevêtrements monstrueux de végétaux qui dorment en de pareilles solitudes depuis que le monde est monde! Et pourtant, si dure que fût la besogne, nous trouvions à sa nouveauté un charme qui nous faisait oublier pendant quelques quarts d'heure notre triste sort.
C'était autant de gagné.
Des oiseaux bizarres s'effarouchent à notre approche; des troupes de singes effrontés jouent dans la verdure, se suspendent par leurs queues entrelacées, « comme au Jardin des Plantes » dit Pigeon, qui pourrait dire tout le contraire pour respecter la vérité; mais c'est une habitude que nous prenons aisément de tout rapporter aux spectacles factices dont notre enfance de petits civilisés a été bercée, voire lorsque nous nous trouvons en face des manifestations mêmes de la nature, qu'ils essaient de traduire en raccourci.
De-ci de-là, nous remontons un cours d'eau étroit et peu profond. Ce sont des rigoles qui descendent des sommets à notre encontre, pour s'aller jeter derrière nous dans le rio Matias Hernandez.
On les franchit sur de grosses pierres que le bonze et ses pionniers ont placées en travers. La fraîcheur de la forêt est délicieuse. Pour nous qui venons les derniers, le spectacle en est enchanteur, car nous n'avons plus grand'chose à faire. Ceux qui nous précédaient ont troché tant et plus et le tunnel de verdure noire est à peu près ouvert devant nous.
Will Keog nous explique, en sa qualité de descendant des trappeurs de l'Arkansas, que Yochiro donne d'abord l'alignement à ses hommes en faisant des moulinets dans la direction qu'il croit la bonne, d'après ses instruments de repère et ses souvenirs. Derrière les premiers on élargit à droite et à gauche en taillant et en poussant de côté les abatis par trop volumineux. Puis ce sont des haches qui complètent le travail principal. D'autres haches coupent les chusos dangereux.
Et il nous montre des chusos oubliés par ceux qui ont passé avant nous dans le sentier. Ce sont des bouts de tige longs de trente à quarante centimètres qui restent taillés en bec de sifflet par les macheteros. Ils sont excessivement pointus et dangereux.
Avec une fantaisie de brute, l'un des nègres qui nous précèdent vient justement de pousser son voisin vers un chuso.
L'homme a fléchi devant la bourrade et s'est entré dans le flanc la tige pointue, une véritable aiguille. Sous la douleur, il a crié, lâchant sa charge qui tombe brutalement à ses pieds.
Encore que ce soit sur un tapis de mousse et de feuilles sèches, le choc détermine une explosion révélatrice.
Un fracas épouvantable se répercute au loin sous les grands arbres. Jamais les hôtes de ces bois n'en ont ouï de pareil. Aussi les battements d'ailes, les cris d'angoisse des oiseaux et des quadrumanes se mêlent-ils aux rugissements des jaguars, dont nous ne soupçonnions guère la présence autour de nous.
Toute cette arche de Noé s'enfuit avec des cacophonies effarantes. Ce qui nous gêne peu; mais nos porteurs semblent disposés à imiter cette envolée, ce qui gênerait davantage les Japonais.
La colonne fait halte. On recense les morts et les blessés. Il n'y a que des hérons et des lamantins, tués par la surprise, peut-être. Pigeon prétend que ce sont là des choses qui se voient. Le principal est qu'il n'y ait personne d'atteint dans la caravane.
Wami invite brièvement le Hibou à se montrer. Et Will Keog, pour ses débuts dans le rôle de chef de l'expédition, ne se tire pas trop mal d'affaire. Avec une solide baguette il corrige les mollets du nègre fautif, puis s'étant assuré que le blessé n'a guère qu'une forte piqûre, il donne au médecin l'ordre de s'occuper de lui jusqu'à la clairière voisine, où le camp sera formé pour un repos de deux heures.
Ce sera la halte de midi.
On distribue le riz et chacun se prépare à faire la sieste sous la tente, ou bien sous les grands arbres qui bordent la place verte que le soleil inonde de rayons brûlants.
— Un somme dans le paradis terrestre, dis-je à Pigeon. Voilà qui nous fera du bien!
Hélas! nous ne tardons pas à déchanter.
Comme la chaleur est devenue étouffante, chacun s'est étendu sur les feuilles mortes sans prendre la peine d'organiser une protection suffisante contre les insectes.
Dix minutes ne se sont pas écoulées que notre réveil est simultané. Pigeon pousse de sourdes exclamations, Will Keog jure abominablement, et je me gratte en silence...
C'est que toutes les variétés de bestioles carnivores peuplent par milliards la forêt vierge; et elles nous le font bien voir.
Keog, qui les connaît à peu près de nom, les interpelle au passage:
— Sales jejenos! Ignobles tabanos, alus, congos, zancuos!
Que sais-je encore? Peu m'importe leurs noms au surplus. Je les vois et je les sens, cela me suffit.
Elles galopent avec des pattes hideuses, des ventres visqueux, des antennes menaçantes, des dards inquiétants. Et comme elles n'ont pas peur des hommes, n'en ayant sans doute jamais vu, elles opèrent sur notre peau, sous nos habits, avec une extraordinaire audace.
Un nègre accourt vers nous, affolé. Il implore les grands chefs blancs pour qu'on lui sorte du nez un gusano. L'affreuse bête qui vient de s'introduire dans sa fosse nasale peut être une femelle. Alors c'est la ponte de ses oeufs certaine, les pires souffrances et la mort. Il dit cela, le pauvre diable, en tremblant de tous ses membres, car il sait que c'est la vérité.
Keog, olympien, l'envoie d'un geste au major déguisé en peon:
— Soignez cet homme au lieu de ronfler, dit-il assez drôlement au médecin japonais.
Et l'autre s'exécute.
— Faut-il être cruel pour exposer des gens à dormir dans ce concert de sales bêtes sans leur fournir des moustiquaires! ronchonnait Pigeon.
Je regardai Wami et les autres Japs. Il fallut bien reconnaître qu'ils se passaient parfaitement de ce tutélaire appareil, de même que les porteurs autochtones.
J'en conclus que les peaux bistrées et foncées sont moins alléchantes que les nôtres pour les moustiques, puces des tropiques, garapates suceurs de doigts de pied, et autres malfaisants insectes de la forêt vierge.
Le sommeil pourtant nous accablait. La vue des porteurs noirs, rouges, et des autres colorados qui dormaient auprès de leurs charges, nous décida sans doute à faire un effort de volonté.
Enfouis sous nos couvertures de cotonnade, bien qu'il fit en cette clairière trente degrés de chaleur, nous avions enfin trouvé l'inconscience réparatrice lorsque le plus désagréable des incidents nous procura un affreux réveil.
Il me semblait entendre siffler un air, mais un drôle d'air, un air inconnu de nos pays.
J'ouvre les yeux en appelant Pigeon, comme si j'eusse été en danger ou en plein cauchemar.
Horreur! A quelques pas de moi se déroulaient les anneaux d'un énorme reptile, tacheté de dessins noirs et jaunes, dont la vue nous fait dresser les cheveux sur la tête.
Je deviens algide, tant ma frayeur est subite et complète. Je regarde Pigeon; il est exsangue, et se demande s'il doit s'enfuir ou rester cloué sur son lit de feuilles mortes, prêt à périr entortillé.
Ce qui me rassure aussitôt, c'est que dans la clairière personne n'a bougé.
Les porteurs continuent à reposer. Un seul homme de la caravane ne dort pas; c'est Will Keog. C'est lui qui siffle. Il siffle le serpent et l'emmène à la cantonade avec un sang-froid que j'admire.
Le hideux animal, dont les anneaux se déroulent sur quatre mètres, dresse sa tête féroce et découvre ses crocs à venin. Ses petits yeux brillent comme des diamants.
Il lui suffirait de développer le premier de ses anneaux pour atteindre le Hibou, le broyer et en faire une lamentable bouillie.
Mais non. Tout en sifflant son air au crotale qui le suit, Will Keog s'interrompt dix fois, pour nous hacher des bribes de connaissances à lui spéciales, que tout le monde semble posséder du reste, dans cette clairière, où l'on persiste à dormir à côté d'un semblable voisin.
Si venimeux que soient les serpents dans ce pays, paraît-il, on ne les redoute guère. Ils ne seraient à craindre, d'après notre charmeur, que si quelqu'un leur marchait sur le milieu du corps, et d'un pied par trop lourd.
— Autrement, dit-il, ils préfèrent se retirer dans leurs trous quand une caravane d'humains en voyage les a dérangés de leur sommeil. Un petit air de musique, et ils suivent le musicien. Voyez!
En effet, l'Américain eut bientôt emmené son serpent à l'autre bout de la clairière, où il le perdit.
Mais cette apparition nous avait, comme on pense, ôté toute envie d'essayer un nouveau somme.
Au surplus il était deux heures.
On repartait pour gagner Jioyo, le village où les racoleurs étaient venus embaucher la veille ce monde multicolore de porteurs et de macheteros.

Toujours sifflant, il entraîna le serpent
à l'autre bout de la clairière. (Page 601.)
L'ordre de ce second départ ne fut pas donné sans que le commandant eût fait, avec Wami, un tour d'inspection — rien n'y parut, cela va de soi — à travers les divers groupes de la colonne.
Les deux cents porteurs indigènes, sortis des savanes environnantes et du village proche à présent, pour bénéficier de l'aubaine inattendue, s'étaient augmentés de tout un régiment de femmes et de marmailles venues de Jioyo, le village en question, pour voir plus vite les Blancs qui faisaient en aussi nombreux équipage leur entrée dans ce pays abandonné.
La troupe féminine s'intercala par familles dans les rangs de l'autre, d'après les degrés de la parenté.
Nous avions devant nous, à l'arrière-garde, sept ou huit spécimens de femmes cocasses — nul autre mot ne rendrait mon impression — et autant de gringalets pitoyables qui nous donnèrent une piètre idée de la beauté panamienne, de celle tout au moins qui s'étiole à l'ombre des quippos séculaires, dans les forêts inexploitées de l'isthme.
Ces malheureuses, des Zambas, à ce qu'elles dirent complaisamment au Hibou, n'avaient pas plus de vingt et vingt-deux ans chacune, et cependant elles étaient déformées, pansues, affreuses à voir, « hippopotamesques », murmurait Pigeon.
Moricaudes du plus beau noir, elles nous firent l'effet de se rapprocher plutôt de l'animal que de la femme, telle que nos yeux sont accoutumés à la considérer.
Elles suivaient leurs hommes assez gaiement, échangéant avec les porteurs, qui parfois pliaient sous leurs charges, des lazzis dont le sel devait être piquant, si nous en jugions par le rire général qui les accueillait.
Mais c'était en langue zamba, corruption trop dégénérée de l'espagnol américain pour que le Hibou, malgré toute son attention, pût y comprendre grand'chose.
Néanmoins il se mêla, tant bien que mal, à la conversation. Et tout en machetant, nous aussi, nous nous laissâmes aller à tuer le temps à coups de mots d'esprit. Vous imaginez ceux qu'on pouvait faire en pareille circonstance.
Seuls Wami et le petit médecin, sur nos talons, ne disaient rien. C'était à peine s'ils échangeaient entre eux quelques observations à voix basse.
Le but du voyage, le terme de l'expédition, et surtout son succès, voilà évidemment ce qui préoccupait ces deux-là.
Je remarquai bien vite que les dames abusaient du tabac. Neuf sur dix fumaient de gros cigares, et chose à peine croyable, que Pigeon découvrit avec son oeil de lynx, elles les fumaient par le bout allumé!
Interrogées sur cette bizarrerie par Keog, les unes comme les autres firent la même réponse.
— C'est, dirent-elles, le seul moyen de trouver du goût au tabac.
Je me jurai à cette minute-là d'essayer, pour voir. Mais je crois bien que j'en resterai au serment platonique.
A peine vêtues d'une chemise rayée ou à pois, en vulgaire cotonnade, pieds nus et tête nue, ces grosses négresses avançaient le travail de la trocha en retenant les broussailles, les branches, les grosses ramures tandis que leurs mâles coupaient dans le tas.
D'autres soulageaient la main des porteurs en prenant la machete et en tailladant elles-mêmes; il importait que ce tunnel de verdure fût de dimension commode en prévision du retour, car les Japs n'allaient pas là-haut, bien sûr, vers les sources du Chagres, pour y faire une cure d'air.
Le temps d'exécuter le mauvais coup dont nous n'avions encore qu'une idée vague et ils redescendraient à la côte, où le Saïtama les guetterait à jour dit, dans deux ou trois semaines, plus tôt peut-être...
Ce fut au tour du Hibou de faire une constatation. A côté de ces femmes noires qui ne concevaient l'existence qu'avec un cigare allumé entre les lèvres, j'ai dit par quel bout, montaient moins allègrement de pauvres moutards, difformes aussi, par un point toujours le même: l'abdomen.
Presque tous souffraient de la hernie ombilicale, qui semble être la maladie caractérisée de ces mioches élevés sans hygiène.
Chargé par le médecin d'interroger les femmes là-dessus, notre pseudo-chef, interprète de l'arrière-garde, nous apprit que l'usage était chez ces malheureuses de considérer les neuf dixièmes des nouveau-nés comme incapables de vivre.
Epidémies, accidents par défaut de surveillance, insolations, toutes ces méchantes choses envoyées par le diable — car les Zambas se réclament d'une espèce de catholicisme élémentaire légué au pays par les Espagnols — détruisaient la plupart des enfants dès le premier âge.
Il était bien inutile de lutter.
Par exemple, — c'était là ce qu'avait remarqué Will Keog — les jeunes « rescapés » se lançaient dans la vie en fumant, eux aussi, des cigares, mais par le bout qui est le plus communément utilisé.
Nous approchâmes d'une jeune mère, fanée et devenue monstrueusement difforme, comme la plupart de ses pareilles.
Elle portait sur sa hanche son petit âgé de trois ou quatre ans, qui tétait encore à cet âge, suivant la coutume du pays.
Mais ce qui nous stupéfia ce fut cette autre coutume, à laquelle le môme paraissait s'adonner avec délices. Entre deux appels au sein maternel, il tirait comme un sourd, sur un « claro » que Mme sa mère achevait lorsqu'il avait assez fumé.
Alors elle lui rendait le sein, et tétait le cigare pour son compte.
Trois heures encore se passèrent. La fatigue commençait à se faire sentir, car la trocha montait toujours.
Heureusement que nous savions depuis midi où se trouvait exactement Jioyo. C'était un village important, de deux cents paillottes au moins, qui dominait un premier plateau, entre deux massifs de la forêt vierge, au bord d'un rio assez large qui coulait au Sud, vers le Matias Hernandez.
Aux grands cris poussés par les porteurs, leurs épouses et leurs fistons, nous comprîmes que l'étape touchait à sa fin.
Bientôt nous arrivions à ce Jioyo tant désiré.
Quelques familles seulement nous y attendaient, presque tous ses habitants ayant contracté l'engagement de porter nos colis depuis le bord de la mer jusqu'à deux jours de là.
Keog avait trouvé le moyen de faire un bout de route à côté d'un notable, lequel, tout courbé qu'il fût sous sa caisse, lui avait donné, d'intéressants détails.
On fit halte sur la place carrée, assez large, au milieu des paillottes de roseaux essaimées sans ordre sur un sol nu et poussiéreux, qui par la saison des pluies devait se transformer en un visqueux bourbier.
Les colis une fois déposés en bon ordre, des sentinelles furent placées autour. Bien entendu, aucune d'elles ne portait d'arme apparente.
— La danse de « sainte touche » va commencer, fit Pigeon en constatant l'effervescence des noirs et des gens d'autre couleur.
Yochiro vint en effet nous trouver; pour instructions il nous ordonna d'entrer dans une paillotte plus large et haute que celles de ces villageois. On eût pu la prendre pour l'hôtel de ville du lieu, ou son église. C'était simplement ce que les aubergistes de nos bourgs normands eussent appelé dans leur style:
Hôtel du Cheval Blanc, X... tient débit. Son et Avoine. Vins et Eaux-de-vie à emporter.
Dans cette gargote où cent personnes pouvaient s'enfermer à l'aise, nous trouvâmes un curieux individu.
C'était le plus déplaisant des aventuriers.
Mexicain ou Guatémalien, il était venu, nous dit-il quand nous nous présentâmes tous les trois à son comptoir, dix ans plus tôt dans cette forêt vierge pour y tenter les dernières opérations qu'on pût espérer encore sur le caoutchouc.
Il avait été longtemps cauchero, récolteur de gomme; puis s'était fixé à Jioyo, où nul débitant d'anisado n'avait risqué l'affaire avant lui, pour y délivrer contre argent aux Zambos et à leurs congénères la liqueur abrutissante qui a perdu l'Amérique centrale, comme l'absinthe perd aujourd'hui l'Europe.
Il vendait aussi d'autres denrées; bref il était l'unique négociant du lieu. C'était donc chez lui que la mission allait se fournir, lui dit Keog d'après les instructions du commandant.
S'il fut heureux, point n'est besoin de le demander. Dès qu'on tomba d'accord sur le prix de son flot de poison, le señor Pedro Blas, — tel était le nom du trafiquant — fit ranger les porteurs sur une file et commença la distribution.
Sous l'oeil des surveillants japonais, que Wami tenait en haleine par un va-et-vient incessant, les pots de tord-boyaux furent délivrés un à un, du premier jusqu'au cent quatre-vingt dix-septième. C'était le chiffre exact des engagés de la veille qui avaient travaillé. Chacun d'eux, tout en sueur, son pot à la main, s'en fut dans sa paillotte, et l'établissement se vida.
Il n'y resta bientôt plus que nous et nos maîtres, attablés sous leurs guenilles, au nombre de sept ou huit.
Le bonze redoutait pour la soirée des troubles dans le village, à la suite de l'absorption simultanée de tant d'anisado. Mais le señor Pedro Blas fit observer que ce serait surtout le lendemain, jour de la fête de l'Immaculée Conception, qu'il faudrait s'attendre à une crise générale d'ivrognerie.
A l'idée de rester tout un jour et encore une nuit à Jioyo, les Japonais parurent contrariés. Mais le señor débitant leur expliqua que rien au monde ne déciderait les gens du village à marcher le jour d'une aussi belle fête. Il fallut bien se résigner à rester là deux nuits.
On nous casa dans une paillotte abandonnée qui empestait.
Je parlai de coucher dehors; mes compagnons jugèrent que ce serait imprudent. Va donc pour la nuit là-dessous!
Toute la charpente assujettie au moyen de lianes; la toiture formée d'une épaisse couche de feuilles de palmier, une chambre, et à côté pour servir de cuisine, un carreau sur lequel il y a trois pierres et un chaudron de fonte; c'est le logis.
— Méfions-nous ici, nous dit Keog au moment où l'on s'étendit sur les couvertures, du scorpion et du lézard.
Mais la bête immonde dont il oublia de parler!
Abominable vision!
Dans la nuit je suis réveillé par des contacts indéfinissables, répugnants. Je porte la main à ma figure et j'y saisis un corps gluant, qui s'écrase en partie sous mes doigts.
Il est gros comme un gros oeuf de poule, à ce qu'il me semble.

Pouah! c'est une araignée grosse comme un rat. (Page 605.)
Mes ongles enfoncent dans cette chair d'où coule un liquide chaud, certainement du sang. Et toujours ma main subit les odieux attouchements qui m'ont réveillé.
Je frissonne d'épouvante. Je ne sais que dire tant j'appréhende.
— Alerte! Une lumière, vite!
Pigeon a des allumettes: il en flambe une qui éclaire subitement la pièce où nous sommes couchés.
Pouah! Trois cris d'indescriptible dégoût.
C'est une araignée grosse comme un rat!
Je rejetai l'ignoble bête. Elle se mit à courir.
Alors ce fut une chasse où chacun de nous se sentait si dégoûté qu'il n'osait allonger la main. Nous n'étions que deux à la poursuivre; Pigeon frottait sans cesse des allumettes. Finalement elle nous échappa.
Du coup je me levai pour prendre l'air. Mes deux compagnons me suivirent. Une ombre aussi nous suivit, dont nous ne voulûmes pas nous inquiéter. Nous pensions bien que nos geôliers nous tenaient à l'oeil.
La soirée était agréable, presque fraîche. Une lune superbe éclairait le plein ciel. Nous allâmes faire un tour de promenade, toujours suivis par notre surveillant, jusqu'au bord du rio. Il coulait, assez lent, dans une sorte de lagune.
La lumière lunaire donnait à ce paysage quelque chose de vaporeux qui nous fit une douce impression.
Mais bientôt tout changea. Quel ne fut pas notre stupeur en apercevant sur la grève, moins froide que l'eau, une douzaine d'alligators de dimensions énormes, qui dormaient là, chaque soir, nous dit le señor Pedro Blas quand nous l'eûmes réveillé pour lui demander des explications.
Et les hideux sauriens sommeillaient à vingt pas de nous, les mâchoires ouvertes, la supérieure presque verticale.
Le voisinage de ces camarades n'avait rien d'effrayant, nous dit le traitant en versant la rasade matinale, car le jour venait. Ils sont inoffensifs.

Ils dormaient la gueule ouverte, la mâchoire
supérieure à peu près verticale. (Page 605.)
— A la condition pourtant, ajouta-t-il en riant d'un rire équivoque, qu'on ne leur jette pas un animal à la tête, ou un bipède dans notre genre. Alors il faut voir la curée. Ça vaut le voyage du Japon jusqu'ici...
Nous allions boire, pour faire honneur à notre hôte. Le mot nous fit hésiter.
Alors clignant de l'oeil, le señor Pedro Blas dit, entre les dents:
— Croyez-vous donc qu'on soit né d'hier? Vous êtes autant des prospecteurs que je suis l'évêque de Panama. Vous venez avec ces Japs jouer un bon tour aux Yankees, par là-haut, pas vrai?...
Et comme nous faisions trois gestes de protestation, non sans regarder autour de nous si personne ne nous voyait, le débitant d'anisado poursuivit:
— Je ne vous ai rien dit, et vous ne me dites rien, señores. Une tournée encore, et parlons de la fête du jour...
Elle fut odieuse, la fête du jour. Dès le matin, sous prétexte de célébrer l'Immaculée Conception, tous les métis furent dans le village parfaitement ivres-morts.
L'après-midi, les noirs avaient leur compte. Et le soir, les consommateurs qui n'étaient pas restés sous les tables de Pedro Blas venaient cuver leur anisade sur la place de Jioyo, le nez dans la terre, les bras en croix, le dos soulevé par les éructations.
C'était odieux.
Au milieu de ces borracherias, ou beuveries de circonstance, les Japonais avaient gardé tout leur sang-froid, cela va sans dire.
Nous constations seulement que Yochiro, Wami et le médecin tenaient un long conciliabule dans un coin de la salle publique où Pedro Blas rechignait à servir de nouveaux pots de liquide aux indigènes, parce qu'ils n'avaient plus d'argent.
Cinq ou six autres Japs causaient dans un autre coin, tout bas, en conspirateurs.
Le reste gardait les bagages et en écartait les ivrognes.
Je pensai bien que le commandant et Wami, son complice, déploraient un contre-temps auquel ils n'avaient pu songer, et qu'ils se demandaient si le lendemain tout leur monde serait en mesure de reprendre la marche vers le plateau central de l'isthme, but de l'expédition.
Mais j'étais loin de songer à tout, moi aussi. Et ce que nous pûmes dès lors observer passa vraiment notre attente.
Chaque fois qu'un indigène entrait à présent dans la salle et se faisait refuser de l'anisado par le marchand, Sakatani Yochiro, d'un air paterne, payait pour lui.
Matsuda Tadama, le petit médecin, en faisait autant, si bien que dans l'espace d'une heure, le bruit s'étant répandu que les Japs « régalaient », ce fut un envahissement de la boutique, une succession de scènes bestiales, enfin de quoi tous les hommes du village, repus au delà des limites fixées par la nature, étaient ivres-morts.
Jusqu'aux peones de l'auberge à qui Wami, le faux nègre, fit absorber tant d'eau de feu qu'ils tombèrent comme des masses, abominablement gris.
Nous ignorions à quel degré de l'ivresse pouvaient être arrivés les femmes et les enfants sous les paillottes; il était certain que dans tout Jioyo, un seul habitant restait debout, sain d'esprit: le señor Pedro Blas.
Il nous sembla bientôt gêné, comme inquiet.
Cet isolement le privait, au demeurant, du concours de ses clients ordinaires, les gens du pays, pour le cas où il aurait quelque différend à régler avec les étrangers de passage à Jioyo, c'est-à-dire les Japs dissimulés sous leurs divers costumes, et nous, les trois Blancs.
Notre impression était exacte.
Sur l'injonction du bonze, Will Keog demanda la note des dépenses faites depuis la veille. L'aubergiste obtempéra, fit et refit sur une feuille de papier l'addition des pots d'anisade qu'il avait distribués successivement.
Comme il était mal éclairé par une mauvaise lampe à pétrole, Wami et Tadama s'approchèrent de son comptoir, soi-disant pour l'aider.
De la table où nous étions, muets d'inquiétude, nous eûmes le pressentiment de quelque abominable drame.
Mais j'avoue que la cause nous en échappait encore.
— Ils vont refuser de payer, marmotta le subtil Pigeon.
C'était autre chose.
La contestation eut bien la note pour prétexte: mais ce ne fut là qu'une entrée en matière. Aux premiers mots du señor Pedro Blas les récriminations vraies éclatèrent.
Wami, dans une apostrophe véhémente, accusa le débitant d'être un espion aux gages des Américains.
— Nous savons ce que tu fais ici, quand l'occasion s'en présente comme aujourd'hui, criait-il. Tu fais dire au commandant d'Alhajuela que des individus suspects sont passés par Jioyo, que l'on fera bien de mobiliser des détachements d'éclaireurs pour mettre sous clef ces gens-là, qui sont sûrement animés de mauvaises intentions contre le canal.
— Moi, señores! protesta le marchand d'anisade, blême d'inquiétude, moi! Je vous jure, par l'Immaculée Conception que nous fêtons aujourd'hui...
— Tais-toi! renchérit le Yochiro. Tu as envoyé trois hommes ce matin au commandant d'Alhajuela.
— Señores, c'est un menteur qui vous a dit cela.
— Menteur toi-même, riposta l'autre. Car je les ai vus partir. Je les ai épiés. Je sais ce qu'ils ont reçu de toi pour faire la course à toute vitesse, par la savane et les sentiers du Chagres. Heureusement qu'on a mis bon ordre, et en temps utile, à cette trahison...
L'homme allait nier encore, mais ses bourreaux ne lui en laissèrent pas le temps.
Il se tenait derrière son comptoir. Déjà Tadama s'était élancé sur la table de bois, comme un singe.
Et, une fois de plus, Wami, brandissant le terrible poignard que je connaissais trop, ou sa réplique, car peut-être le sien était-il celui que j'avais vu planté dans la gorge d'Erickson, Wami plongeait dans le cou du Guatémalien l'horrible lame.
Ce fut un flot de sang, un cri de douleur atroce, un battement de ses bras, que les complices tenaient solidement dans des menottes de fer.
Et au milieu de Banzaï furibonds, derrière le comptoir chargé de pots de liquide, le señor Pedro Blas tomba, égorgé comme une bête surprise et mise aussitôt dans l'impossibilité de se défendre.
Nous étions consternés tous les trois, à l'idée que ce meurtre avait pu être commis dans la demi-obscurité de cette boutique à poisons, sans qu'un seul des habitants du village eût été assez lucide pour crier, appeler les femmes...
Peut-être aussi, pensai-je, les femmes sont-elles ivres-mortes.
Wami, ayant essuyé son poignard du même geste que je lui avais vu faire sur le pont du Krakatoa, nous appela tous trois d'une voix brève.
— Prenez cet individu et venez avec nous.
Il fallait bien obtempérer. Will Keog se plaça entre les jambes du cadavre qu'il emmena de ses mains vigoureuses, tandis que je prenais le mort par-dessous le bras droit, et Pigeon par dessous le bras gauche.
On sortit ainsi de l'auberge.
La lune était superbe, comme la veille au soir. J'estimai qu'il était neuf heures environ.
Dix ou douze Japonais nous suivaient en causant à voix basse. On fit la route qui conduisait au rio.
— Halte! commanda Wami à vingt mètres de la berge.
Les alligators dormaient en troupe au bord de l'eau, les mâchoires démesurément ouvertes et immobiles, comme s'ils eussent regardé la lune avec des yeux de pierre.
— Lancez-leur ce souper, nous cria l'implacable bonhomme.
Il fallut reprendre le corps et avancer des vingt pas qui nous séparaient de la grève.
Mais alors le bruit que nous avions fait, l'odeur du sang peut-être, réveillèrent les sauriens monstrueux.
Leurs mandibules commencèrent à jouer, avec des craquements horribles.
La berge était surélevée d'un mètre, heureusement. Nous donnâmes au corps le ballant qu'il fallait, et Keog ayant compté jusqu'à trois, le señor Pedro Blas fut jeté en pâture au troupeau des voraces.
Nous les vîmes s'avancer vers la chair fraîche, se battre affreusement pour en happer les lambeaux.
Ce fut l'affaire de deux minutes à peine.
— Bien, dit alors le vieux Yochiro en nous regardant avec affectation. C'est là un premier avertissement. S'il est nécessaire, on en donnera d'autres. Ce ne sont pas les alligators qui manquent dans le pays.
Faut-il dire que la nuit fut atroce et que chacun de nous rêva d'histoires macabres plutôt qu'il ne dormit?
Nous n'étions pas au bout de nos peines!

>Sur ce tracé très net, les lecteurs de La Guerre Infernale
suivront avec la plus grande facilité les péripéties de l'action
qui se déroule dans les chapitres XIX et XX du roman.
Il faut lire ce roman d'aventures extraordinaires, où s'associent les facultés de vulgarisation divinatrice de Pierre Giffard et les coups de crayon prophétiques de Robida. Il paraît un fascicule tous les samedis.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.