
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
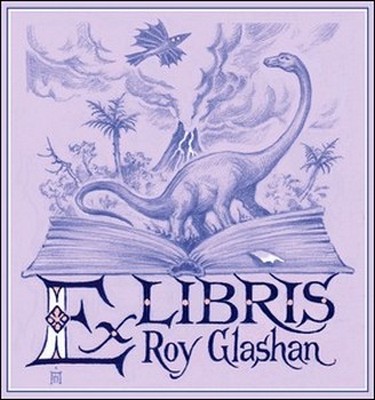

On nous promenait comme des bêtes curi-
euses, à travers San-Francisco japonifié.

Le camp japonais. (Page 549.)

Un journaliste français, reporter au service du grand quotidien l'An 2000, suit et raconte les péripéties de la Guerre Infernale qui met aux prises, d'une part, l'Angleterre, la France, le Japon alliés, avec, d'autre part, l'Allemagne unie à l'Amérique. Après des aventures angoissantes sur terre, dans les airs et jusqu'au fond des mers, le narrateur, prisonnier des Américains, parvient à s'évader sur un navire, le Krakatoa, qu'ont affrété de braves Hollandais pour rechercher le fiancé de leur fille, miss Ada. Ce fiancé, Tom Davis, est un officier d'état-major anglais chargé d'une mission si mystérieuse qu'il a soudain disparu.
Le Krakatoa dépiste la vigilance de l'escadre américaine qui surveille les abords de Key-West et conduit enfin ses passagers dans la rade de Nassau (îles anglaises de Bahama), où, à leur grande joie, ils retrouvent Tom Davis. Hélas! cette joie est de courte durée: l'amiral de la flotte japonaise, qui vient rejoindre à Nassau sept croiseurs anglais pour essayer de forcer avec eux les passes de la Floride, exige le départ immédiat de tout bâtiment étranger.
Le Krakatoa est forcé de repartir pour l'Europe, emmenant Miss Ada et sa famille. Mais le corréspondant de l'An 2000, doublé de son collaborateur Pigeon, reste avec Tom Davis, dont la mission consiste à décider les nations blanches à renoncer à leur lutte fratricide pour se liguer contre l'invasion jaune. Ils assistent aux étranges phénomènes que suscite à sa volonté l'illustre savant américain Erickson, créé maréchal des Forces électriques. Successivement il fait flamber, puis congèle la mer autour des vaisseaux japonais, il répand à distance la mort dans les rangs des Jaunes à l'aide de tout un système magnétique d'une puissance infinie. Il est d'autant plus acharné à son oeuvre de destruction qu'il veut venger la mort de son fils tué par les Japs. Mais il tombe lui-même sous le poignard d'un espion. Les diables jaunes réussissent à supprimer la source d'énergie qui fournissait le courant à toutes ses machines infernales... Les blancs doivent reculer devant la horde des envahisseurs. Sur le point d'être capturés, Pigeon et son compagnon songent à s'empoisonner pour éviter de subir les tortures coutumières aux Célestes...
Le crépitement des balles agaçait nos bêtes; elles se déplaçaient l'une après l'autre, ce qui nous empêchait de viser commodément.
Les Chinois continuaient à pousser de grands cris, comme ils font chez eux, pour nous effrayer.
Voyant que nous acceptions le combat, ils épaulèrent leurs carabines et criblèrent de balles mulet et cheval. Les deux animaux s'affaissèrent sans se débattre, lourdement.
— Faisons de même, Pigeon! Couchons-nous à l'abri, derrière...
Alors, étendus à plat ventre, appuyés sur les animaux morts, nous pûmes viser.
Un Chinois tomba sur le nez.
— C'est à moi, celui-là, m'écriai-je tout fier.
— Oh! pardon, patron, pardon, protesta Pigeon en s'appliquant de son mieux. Je crois que vous faites erreur et que c'est votre serviteur très humble qui a descendu ce fils du Ciel...
Il n'acheva pas, car le second Chinois, sorti enfin des fils télégraphiques où les deux chevaux et le mort demeuraient entortillés, s'avançait vers nous au pas de course, pour nous combattre, en hurlant de plus en plus fort.

— Alors, étendus à plat ventre, appuyés sur
les bêtes mortes, nous pûmes viser. (Page 545.)
— Attention, Pigeon! criai-je. Il ne faut pas qu'il avance, celui-là! Autrement il nous tuera l'un ou l'autre. Et le survivant n'aura pas grande chance de l'estoquer. Feu, feu, Pigeon! Feu!
De nos pistolets automatiques les balles partaient. C'était une pétarade ininterrompue.
Je ne me croyais pas si vaillant tireur. Et Pigeon! Un artiste, en vérité, car ce fut son tour de frapper juste.
En un kra, kra, kra, frénétique il envoya deux balles dans la figure du Chinois démonté.
Le Mongol aux longues moustaches, hideux et ma foi terrible à voir, tomba sur la face comme son compagnon.
— Bravo, Pigeon! m'écriai-je, bravo! Accordez-moi le premier sans contestation. Ainsi, nous aurons chacun notre Céleste au tableau, comme dans les grandes chasses.
— Volontiers, d'autant plus que je crois sincèrement à tous vos droits sur le premier.
Fiers d'un tel début dans l'art de tuer nos semblables, si tant est que deux brigands chinois soient nos semblables, nous nous précipitâmes vers les cadavres pour leur emprunter quelque souvenir: carabine ou coupe-coupe, chapeau même.
J'entrevoyais déjà la minute agréable où je suspendrais un peu de ces défroques exotiques au centre de ma panoplie dans l'appartement de la rue Saint-Florentin, lorsque Pigeon, plus pratique, me fit comprendre que les deux chevaux, avant tout, méritaient notre sollicitude, et que c'était à ces coursiers emberlificotés dans le fil de fer qu'il convenait de donner nos soins.
Les nôtres étaient morts. Nous n'avions qu'à sauter en selle sur ceux-là. Ils nous conduiraient au petit galop vers Tucson, où nous entrerions nimbés de l'auréole des braves.
Réflexion judicieuse!
— Emmenons-les vite et filons, opinai-je en m'engageant dans les fils toujours entortillés.
Mais nous avions beau tirer sur la bride; les deux chevaux, au lieu d'avancer, reculaient.
— Ma parole, fis-je en plaisantant, on croirait qu'ils ont les pieds nickelés!
— Vous ne croyez pas si bien dire, patron, s'écria Pigeon désolé. Nickelés, non! mais furieusement aimantés. Regardez plutôt.
Je regardai et je vis en effet que les sabots des chevaux chinois que nous convoitions tant ne reposaient plus sur le sol, mais bien sur des pièces de fer doux, sur des électro-aimants, sur des barres aimantées que le malencontreux chariot avait versés là par douzaines.
Les bêtes portaient donc aux pieds de véritables boulets, qui ne pouvaient se détacher tout seuls.
Chaque fer était collé à un aimant, et chaque pas devenait un faux pas. Nous avions bien deux chevaux à notre merci, mais pour les rendre utilisables, il fallait les délivrer de ces appendices tenaces.
On se mit au travail; mais le temps perdu là nous perdit.
Tandis que nous tirions de toutes nos forces, moi sur le pied d'un cheval, Pigeon sur la pièce de fer dont il fallait le débarrasser, le retour des éclaireurs s'accomplissait.
Mais dans quel désordre! Nous entendions le galop de leurs montures; puis nous les apercevions qui jouaient des éperons en poussant des cris lamentables de sauve-qui-peut.
C'était une déroute.
Sûrement nos deux cents cavaliers avaient rencontré le gros des batteurs d'estrade chinois et se faisaient ramener par lui vers Tucson plus vite que leur dignité ne l'eût commandé.
— Vite, nous criaient-ils en passant, vite! En selle, et venez avec nous! Ils sont là tout un régiment, qui nous suivent à quelques minutes. Ils vont nous rejoindre si nous ralentissons.
Une fois de plus je sentis que mes veines devenaient froides, comme si on leur eût injecté quelque seringue d'eau glacée,
Que faire? Comment faire? Nous avions en main deux brides, au bout desquelles il y avait deux chevaux qui hennissaient. On eût dit que les pauvre bêtes avaient eu la notion du danger, et à chaque tentative qu'elles faisaient pour se tenir droit sur leurs jambes c'était un affaissement, une perte d'équilibre, à ce point complète que l'une d'elles, finalement, s'abattit.
Pigeon me regardait avec une angoisse visible. Il se demandait si je n'allais pas trouver quelque idée géniale pour nous tirer de là.
Hélas! les idées géniales ne courent pas les plaines de l'Arizona, d'après ce que je vis, car il me fut totalement impossible d'extraire la plus modeste pensée de mon cerveau.
Je jugeai que cette fois nous étions perdus sans rémission, et ce fut tout.
Le tapage que faisait la trombe d'hommes affolés me rendait complètement inerte.
Je la regardais passer à cent pas sans même faire un geste pour appeler au secours.
Deux de ces hommes pourtant, qui s'enfuyaient à bride abattue vers la ville, pouvaient s'arrêter quelques secondes, nous prendre en croupe et nous tirer de là.
Je ne songeai même pas à demander ce service aux Eclaireurs de l'Ouest.
Après tout nombre d'entre eux ne nous connaissaient pas. Il eût fallu que le général Strawberry passât à notre portée. En réalité, c'était lui mon suprême espoir, dans le découragement qui venait de m'envahir.
Lui ne nous abandonnerait pas aux coups des Chinois, à la torture, aux supplices, dont nous pouvions nous affranchir, au pis aller, en buvant le poison...
Mais tant que me restait une lueur d'espérance, devais-je donner à Pigeon l'ordre fatal?
Une première fois j'avais parlé trop vite; nous venions de nous en apercevoir. Quand il s'agit de prévenir la mort en se donnant la mort soi-même, il faut montrer de la décision, sans doute, mais il s'agit aussi de ne pas trop précipiter les mouvements.
C'est qu'une fois parti pour le grand voyage on n'en revient plus. Le minuscule flacon que nous portions dans notre poche contenait de quoi tuer sur l'heure un troupeau de boeufs. Une goutte de l'élixir homicide et nous tombions raides sur la place, Pigeon et moi, pour ne plus nous relever. C'était à considérer.
Et je considérai, à part moi, tout en suivant des yeux la débandade. J'espérais une apparition finale de notre sauveur, le général Strawberry caracolant plus sagement parmi les derniers de ses cavaliers en retraite.
— Je ne le vois pas, dis-je alors, nerveux comme on l'imagine.
Pigeon s'avisa d'une chose fort simple. Il se mit à crier aux fuyards, qui le regardaient à peine .
— Le général est-il derrière vous?
Les deux premiers à qui mon compagnon s'adressa haussèrent les épaules d'une façon qui me déplut. Un troisième lui jeta cette réponse à la volée, comme une aumône:
— Il est mort!
Nous crûmes que la terre allait nous manquer sous les pieds.
Vivement nous abandonnâmes notre buisson de fils de fer, les chevaux chinois aux sabots chargés d'aimants, pour courir au-devant des derniers cavaliers qui arrivaient sur nous.
— Le général est mort? demandai-je à l'un d'eux en réunissant toutes mes forces pour trouver un reste de voix.
— Mais oui! fit-il en se sauvant plus vite.
— Le général est mort? recommença Pigeon, courant après un autre.

— Le général est-il mort? demandai-je à l'un d'eux,
en réunissant toutes mes forces. (Page 547.)
— Mais oui! lança l'homme toujours galopant, sans regarder derrière lui.
— Oh! fis-je, alors demandons à ceux-là de nous emmener, Pigeon! Il le faut! C'est le seul moyen que nous ayons de nous sauver à présent.
Il arrivait encore un peloton de quinze ou vingt cavaliers, le dernier de tous.
— Prenez-nous en croupe! demandions-nous en courant au devant d'eux. Prenez-nous en croupe!
Cette attitude de suppliants m'humiliait profondément. Un instant je fus pris de honte et fis un geste pour abandonner la partie.
Pigeon m'excitait à renouveler la requête parce que les hommes du dernier peloton faisaient mine, précisément, de ralentir pour nous écouter.
Mais alors se passa une scène si rapide que nous n'eûmes plus le temps de songer à rien.
Trois ou quatre éclaireurs et leurs chevaux roulent à terre, frappés par des armes silencieuses qui ont déjà tué nombre de leurs camarades le jour de notre arrivée.
Je lève les yeux en l'air. Un aérocar japonais est sur nous, à cinquante mètres à peine.
Les cavaliers qui survivent déchirent leurs chevaux à coups d'éperons et disparaissent. Nous restons seuls, glacés d'effroi, hypnotisés par l'engin de guerre qui fond sur nous.
Tels les lièvres que le chien d'arrêt immobilise dans leur gîte, nous sommes incapables de faire un mouvement.
Pour ma part je n'ai plus conscience de rien. Je regarde, la bouche ouverte, le ballon jaune et les petits hommes de même couleur qui le montent.
A dire le vrai, j'ai fait un geste pour prendre dans ma poche le terrible flacon, et Pigeon aussi.
Mais à tous deux une même pensée est venue. Toujours la dernière branche à laquelle l'homme assoiffé de vie s'accroche pour ne pas mourir, alors même que l'image d'un supplice à brève échéance se dresse devant lui!
Ces monte-en-l'air qui nous tombent dessus, qui talonnent, raclent le sol et nous font prisonniers de leurs mains nerveuses, sont des Japonais. Or, le chef de l'escadrille japonaise qui opère dans le sud des Etats-Unis n'est-il pas à présent Wami?
Peut-être est-il là?

Ces monte-en-l'air qui nous font
prisonniers sont des Japonais. (Page 548.)
Peut-être est-il parmi ceux-là?
Peut-être est-il descendu pour nous rendre service des nuées où nous ne l'avions pas aperçu, tant nous étions occupés ailleurs?
Qui sait? Les Japonais se targuent de chevalerie; ils se réclament de notre civilisation blanche à l'occasion. Pourquoi Wami, reconnaissant de ce que j'ai fait pour lui et nous voyant embarrassés, n'aurait-il pas eu la pensée généreuse de nous arracher aux mains cruelles des Chinois?
Car les Chinois qui poursuivent les éclaireurs américains arrivent en troupe serrée.
Ils nous ont aperçus; ils ont vu les deux morts que nous leur avons faits.
Notre affaire était claire sans l'arrivée des Japs, nos alliés d'hier.
Oui, sûrement c'est Wami qui commande l'aérocar, dans lequel nous sommes jetés comme des paquets, juste à temps pour échapper aux coups de sabre des Célestes furieux de voir leurs proies leur échapper!
En quelques secondes le ballon japonais a déposé plusieurs sacs de lest compensateurs et repris sa route dans les airs, devant les Barbares ahuris.
Je promène les yeux — et Pigeon fait de même — sur l'équipage. J'y cherche Wami.
Je découvre bien un lieutenant qui lui ressemble... Mais tous ces Japonais, je l'ai déjà dit, ont des visages à ce point semblables que nous nous y trompons continuellement. Je fixe deux petits yeux noirs qui me rappellent ceux de mon compagnon de l'Austral, si rusé et si brave.
Hélas: les deux escarboucles brillent d'un éclat semblable, mais ne me disent rien de bon. Le nez de l'officier qui commande est plus gros; le buste est plus long; l'homme est plus haut, plus fort. Décidément ce n'est pas Wami qui est à bord et les autres personnages, simples marins de l'air, sont quelconques.
Seul le chef pouvait nous connaître et être connu de nous. Bien examiné ce n'est qu'un Japonais comme les autres.
Un grand désespoir me prend. Je regarde Pigeon. Il ne m'a jamais paru si découragé.
Tous deux nous sommes couchés dans la coque, et mal couchés, sur le flanc.:
Je demande à mon lieutenant en français:
— Que faut-il faire? Boire à la petite bouteille?
A vrai dire, j y suis bien résolu, une fois pour toutes.
— Je crois que ce serait le meilleur parti à prendre, répond-il. Mais comment? Vous ne voyez donc pas que nous sommes liés de partout?
J'étais si troublé que je n'avais pas senti les cordes don't mes pauvres membres étaient entourés!
Impossible de faire un mouvement. Nous étions à notre tour ficelés dans cette nacelle comme deux saucisses.
Je dis à nôtre tour, parce que la manière dont les cordes s'enroulaient autour de nos individus me rappela aussitôt l'empaquetage de Pezonnaz...
Que c'était loin déjà, ce souvenir! Et comme depuis l'enlèvement de Pezonnaz les événements avaient marché!
Deux heures à peine se passèrent. Il pleuvait à présent.
Comme le jour était très bas, je pensai que le commandant n'allait pas tarder à atterrir.
Où étions-nous? Dans quelle direction avancions-nous?
Le moteur venait sûrement de France; je le reconnaissais au rythme et à la tonalité de ses explosions. Mais c'était tout ce que j'y pouvais reconnaître.
Au dehors on ne voyait rien, puisque nous avions été jetés dans le fond de la coque comme des ballots; et les Jaunes qui conduisaient l'engin ne parlaient que le japonais.
Les sonorités bizarres de leur langue, toute en chi, et en cho et en chou, me rappelaient aussi les conversations de nos cinq officiers nippons à bord de l'Austral.
J'avais essayé d'échanger quelques phrases avec Pigeon, mais le ronflement du moteur et les piailleries des Japs rendaient inutile toute tentative en ce genre.
Si bien que ce fut sans avoir prononcé vingt paroles que nous nous sentîmes débarqués à terre. L'officier nous admonesta en japonais. Evidemment il ne savait pas d'autre langue, et nous fûmes réduits à deviner ce qu'il voulait nous dire.
— Debout, et hors d'ici!
C'était quelque chose d'approchant.
Nos jambes se trouvaient, déliées et nous pouvions marcher.
Avec précaution, car nos bras restaient attachés au long du corps. Ils se refusaient à nous donner l'équilibre.
Quand on mit pied à terre, il faisait presque nuit. Mais la vue des gens et des choses qui nous entouraient ne devait pas nous surprendre. C'était du moins ce que je m'attendais à voir: des soldats, des officiers, des fusils en faisceaux, des tentes basses, un camp. Le camp du général Yoritomo, sans aucun doute.
Des hommes saisissaient les amarres du ballon, pour le rentrer sous quelque abri voisin. Le lieutenant rendit compte de notre capture à trois officiers plus élevés que lui en grade.
Ces personnages me parurent fort intéressés par le récit de leur subalterne. Ils lui adressèrent de multiples questions auxquelles il répondit, puis l'ayant congédié, nous firent entourer par une dizaine de fantassins, l'arme sur l'épaule.
— Va-t-on nous fusiller comme ça, tout de suite? me demanda Pigeon en anglais, assez haut pour être entendu des officiers.
— Pas encore, répondit en excellent français le plus galonné d'entre eux.
J'appris plus tard que c'était le général Yoritomo en personne.
Vous croirez peut-être que j'exagère? Eh bien, je n'exagère pas en disant qu'elle est délicieuse, la minute où l'on entend parler sa langue maternelle au fond d'un désert, à des milliers de lieues du pays natal, fût-ce au moment le plus tragique, par des hommes qui s'apprêtent à nous donner la mort!
Il nous semble—et l'illusion dure l'espace de cette minute même — que rien d'absolument mauvais ne peut résulter pour nous d'une circonstance où se rencontrent des gens qui parlent comme nous, qui disent les mots que nous avons accoutumé de dire depuis l'enfance... Et ces instants trop courts nous font du bien. Ils représentent des haltes au cours d'un calvaire.
Celle-ci ne nous donna même pas la minute de répit que j'en espérais, car le général Yoritomo, fixé par le rapport de son subordonné, à ce que je supposai, et préoccupé de se rendre ailleurs, nous adressa en tout quatre questions, sous une forme tout juste polie:
— Vous êtes Français l'un et l'autre?
— Oui, général, répondit Pigeon le premier, et très fort, pour me faire comprendre qu'il avait reconnu les insignes du grand chef, en dépit de la nuit tombée.
— Vous avez été pris à l'entrée de Tucson?
— Oui, général.
— Vous étiez venus à la Montagne de Plomb avec le maréchal des Forces électriques!
— Oui, général.
— Vous étiez là quand on l'a trouvé mort dans son lit?
— Oui, général.
— C'est bien. Demain matin vous serez dirigés sur Harouko.
Ce nom ne nous disait rien; nous l'ignorions totalement. Je supposai qu'il était celui d'un autre camp, plus rapproché de la mer. Le général voulut bien ajouter pour nous fixer:
— Harouko, c'est le nom japonais que nous avons donné à ce San-Francisco d'où nous avons chassé les Yankees, messieurs. C'est le nom que porta l'une de nos souveraines et cela veut dire en japonais: l'Impératrice Printemps. Je pensai que le nom s'appliquait heureusement à la florissante et majestueuse capitale de la Californie; mais l'heure n'était guère aux constatations de ce genre.
Déjà le général avait tourné le dos, ainsi que ses deux compagnons. Un cri rauque du sergent qui conduisait notre escorte, et chacun se mit en marche: les fantassins nippons sur deux files, Pigeon et moi au milieu.
Cette fois, me dis-je, nous voilà bien finis... Ces gens-là ne peuvent nous conduire qu'à la prison.
En effet, entre deux groupes de tentes nous aperçûmes un cantonnement plus solide, fait de voliges, de broussailles mortes et de papier en plusieurs épaisseurs.
— Halte! cria le sergent.
Du moins je supposai que tel était le sens de l'interjection qui sortit de son gosier, car aussitôt chacun s'arrêta.
Nous fûmes remis aux mains d'une autre escouade de soldats et d'un autre sous-officier, qui nous écroua sur une longue banderole de papier, à l'aide d'un pinceau trempé dans l'encre de Chine.
C'était un petit brisquard, déjà vieux. Il nous adressa un flot de paroles auxquelles nous ne pouvions rien comprendre, et pour cause.
Comme nous ne lui répondions que par des signes d'ignorance, il s'impatientait. Finalement il employa le langage des sourds-muets, lui aussi, mais à sa manière.
Il n'était pas malaisé de deviner qu'il nous demandait d'inscrire nos noms sur la banderole.
Pigeon se chargea de la corvée.
Le petit bonhomme lut et relut, prononça plusieurs fois nos noms à sa manière, qui sûrement n'était pas la bonne; mais nous lui laissâmes entendre qu'il articulait fort bien. Alors, de son pinceau trempé dans l'encre de Chine, il inscrivit des hiéroglyphes très japonais, destinés à traduire les sons qu'il était parvenu à retenir.
Après quoi le même geôlier nous fit pénétrer dans une pièce où se tenaient deux soldats armés jusqu'aux dents.
D'un geste il nous montra deux nattes.
C'était pour nous. C'étaient nos lits.
Une lanterne au pétrole, puante sous les écrans de papier, éclaira toute la nuit cette chambre trop grande et trop haute pour que le feu d'un mauvais poêle, mal entretenu, nous donnât une suffisante chaleur.
Nous avions été déliés par le rengagé. Mais une lamentable formalité — nous devions nous y attendre — suivit cette opération. On nous fouilla.
Un à un les objets que nous possédions passèrent de nos poches dans les mains des deux aides geôliers.
Montres, portefeuilles, carnets de chèques — nous possédions près de deux cent cinquante mille francs en valeurs fiduciaires — tout nous fut enlevé.
Lorsque les gardes-chiourmes découvrirent nos petits flacons, ils eurent des sourires malins.
L'un après l'autre ils y plongèrent leur nez épaté. Le chef nous fit comprendre par gestes que désormais nous ne pouvions plus espérer nous soustraire au châtiment suprême. Il eut à ce propos une mimique atroce. Prenant l'un des flacons, après l'avoir soigneusement rebouché, le mécréant fit semblant d'y boire.
Puis il s'ingénia de son mieux à nous démontrer que ce geste ne nous était plus permis parce que nos bouteilles de poison resteraient désormais sous clef dans son officine, ou bien seraient jetées au vent, tandis que là-bas, là-bas, très loin, à Harouko, des grands sabres s'abattraient sur nos épaules et nous trancheraient la tête, ric et rac.
Cet animal me faisait froid dans le dos.
Quant à Pigeon, je devinai à la direction de ses yeux qu'il préférait ne pas regarder le vilain bonhomme dont les simagrées lui paraissaient trop expressives.
Enfin nous restâmes seuls — en présence de deux sentinelles, bien entendu — qui mâchonnaient leur poignée de riz chacune dans un coin de la chambre, le fusil en bandoulière.
On les releva trois fois pendant la nuit, de sorte que nous ne pûmes dormir. Aussi bien avions-nous l'esprit trop agité par l'effroi d'un supplice prochain pour prendre le moindre sommeil.
Dans notre malheur nous avions conservé le grand avantage d'être ensemble. Combien de temps cette captivité à deux durerait-elle?
— Espérons que ce sera jusqu'à la fin de notre vie, dis-je en m'étendant sur la natte et en confiant ma tête à l'objet spécial qui sert de traversin au Japon.
— Au diable le petit banc! s'écria Pigeon en déplaçant l'incommode appareil en bois dont les Japonais ne sauraient se passer pour dormir. Oui, patron, souhaitons qu'ils nous laissent ensemble jusqu'à la fin de notre vie; elle ne sera pas si longue à présent! Je compte, à vue de pays, deux semaines, trois au plus...
— Trois semaines? Vous radotez, mon bon. Pourquoi trois semaines?
— Dame, l'instruction de notre procès...
— Naïf!
— Ne fût-ce que pour la forme, on nous fera un procès.
— Je ne crois pas ça, Pigeon. C'est encore la joie de vivre qui vous retient par un dernier fil. Vous vous cramponnez; c'est bien inutile. A mon avis nous serons exécutés avant trois jours. Le temps d'arriver à San-Francisco, de comparaître, peut-être, devant un soi-disant conseil de guerre. Tout cela demandera deux ou trois jours, Pigeon, et non deux ou trois semaines. Préparons-nous donc, mon excellent bon, préparons-nous à faire bientôt le grand voyage! On ferme les portières. Nous sommes partis. Bien mal, hélas! bien mal...

Je confiai ma tête à ce petit banc de bois
qui, au Japon, sert de traversin. (Page 551.)
Le lendemain au petit jour nous étions, sans autres formalités, embarqués dans un train qui nous emmenait à San-Francisco, devenu Harouko, ainsi que des malades, des blessés, des indisponibles.
Il était interminable, ce train; la plupart de ses wagons retournaient à vide vers la capitale pour y chercher de nouvelles troupes.
Dans le fourgon à bestiaux qui nous servait de véhicule, et qui empestait, dix fantassins nous accompagnaient, ainsi qu'un sous-officier.
Le trajet dura toute la journée, toute la nuit, et toute la matinée du lendemain, par un temps pluvieux qui nous rendait encore plus tristes que la veille.
Nous causions peu.
Non pas que le temps nous manquât pour échanger des idées; l'allure d'enterrement que garda jusqu'au bout ce convoi de matériel nous permettait d'utiliser d'interminables haltes en pleine campagne, toutes les demi-heures, pour évoquer nos communs souvenirs et nos espérances, si minces désormais qu'elles devenaient tout à fait nulles; mais notre commune angoisse s'accommodait mieux du silence que de l'épanchement. La ligne du chemin de fer suivait du Sud au Nord le littoral du Pacifique.
Le paysage, aride et lugubre au sortir de l'Arizona, se modifia presque sans transition avant Los Angeles, où nous fîmes une halte de deux heures.
Les écriteaux portaient toujours le nom espagnol conservé par les Yankees pendant de si longues années; c'était que les Japonais n'avaient pas encore trouvé le temps de le changer. Mais de la colonie richissime qui venait autrefois hiverner sur cette côte enchanteresse il ne restait que la trace: ces habitations superbes, ces résidences pour millionnaires, vides de leurs résidents!
Aux rares Blancs qui s'apercevaient encore dans les gares on devinait que toute la population aisée avait fui devant l'invasion des Jaunes.
Nous entrions en Californie, et les Japs en étaient devenus les maîtres incontestés.
Chefs de gare japonais, hommes d'équipe japonais, petits marchands d'oranges et d'eau glacée japonais; buffetiers japonais, curieux et curieuses japonais et japonaises! Sûrement le flot de l'invasion n'avait pas cessé de se déverser sur ce malheureux pays depuis les soixante-huit jours que durait la guerre.
Pauvre Californie! Si riche, si belle! Elle était devenue en moins de cent ans le paradis des Blancs!
Quelle humiliation pour son peuple d'infatigables travailleurs!
Être conquise par les Jaunes comme le furent en Europe les peuples chrétiens au temps d'Alaric! Se sentir impuissante à secouer le joug, intolérable pourtant, d'une race antipathique, orgueilleuse, rapace, inférieure pour tout dire en un mot, si ce n'est dans la cruauté!
Les orangers nous deviennent déjà familiers. Et aussi les citronniers, les champs de pêchers, de fraisiers. Les Japs peuvent se croire dans leurs îles. Pigeon déclare avec mélancolie, entre deux averses, qu'on serait bien là pour y terminer ses jours, même sous la domination japonaise, au cas où le tribunal dont il espère invinciblement je ne sais quelle mansuétude consentirait à nous faire remise de la peine capitale, et décréterait notre internement perpétuel dans un de ces sites japonifiés.
— Ils doivent être enchanteurs quand il y fait du soleil, ajoutait le pauvre garçon, accroché à sa chimère. Et le soleil est l'ami de ce pays, nous le savons; sans compter que cette végétation luxuriante l'atteste. Ah! ce ne sont plus les déserts de l'Arizona!
Le train poursuivait sa route sous la pluie. Nous apprenions par les pancartes affichées dans les gares que nous passions à Monterey, à San-Diego, à Santa-Barbara, plages à la mode depuis la fin du XIXe siècle.
Le soleil ayant fini par se montrer, juste à la minute où il allait s'enfoncer dans l'Océan Pacifique, nous eûmes à Santa-Barbara la vision exquise de l'Eden sur la terre. Ce n'étaient à perte de vue que coquettes villas, entourées de vergers où abondaient les figues, les oranges, les pêches.
Et les fleurs, donc! Des fleurs partout, que les pluies de cette longue chute — elle avait duré vingt-quatre heures — faisaient plus vivaces et plus odorantes à côté des fruits!
Mais partout la vie s'était enfuie de ces charmantes watering-places.
La terreur du Jaune en avait chassé tous les Blancs. C'était la ruine, pour l'avenir comme pour le présent, le désastre d'une civilisation, que la barbarie asiatique allait remplacer.
Pigeon ne put s'empêcher de protester contre les destins.
— Ces Japonais prolifiques et besogneux, disait-il avec juste raison, auront beau faire tous leurs efforts pour singer l'Européen, ils resteront des Asiatiques. En se jetant sur la Californie comme des gloutons ils apaiseront leur faim pendant quelques années. Mais quel malheur pour l'humanité! Jamais les Etats-Unis ne les délogeront à présent, à moins que l'Europe tout entière ne s'y emploie avec eux. Si elle consent à les aider, il est encore temps de contraindre ce grouillement de sauvages à rembarquer pour les îles du Soleil-Levant... Dans le cas contraire c'est bien fini de la belle unité fédérale. Il faudra biffer la Californie de la carte, en attendant que ce soit le tour de l'Arizona, du Texas, et plus tard de la Louisiane. Ah! les Blancs ont été bien maladroits, patron, bien maladroits lorsqu'ils ont laissé, en 1904 et 1905, les Japonais écraser l'ours russe en Mandchourie! C'était alors qu'ils pouvaient agir au nom de la solidarité de race. C'était alors qu'il fallait enfermer ces gêneurs dans leur archipel de trois mille et je ne sais combien d'îles, en leur disant: vous êtes là depuis des siècles; restez-y! Quelles conséquences lamentables aujourd'hui de ce manque de fraternité blanche! Elles sont devenues calamiteuses avec l'association anglo-franco-nipponne. Enfin c'est fait, c'est fait... N'en parlons plus. D'autant mieux que les yeux se sont dessillés sur les fautes commises et que le tir est à présent rectifié... C'est égal, je voudrais bien, avant qu'on me tranche la tête, savoir ce qui va se passer sur la planète.
— Et moi donc!
— Voulez-vous que je vous dise, patron?
— Dites, mon cher.
— Eh bien, aussi vrai que nous sommes là, dans ce wagon à boeufs, sous la surveillance de ces dix cocos et de leur sous-off, je mourrais presque content si l'on venait me déclarer ceci par exemple, demain à San-Francisco, lors de notre arrivée: Vous savez l'Europe? Eh bien, elle marche pour de bon! Elle fait bloc sérieusement, cette fois, contre la marée jaune. Toutes ses flottes réunies vont arriver par ici, avant trois mois, pour reprendre la Californie et la restituer aux Etats-Unis.
Je secouais tristement la tête... Et le train roulait toujours. Ces conceptions d'un avenir prochain occupaient nos heures de captivité ambulante.
La nuit était venue. On la passa tout entière dans la gare de Santa-Barbara, quelque déraillement sans doute nous empêchant d'aller plus loin.
Nous avions croisé dix trains chargés de troupes japonaises pendant la journée. Nous en vîmes descendre vers le Sud dix autres pendant la nuit. Chacun d'eux portait un millier d'hommes. Tous étaient reliés aux stations et entre eux par la télégraphie sans fil. Aussi la précision de leurs horaires dépassait-elle, en ce temps de guerre, celle de nos graphiques les mieux combinés pour le temps de paix.
Chacun de ces régiments jaunes observait le silence le plus impressionnant. Ni cris, ni chants, ni beuveries comme chez nous. On eût dit des convois funèbres, des trains d'ombres guerrières...
La nuit fut dure entre minuit et le petit jour, à cause du froid, qui se montra excessif. Nous n'avions que deux méchantes couvertures chacun, lancées à notre tête par le sous-officier, très dédaigneux de nos personnalités. Quand on commença d'y voir clair, je claquais des dents.

Nous croisions d'innombrables trains chargés de troupes. (Page 554.)
Mes idées n'avaient cessé de se reporter au pays natal, qui en douterait? J'avais surtout pensé à M. Martin du Bois, et l'idée m'était venue, très lancinante à la réflexion, que ce parfait galant homme, dès qu'il apprendrait notre infortune, s'il ne la connaissait déjà, mettrait tout en oeuvre pour nous tirer d'affaire.
La folle du logis aime ainsi à s'égarer.
Nous tirer d'affaire! Comment eût-il pu y songer, malgré ses millions et son ingéniosité bien connue?
Nous n'étions plus à Charleston. Il ne suffisait plus d'une équipe hardie de camarades pour nous enlever la nuit et nous faire passer sur un nouveau Krakatoa...
Cette évocation d'une fugue si bien réussie ne pouvait se faire dans ma tête sans que la figure rusée de Wami y apparût, dominant toutes les autres.
— Tout de même, dis-je à Pigeon, quel changement! Lors de notre première capture, c'est Wami qui fut la cheville ouvrière, l'agent infatigable et dévoué de notre évasion. Voilà que la deuxième est un fait accompli et si les circonstances le voulaient — il faut tout admettre — Wami pourrait être chargé de commander les troupes le jour de notre exécution, ou de siéger au conseil de guerre qui va nous juger. Comme on a raison de dire que les jours se suivent et ne se ressemblent pas!
Le lendemain à midi, nous arrivions cahin-caha en gare de San-Francisco. Dépourvus de carnets, de crayons, puisqu'on nous avait tout confisqué au camp le soir de notre enlèvement, nous prîmes toutes sortes de précautions pour nous rappeler la date que portait ce jour-là le calendrier. Nous ne savions déjà plus si nous étions un mercredi ou un dimanche; mais à n'en pas douter, nos deux mémoires affirmèrent que c'était le 26 novembre, 68e jour de cette guerre infernale.
— Aujourd'hui 26 novembre, 68e jour, répétait par trois fois Pigeon.
— Aujourd'hui 26 novembre, fis-je à mon tour plusieurs fois de suite, 68e jour.
— Aujourd'hui 26 novembre... 26, 26, 26...
— Aujourd'hui 26 novembre, 26, 26, 26...
Mon collaborateur eut un accès final d'abattement:
— Bah, murmura-t-il comme le train stoppait, à quoi bon compter les jours, pour les deux ou trois qu'il nous reste à vivre?
— Comptez au contraire, comptez bien, mon bon! Je fais de même. Mettons-nous d'accord sur ce point de départ. Qui vous dit que dans une heure nous ne serons pas séparés?
Fâcheuse prophétie! Elle ne devait pas tarder à se réaliser.
On nous faisait descendre, en effet, devant une compagnie de mitrailleurs rangée en bataille.
Et alors se passa une chose inouïe, à laquelle je n'eusse pas voulu croire une demi-heure plus tôt.
Un officier se tenait à quelques pas du fourgon d'où nous descendions. Brusquement il s'avança, suivi de quelques soldats en armes. Avant que j'eusse compris un seul de ses gestes, j'étais séparé de Pigeon.
Une escorte l'emmenait à droite; la mienne m'entraînait à gauche.
Il me sembla entendre au dehors de grands cris, comme si une foule de curieux eût assiégé la gare. Je ne pouvais croire que ce fût pour nous voir... Et pourtant c'était la vérité.
Annoncée par les petits journaux japonais qui venaient d'éclore à San-Francisco, sous les noms les plus variés, que suivait toujours le mot chimboun, c'est-à-dire gazette, notre arrivée faisait sensation.
Il fallait pour cela qu'on eût dit au peuple des choses extraordinaires sur notre compte. Trop vite je devinai ce qu'on avait dû lui raconter, au peuple japonais de Harouko! N'étions-nous pas deux amis d'Erickson, le terrible tueur d'hommes dont un poignard valeureux autant qu'adroit venait de débarrasser le Japon?
A ce titre nous méritions d'être montrés aux cent mille Jaunes qui peuplaient déjà la cité-reine de l'Occident.
Ces voix confuses que j'entendais, c'étaient bien celles du populo avide de contempler nos têtes, en attendant qu'on lui donnât le spectacle de leur ablation par le coupe-coupe! Je frémissais de tout mon être en me demandant par quelles épreuves préliminaires la barbarie raffinée de nos geôliers allait nous faire passer tous les deux, lorsque je me trouvai poussé vers un bâtiment de la gare et enfermé dans une chambre avec deux soldats.
Au milieu de cette chambre s'apercevait une espèce de fourneau en briques, allumé. Au-dessus s'évasait une grande cuve en bois durci ou en métal; je n'avais pas le loisir d'y regarder de très près. Ce que je vis bien c'est qu'elle fumait.
Des ressouvenirs me vinrent de la propreté Japonaise, au geste que me fit l'un des soldats. Il voulait dire: déshabille-toi et grimpe là-dedans.
C'était un bain d'eau très chaude, comme les prennent plusieurs fois par jour les Japs des deux sexes.
J'obtempérai avec satisfaction, car ces deux jours de voyage m'avaient abominablement fatigué et sali. Je me déshabillai vite et me plongeai gravement dans la cuve, où ma foi je fusse resté des heures avec délices; mais au bout de cinq minutes le même soldat me fit dans son langage des admonestations dont je devinai le sens.
Comme je sortais du bain il me lança une serviette en papier. Je n'aime pas bien ce genre d'essuyage et je ne saurais vous le recommander. Mais à la guerre comme à la guerre! Je frottai tant que je pus mon corps avec le papier pressé en tampon. Bientôt j'étendis la main vers mes habits, que j'avais pliés avec soin et déposés à terre, car au Japon les meubles sont inconnus, et l'invasion jaune supprimait déjà les chaises dans les établissements publics de Harouko.
Mais aussitôt l'autre soldat fit un geste pour m'indiquer que je devais endosser des vêtements japonais, comme les siens.
D'une main dédaigneuse il me tendait un complet à la mode de son pays. Je fus bien obligé d'en passer par là, puisqu'il le voulait. Mais ce ne fut point sans embarras. Par où commencer? Par les pieds ou par la tête? Leurs accoutrements sont si différents des nôtres!
J'optai pour un processus à la mode de chez nous, et je japonisai d'abord mes pieds.
L'homme me tendait au surplus les tabis en premier: c'était une indication. Dire que mes pieds ne furent pas surpris de se trouver emprisonnés dans les singulières chaussettes de peau que sont les tabis, avec deux poches seulement, l'une pour le pouce, l'autre pour les quatre doigts, ce serait mentir. Mes pieds protestèrent; mais ils perdaient leur temps. La main du Jap se tendait de nouveau vers moi, pour me passer les guêtas, qui n'ont rien de commun avec nos guêtres, car ce sont des galoches de bois d'une forme baroque.
Je montai dans les galoches de bois. Mon corps restait dans un état de complète nudité, mais c'était là un détail sans importance. Je savais qu'au Japon le monsieur qui se promène tout nu n'est pas rare. Personne n'y fait attention.
Il s'agissait de me vêtir pourtant, et de sortir de la salle de bains, car une porte s'était entr'ouverte pour laisser passer la tête d'un sergent ronchonneur, lequel avait gourmandé ses hommes, et moi aussi, sans nul doute, d'être si longs dans les opérations balnéaires.
Le soldat me passa une espèce de chemise en coton, plutôt courte; puis une ceinture en mousseline assez large que j'appliquai naïvement dessus. Mais aussitôt les deux compagnons se mirent à rire de ma gaucherie et me firent comprendre que c'était par-dessous qu'il fallait la placer.
Alors je reçus un kimono couleur de poire cuite. Cette robe de chambre nationale, à manches pagodes, n'est pas longue à enfiler. J'en fus revêtu en une seconde.
— Obi, me dit le soldat valet de chambre.
Et de ses propres doigts il me noua autour du corps la ceinture en crépon vulgaire qu'on nomme l'obi.
D'un geste il m'indiqua la poche du kimono, dans la manche gauche. Je n'avais rien à y mettre au surplus, pas même un mouchoir.
Je demandai si l'Intendance qui se préoccupait ainsi de me déguiser en Japonais ne délivrait pas aux prisonniers cet ustensile si commode, indispensable à tout homme civilisé.
Les deux soldats se mirent à rire en me voyant faire le geste d'un rustre qui se mouche avec les doigts. Après avoir fourré les mains dans le carton qui renfermait quelques instants plus tôt mes vêtements, ils y découvrirent une feuille de papier de soie qu'ils me passèrent, pliée en huit. Ce fut le seul objet que j'eusse à glisser dans ma poche.
Je cherchai des yeux une coiffure originale qui complétât l'accoutrement; mais il n'y en avait point. Mon habilleur prit à terre mon chapeau mexicain, acheté à Charleston, et me le campa sur la tête. J'avais ainsi le corps accommodé à l'asiatique et le chef couvert à l'américaine.
Il me sembla bien que je dusse être grotesque, ainsi métamorphosé. J'en acquis la certitude en regardant les vrais Japonais, qui circulaient ainsi affublés dans les rues, nationalistes quant aux vêtements, réformistes quant à la coiffure.
Aussitôt la porte fut ouverte et je me retrouvai devant la compagnie de mitrailleurs, commandée par trois officiers.
Mais quel étrange véhicule m'attendait! Et quel cortège avait préparé pour nous exhiber au peuple l'amour-propre des autorités!
Je vis comme une caisse de landau, faite en bambou. Les ouvertures en étaient, de chaque côté, très larges; un store roulé les surmontait.

Il me sembla bien que je dusse être
grotesque ainsi métamorphosé. (Page 556.)
Sur le toit de ce vaste panier passait une longue poutre rouge, que retenaient des crampons en fer. De chaque côté de la poutre, en avant comme en arrière du sinistre palanquin dans lequel on allait me faire asseoir se tenaient des coulies, habillés en tout et pour tout d'une ceinture de lutteur. C'étaient mes chevaux. |
Un ordre bref du capitaine de la compagnie et je me trouvai insinué, je ne sais trop comment, dans ce cango de procession que saisirent aussitôt les quatre porteurs.
J'avais eu le temps d'apercevoir des trompettes. Quand l'ordre fut donné de se mettre en route, elles se mirent à trompetter.
Alors une formidable clameur s'éleva de l'autre côté de la gare. Nous traversâmes une cour déjà peuplée de tous les employés, hommes d'équipe, tâcherons et autres artisans du chemin de fer. Ils poussèrent en me voyant de petits gloussements. J'eus un avant-goût de la réception que me préparait la foule.
Et vraiment quand la demi-compagnie qui formait la tête apparut devant la gare, quand je parus surtout, enfoncé le plus que je pouvais dans l'abominable chaise à porteurs, ce fut un vacarme assourdissant.
Il y avait de chaque côté des centaines et des milliers de Japonais, de vieux hommes, des gamins, des femmes et des petites filles. Tous et toutes ouvraient à mon aspect des yeux étonnés et une bouche féroce, dans le rictus de laquelle je devinais l'orgueil du triomphe, la joie d'avoir abattu le monstre, l'Erickson terrible dont les géniales applications des forces naturelles à la guerre avaient tant fait de mal au Japon.
Et ce sentiment que je devinais, cette foule, joyeusement hostile, ou cruellement joyeuse, l'exprimait en des imprécations, en des lazzis dont je ne pouvais saisir le sens. Je traduisais tout de même!
Le soleil égayait les gens et les choses. Je ne m'étais pas trompé. On nous promenait à travers la ville comme des bêtes curieuses. Je dis nous parce que derrière mon palanquin venait, à quelques pas, celui de Pigeon. J'entendais ses trompettes et les vociférations qui recommençaient sur son passage.
On parcourut ainsi des avenues larges, coupées à angle droit, bâties de maisons colossales à quinze et vingt étages, témoins à présent muets de la prospérité américaine. Désertées toutes par leurs locataires blancs, ces casernes me parurent lamentables dans leur carrure muette.
Mais on alla palabrer aussi dans les rues montueuses qui aboutissent aux falaises, sur les collines sillonnées de tramways funiculaires.
Là, le Japon avait déjà pris possession du sol. Là des milliers de maisons en papier s'étaient édifiées dans la rue même, qu'elles rapetissaient, dans les jardins enchantés des villas de pierre et de marbre que la civilisation jaune dédaignait d'occuper, même au titre de « pays conquis ».
Je mesurais, en voyant toutes ces maisonnettes en bois sans étages, avec un étage au plus, l'abîme qui séparera toujours notre civilisation de celle des Japs, notre confortable de leur rusticité minable, notre bien-vivre de leur paupérisme, notre bonne chère de leur poignée de riz.
Et toujours la foule ameutée, dans ces rues devenues étroites, grouillantes, poussait les mêmes cris en me montrant au doigt.
Les femmes me jetaient de petites pièces de monnaie, des zénis, comme à un pauvre. Mon cabriolet en était bientôt jonché. Je m'occupai à en ramasser quelques-unes que je glissai dans ma manche, sans trop savoir pourquoi. En analysant ce geste je lui découvris un mobile tout simple: j'avais honte, je me cachais par intervalles.
Le premier moment de curiosité passé, je ne regardais déjà plus ces milliers d'individus plus petits que nous, tout jaunes, en kimonos multicolores et en guêtas. Je fuyais leurs yeux insulteurs et je pensais au lendemain.
Que serait-il le lendemain de cette mascarade, de cette exhibition puérile à travers une ville surexcitée par le fanatisme?
Etait-ce un châtiment qu'on nous infligeait là? Serait-ce par hasard tout le châtiment, et nous tiendrait-on quitte avec cette promenade du genre « boeuf gras »?
Si le supplice de la décollation était au bout, par hasard?
La mort sans jugement? C'était dans les choses possibles?
Je revenais ainsi à ma première idée, et en dépit des hurlements de la foule, je n'avais plus d'yeux que pour la natte qui ornait le fond du palanquin.
Mais la justice japonaise se montra moins expéditive. La procession des captifs dura trois grandes heures. J'en jugeai ainsi, du moins, à la position du soleil.
On défila devant l'Hôtel de Ville, après avoir circulé dans le Parc de la Porte d'Or, où se promenait derrière des fils de fer un troupeau de buffles sauvages; dans le Jardin des Enfants, où, par grappes, les mômes japonais m'accueillirent en faisant toutes sortes de grimaces triomphantes.
On parcourut Market Street, la grande voie commerçante, et Pacific Avenue, où les ploutocrates américains ont édifié de si belles résidences. J'étais renseigné sur l'itinéraire par les plaques indicatrices que le gouverneur japonais laissait encore pour quelque temps scellées dans les murs.
Tout à coup une odeur nauséabonde me prit à la gorge. L'aspect des voies et de la foule avait changé totalement. C'était montueux, tortueux et sale.
Chinatown! pensai-je en apercevant à droite et à gauche du cortège dont je formais l'attraction avec mon pauvre lieutenant, des théories de Célestes pansus, ventrus, hideux sous leur graisse pendante.

Chinatown! C'était le comble. Nous exhiber jusque dans ce
quartier misérable où grouille l'ignominie chinoise.(Page 558.)
Chinatown! C'était le comble
Nous promener comme des bêtes curieuses jusque dans ce quartier misérable où grouillait l'ignominie chinoise!
Nous exposer aux rires imbéciles de ces fumeurs d'opium, abrutis par leur vice, qui scandaient avec insolence le pas rythmé des soldats!
Du coup je compris tout l'orgueil des Japonais. La vanité qu'ils tiraient de notre capture les enivrait au point qu'ils s'abaissaient jusqu'à nous produire à travers la Chinatown!
De chaque côté des rues en pente qui zigzaguent au travers de la cité pestilentielle j'apercevais un spectacle qui me rappelait des voyages antérieurs aux pays jaunes: les échoppes des marchands de victuaille putréfiée, basses, dans le sous-sol des baraques en papier aux toits retroussés; les mâts plantés devant les cases, avec des oriflammes et des banderoles décolorées depuis la dernière fête qui les vit arborer; les écrivains publics accroupis sur leur tâche, avec le pinceau et l'encrier, au milieu d'un troupeau de brutes ignares, désireuses de faire dire au papier quelques mensonges utiles à leurs intérêts; les rôtisseurs de viande pourrie; les barbiers ambulants qui, sur le sol même de la rue, rasent du soir au matin les Célestes devant leur porte; les charrons et les maréchaux qui ferrent voitures et chevaux au milieu de la voie publique. Et des théories de femmes hideuses, d'enfants accoutrés comme des singes font la foule à côté des magots hébétés qui sont sortis de ces tanières pour nous voir... C'est humiliant plus que tout le reste.
Les trompettes jouent plus fort que jamais, et tout le temps que dure cette traversée de la ville chinoise, ce sont les soldats de l'escorte qui interpellent les badauds, qui les accablent de brocards, auxquels la plus apathique des foules se contente de riposter par un sourire béat.
Au milieu des cris féroces qui se croisent autour de ma chaise, je ne peux m'empêcher de revoir par la pensée la voiture grillagée des fous, qui nous traînait à Charleston, et aussi le défilé fantomatique des guerriers d'autrefois, entr'aperçus dans une hallucination, au milieu des nuées, de la nacelle de l'Austral.
Par un extraordinaire pressentiment j'avais eu, ce jour-là, l'intuition d'une promenade de ce genre. Hélas! cette fois-ci, ce n'était plus une vision de rêve.
J'y étais, dans le palanquin d'infamie! Et fort mal, car la torture morale était atroce.
Enfin, comme si ce parcours à travers la ville chinoise eût constitué le dernier numéro du spectacle, on fit halte aux premières maisons européennes qui apparurent dans le Sud.
Je compris, aux commandements criés de deux côtés à la fois, devant moi et derrière, que l'escorte de Pigeon et Pigeon lui-même allaient rompre harmonie du cortège et s'éclipser dans une direction tandis que mes mitrailleurs m'emmèneraient dans une autre.
Ce qui fut fait.
Un quart d'heure de marche encore dans la ville, au hasard de quartiers uniquement construits en maisonnettes nipponnes, et la compagnie s'arrêta devant un palais en papier, orné de colonnes de bois bardées de fer et de lanternes aux attributs fantastiques.
A peine posé à terre, le cango s'inclina brusquement.
Deux bras me happèrent et me sortirent de là-dedans.
Nouvelle manoeuvre. En avant marche! Et me voilà dans la prison qui m'est destinée. Ce sera vraisemblablement le dernier toit sous lequel je coucherai avant de mourir.
— Allons! me dis-je avec une philosophie qui se résignait peu à peu. Quand je serai mort et enterré je n'aurai plus besoin d'abri.
J'étais fatigué aussi par le va-et-vient de la chaise à porteurs. A la longue le pas des coulies, toujours mesuré à la même lenteur comme par un métronome, m'avait énervé, abasourdi.
J'éprouvais une grande envie de dormir.
Le rétablissement de mon individu sur ses deux jambes me réveilla. Lorsqu'il fallut marcher sur les guêtas en bois pour gravir les marches de la prison, je faillis tomber plusieurs fois. A chaque fléchissement de mon corps un soldat s'avançait et me recevait sur son avant-bras.
Enfin la parade ridicule était terminée.
Le général Yoritomo, le gouverneur de Harouko, le Mikado lui-même devaient être satisfaits. Le peuple nous avait assez vus et revus!
Un geôlier me prit en charge, toujours avec des mots que je ne comprenais pas; je le suivis, entre deux yacounins, sorte d'agents de la police, et incontinent on m'écroua de nouveau, dans cette prison très japonaise.
J'y retrouvai une seconde cage, fixe celle-là, pour me changer de celle qui m'avait véhiculé pendant trois heures. J'ignorais que le prisonnier Japonais fût ainsi claustré comme un oiseau.
La pièce où j'entrai s'allongeait comme un corridor entre deux files de ces cages. Les unes présentaient un dos en bois plein, les autres étaient garnies sur trois côtés de barreaux en bambou.
Ma niche mesurait de trois à quatre mètres de long, autant de large, et autant de haut. Le sol y était recouvert de mauvaises nattes. Pour tout mobilier, j'aperçus dans un coin deux petits baquets, l'un rempli d'eau pour boire sans doute; l'autre vide, pour expulser. C'était ignoble.
En dépit de la philosophie dont je me croyais cuirassé, une subite tristesse m'envahit lorsque la porte fut refermée à triple tour et verrouillée par le geôlier. Une lampe électrique éclairait le corridor. Je devinai à leur silence que les cases qui se trouvaient en face de la mienne étaient vides.

Ma cage mesurait de trois à quatre mètres de
long, autant de large et autant de haut. (Page 559.)
Il n'y avait plus rien à espérer désormais, que la délivrance par la mort dans le plus court délai possible, et, si possible aussi, sans raffinement de cruauté, sans supplices, sans découpage du patient en dix mille morceaux, sans amputation des pieds, puis des mains, à raison d'un membre par jour, sans arrachage des ongles; ni des paupières, ni de la langue, ni des oreilles...
En quelques minutes tous les supplices que la cruauté asiatique a religieusement conservés depuis des siècles défilèrent devant mes yeux. Je me voyais, comme dans une glace, attaché au gibet, exposé plusieurs jours: avec les bras en croix, les lèvres implorant de l'eau qu'un ignoble drôle approchait de moi pour l'en éloigner deux cent quarante fois par vingt-quatre heures.
La situation dans laquelle je me trouvais était sans issue, cette fois.
Séparé de Pigeon, que pouvais-je faire? Je ne savais pas quinze mots de japonais.
Eussé-je parlé la langue que l'avantage n'eût pas été bien grand.
A six heures environ — j'estimai d'après le temps qui me parut s'être écoulé depuis le coucher du soleil — un geôlier de seconde classe sans doute, un nain au faciès ridé comme une vieille pomme, m'apporta du poisson salé et du riz.
Puis vers huit heures il installa un fouton petit matelas pour la nuit, le banc de bois avec son coussinet de paille de riz recouvert de papier, et il disparut.
Je passai dans cette cage quatre nuits et trois jours, sans voir d'autres vivants que le nain jaune qui m'apportait mes trois repas, à sept heures du matin, à midi et à sept heures du soir. Et toujours riz, riz, poisson salé.
Il faisait le ménage le matin en quelques minutes et marmottait des mots qui restaient pour moi vides de sens. C'était sa plus longue pause.
Chaque jour j'espérais que dans ce couloir où s'allongeaient les dos pleins de cinq autres cases semblables à la mienne, on amènerait quelque assassin, quelque voleur arrêté dans la ville, et que cette incarcération provoquerait du va-et-vient, c'est-à-dire un peu de variété dans mon existence.
Vain espoir! Le néant, le vide. Muré vivant! Il me semblait que j'eusse été enfermé dans cet in pace pour n'en plus sortir jamais.
Que faisait-on en Europe pendant que je croupissais dans cette sentine?
Que devenait M. Martin du Bois?
Et miss Ada? Etait-elle au moins arrivée sans nouvelles aventures, avec le bon Marcel, à Bordeaux ou au Havre?
Et Tom Davis? Notre séparation ne datait que de quelques jours. Il avait pris l'air pour Saint-Louis et Washington. Où était-il à cette heure?
Et Pigeon? Que faisait-on de lui? Peut-être ne le reverrais-je jamais, ni les autres?
Décidément ma bonne étoile m'avait abandonné et mes affaires tournaient bien mal. Non seulement j'étais pris, enfermé, condamné à mourir dans une geôle, mais l'An 2.000 ne publiait plus rien de moi. Que pensaient les lecteurs de ce correspondant qui ne correspondait plus?
Ils le croyaient tué, peut-être, et c'était là une supposition flatteuse, très acceptable en somme après les aventures dont j'avais été victime.
Mais tout cela ne faisait pas les affaires du journal. Encore une fois il ne m'avait pas confirmé dans ma mission pour que je me fisse prendre sottement.
Avais-je done eu tort de me mêler de si près aux affaires d'Erickson? J'eusse mieux fait peut-être de me tenir à distance et de conter les événements de visu, mais d'un de visu assez éloigné du théâtre des hostilités pour n'être pas dangereux...
En ces quatre nuits je ne dormis pas quatre heures. Aussi devais-je paraître singulièrement fatigué à l'interprète-officier qui vint ce matin-là, le 30 novembre, me dire en excellent anglais:
— Monsieur, veuillez me suivre au conseil de guerre. Il se réunit dans un quart d'heure pour vous juger.
— Seul? demandai-je aussitôt.
— Non. Votre complice est déjà installé sur la natte.
Mon complice!
Pauvre Pigeon!
Sur la natte!
— C'est bien, monsieur, fis-je. Je vous suis.
Et je suivis le petit bonhomme.
A la porte de la prison quatre soldats en armes m'emboîtèrent le pas.
Ce fut bref.
Deux cours à traverser et nous entrons — après avoir quitté nos guêtas — dans une salle coupée en deux par une estrade.
J'y trouve deux yacounins qui semblent destinés à me surveiller pendant l'audience. Ce n'est pas sans une vive émotion, je vous l'assure, que je m'avance dans la salle.
Le conseil de guerre y est réuni sur l'estrade. Des officiers de plusieurs grades le composent. Ils sont vêtus à l'européenne, bien entendu, puisque c'est notre costume que les Nippons ont adopté dès la fin du siècle dernier pour faire la guerre; mais par un impératif besoin de retourner aux traditions ancestrales, ces officiers modernistes sont assis sur leurs talons comme leurs aînés, les daîmios et samouraïs d'autrefois.
Chassez le naturel, il revient au galop! J'avais entendu dire par les voyageurs que notre accoutrement gêne le Japonais dans ses habitudes; qu'il n'est adopté par lui que pour le décorum, la pose, le dehors et qu'aussitôt rentré à la maison le plus grand plaisir d'un Jaune européanisé consiste à dépouiller notre toilette compliquée, pour reprendre, avec le kimono, les attitudes de ses pères.
Aussi ne fus-je qu'à moitié surpris de me trouver en face d'une réelle japonerie de paravent.

Sur l'estrade, le Conseil de guerre était réuni. (Page 560.)
Chacun des juges avait à la main un éventail, bien qu'il ne fit guère chaud dans la salle, dépourvue de toute espèce de poêle. Mais je compris ce jour-là que l'éventail aide surtout les Orientaux à dissimuler leurs sentiments. Ce qui m'étonna, ce fut le paravent, précisément; car il y en avait un dans l'affaire, derrière le dos du président.
Paravent mystérieux, que faisais-tu là?
Quelle puissance occulte s'y cachait?
Je ne pouvais le savoir, et pour cause. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une personnalité supérieure s'y dissimulait, invisible et présente, prête à inonder mes juges de ses clartés qui devaient être spécialement brillantes, car pendant l'audience sept ou huit petits papiers furent remis au tribunal par une main prompte à rentrer derrière le meuble mystérieux.
Il n'y avait dans cette pièce ni une chaise, ni une table, ni un banc.
A la mode du Japon il n'y avait rien, que deux nattes à peu près propres. Elles marquaient, devant l'estrade, la place des accusés.
Je fus invité par l'officier interprète à m'agenouiller sur celle de droite.
Pigeon était déjà, en timide posture, accroupi sur l'autre.
Je l'imitai, furieux, comme on pense, de m'humilier à ce point. Mais je réfléchis qu'il fallait en passer par là, la force primant le droit. Je me dis aussi que l'attitude n'avait rien qui parût extraordinaire en ce pays où l'on n'en connaissait point d'autre. Je pensai au vieil Ovide écrivant son vers fameux au milieu des Daces:
Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis.
Au milieu de ces Japonais accroupis nous étions, nous, les Barbares.
Nous eussions trouvé tout simple qu'ils nous jugeassent debout. Ainsi se passent les choses en Europe. Mais dans leurs îles c'est le contraire. Ils faisaient à Harouko comme chez eux, puisqu'ils y étaient désormais chez eux.
Silence complet dans la salle. On se fût cru au temple. Tandis que les yacounins s'installaient à nos côtés, je regardai sournoisement les membres du tribunal. A l'examen que je fis de leurs galons je compris qu'il n'y avait là que trois juges, comme aux Enfers. Celui qui paraissait « faire le quatrième » n'était qu'un secrétaire, chargé de communiquer au président les papiers qu'on rédigeait derrière le paravent. Les autres, confits dans la lecture de notre dossier sans doute, représentaient des greffiers.
Une fois de plus, à cette minute singulièrement troublante, où ma vie et celle de mon collaborateur allaient être, sans aucun doute, condamnées à finir sans délai, la folle du logis se mit à vagabonder à travers de cocasses réminiscences. Personne ne disant rien, je n'osais bouger, ni parler, ni même regarder Pigeon autrement qu'à la dérobée.
Comme je pouvais supposer qu'il y eût dans ce silence prolongé l'observation d'un rite, je laissais ma mémoire errer parmi des souvenirs de lectures, de récits entendus.
En considérant l'attirail un peu forain de cette justice extrême-orientale, je me remémorais un livre curieux, publié voilà bien des années par une Américaine, Mme Patton: Japanese Topsyturvydom, ce qui peut se traduire en français par: l'Art de tout faire à rebours chez les Japonais.
J'avais conservé le souvenir d'exemples curieux; ils me revenaient à l'esprit tandis que je demeurais là, courbé devant ce Minos, cet Eaque et ce Rhadamante qui ne disaient rien.
Ainsi je me rappelais que les Japonais boivent le vin, quand ils en boivent, avant les repas: que les entremets de chez nous sont servis chez eux en premier; que la politesse leur commande de quitter les chaussures en entrant dans une maison et non point la coiffure; qu'ils montent à cheval du côté droit; qu'ils font tourner leurs clefs du côté gauche; que le mot fin dans leurs livres se trouve où nous mettons, nous, le titre, c'est-à-dire le commencement; que leurs imprimeurs y placent les notes en haut des pages tandis que nous les mettons, nous, en bas; que les meilleures chambres de leurs maisons se trouvent derrière, tandis que nous les plaçons toujours devant; que les vêtements blancs, qui sont chez nous symboliques de la joie, font chez eux l'ordinaire deuil.
Et je concluais que ces juges accroupis manquaient vraiment de decorum, lorsque derrière mon dos l'interprète poussa un petit sifflement.
Je n'osais me retourner; mais ce bruit caractéristique suffisait à me renseigner. Je savais que le Japonais salue en se courbant très bas, cependant qu'il imite le bruit strident du serpent à sonnettes.
C'était un signal. L'audience allait s'ouvrir. L'un des greffiers commença par lire, sans bouger, d'un ton nasillard, ce que nous appelons l'acte d'accusation.
Cette mélopée dura certainement quarante minutes. Jamais je ne me suis autant ennuyé.
Le bonhomme chantonnait dans sa langue, incompréhensible pour nous, des chi, des cho, des chu à n'en plus finir.
Aucun des juges ne semblait l'écouter. Ces guerriers vêtus à la mode de chez nous paraissaient préoccupés d'autre chose. Ils se faisaient des confidences derrière l'éventail.
Le président correspondait de temps à autre avec le paravent. Grâce à cette connivence qui m'intriguait, nous eûmes de quoi réveiller par trois ou quatre fois notre attention.
J'avais les reins en capilotade. Essayez de vous tenir agenouillé longtemps, dans l'attitude du recueillement, et vous m'en direz des nouvelles.
Enfin le bonhomme finit par arriver au bout de son rouleau. C'était le cas de le dire, car ce qu'il nous avait lu tenait sur un papyrus méthodiquement déplié. Encore une manière de faire qui se différencie de la nôtre, pour se rapprocher de celle des Egyptiens!
L'interprète s'avança aussitôt pour saluer les juges d'un sifflement, puis il prit place à côté de l'un des yacounins, à ma droite, prêt à traduire les questions que lui soumettrait le tribunal et les réponses que nous allions faire.
Le président nous demanda nos noms, notre nationalité, nos qualités, ce que nous faisions en Amérique; pourquoi nous étions venus avec Erickson dans l'Arizona; ce que nous savions des installations du maréchal sur le territoire des Etats-Unis; si nous étions à Key-West le jour de la pluie en cercle; à la Nouvelle-Orléans la nuit de la congélation du bras Bienville; avec l'escadre anglaise — dont il qualifia durement la trahison — durant l'incendie sur la mer. Et quoi encore!
Il voulait tout savoir, tout connaître. Sous le prétexte d'établir notre complicité dans les actes de guerre atroces commis par le machinisme américain contre les Japonais, ce gros homme — c'était une manière de poussah dont la taille ne me disait rien à cause de l'attitude accroupie, mais je voyais ses bajoues développées à l'excès — nous retournait sur le gril, recommençant dix fois les mêmes questions, en posant de nouvelles dont le texte lui était expédié par le paravent.
Pigeon fut héroïque. Moi aussi, qu'on me permette de le dire.
Ni l'un ni l'autre nous ne laissâmes échapper rien qui pût ressembler à une révélation. Héroïsme facile, direz-vous peut-être, puisque nous ne savions rien. Tout de même l'intention de nous refuser à toute confidence dangereuse nous était comptée pour quelque chose au tribunal de notre conscience.
Je ne pus m'empêcher de songer, pendant un répit de quelques minutes, à notre bizarre situation. Un mois plus tôt, nous étions les amis des Japonais et les ennemis des Américains.
A cette heure c'était le contraire.
Ma foi le contraire m'allait beaucoup mieux. Il me paraissait la logique même, le contraire! Et j'étais si nettement satisfait de jouer le jeu des Blancs, en cette circonstance, contre ces Jaunes antipathiques que vers la fin de l'interrogatoire je prenais un ton presque impertinent. Et Pigeon aussi!
L'interprète me parut suffoqué par certaines de nos réponses, et je crois bien qu'il s'abstint, par prudence pour son échine, de les traduire exactement au tribunal.
Cet interrogatoire dura encore quarante minutes. J'étais exténué.
Un boy apporta des bols de riz aux juges et aux greffiers.
Les yacounins et l'interprète se brossèrent le ventre, suivant le mot de chez nous, et les inculpés aussi. |
Quand la collation fut achevée, le président nous dit avec un mauvais sourire:
— Tout cela, messieurs, est fort bien, mais en somme vous avez été pris les armes à la main, combattant contre des éclaireurs chinois que commandaient nos officiers. Vous aviez même tué de vos armes deux éclaireurs alliés du Japon. Quand un ennemi chez vous, tue l'un des vôtres, que lui fait-on?
Moi. — On lui coupe la tête.
PIGEON. — En temps de guerre on le fusille...
LE PRÉSIDENT... — Alors que pensez-vous du sort qui vous attend ici?
Moi. — Vous nous condamnerez à mourir.
LE PRÉSIDENT. — Parfaitement.
Les trois juges se consultèrent derrière les éventails.
Puis le gros poussah débita la formule qui prononçait contre nous la peine capitale, précédée de la petite torture. Nous subirions notre double peine le lendemain.
Aux mots de « petite torture » Pigeon s'effondra, livide.
Je sentais que le même accident allait m'échoir lorsqu'un grand bruit se fit à la porte.
Le tribunal, qui allait se lever, demeura en séance, attentif aux paroles véhémentes que poussait une voix rauque, bien japonaise, dont le timbre ne m'était pas inconnu.
Mais j'étais si abattu sous cette condamnation à la torture, fût-elle « petite », que je ne regardai même pas qui entrait.
C'était Wami!
Du coup je repris courage. Il me sembla que ma bonne étoile, un moment éclipsée, reparût dans toute sa splendeur.
Wami!
Debout à quatre pas de nous, dans son uniforme de monte-en-l'air, le lieutenant saluait le tribunal aussi profondément que l'avait fait tout à l'heure l'interprète, et comme lui, accompagnait sa révérence d'un sifflement prolongé.
Après s'être incliné pendant une belle minute, toujours sifflant, le jeune officier se releva. Je compris que le président, un peu étonné de son entrée en scène, lui demandait ce qu'il venait faire au tribunal.
Mais aussitôt le paravent remua. La main discrète passa un petit papier de plus au secrétaire, qui le transmit au major, car c'était un commandant que ce gros homme.
Ayant lu, il changea de ton et parut désireux d'entendre les explications que Wami s'apprêtait à lui fournir sur notre cas.
Après avoir consulté ses assesseurs derrière l'éventail, il donna la parole au témoin inattendu. C'était le seul qui pût être cité à notre procès, et l'on pouvait dire qu'il arrivait un peu tard, puisque la condamnation était déjà prononcée.
Mais nous étions encore là. Le président fit comprendre à chacun que l'audience était reprise.
L'interprète nous traduisit ces quelques mots. Ce furent les seuls, ou presque, dont il nous honora, car à partir de ce moment rien de ce qui se dit devant le tribunal ne nous fut communiqué, à part la sentence finale.
Et pourtant il en coula des flots de paroles, des torrents de phrases! Wami monologua bien pendant trois quarts d'heure.
Que disait-il? Que pouvait-il bien dire à nos juges?
Parlait-il pour nous ou contre nous?
Il me sembla tout indiqué que ce fût pour nous. En dépit de la rupture subite des bons rapports que la France entretenait avec le Japon depuis le commencement du siècle; encore qu'on fût devenu subitement des ennemis, les Japs et nous, d'amis qu'on était si peu de jours auparavant, il me semblait impossible que la haine fût venue aussi tôt abolir le sentiment de l'amitié que Wami professait sans doute pour ses anciens compagnons d'aventures, pour moi surtout.
Tandis qu'il débitait de sa voix flûtée, avec des gestes persuasifs, une plaidoirie dont le sens total m'échappait, je revoyais les diverses phases de la commune aventure qui nous avait liés l'un à l'autre.
Mon imagination, n'ayant rien à faire, remontait au jour de son entrée dans le salon de M. Wouters, en compagnie de ses collègues Mourata, Sikawa, Motomi et Narabo.
Je le voyais, diligent et rusé, mettre tout en ordre à bord de l'Austral. Puis c'était notre départ de Paris, départ sensationnel, triomphal, le voyage au-dessus de la Manche, la rencontre inopinée de Marcel en pleine mer, les pérégrinations dans Londres; sa sollicitude reconnaissante pour nos deux personnes, pour ces deux accusés qui se trouvaient accroupis là, devant lui, à la merci d'un tribunal japonais...
N'était-ce pas lui qui nous avait arrachés, Pigeon et moi, aux geôliers de la Tour de Londres, avec le concours dévoué de son ambassadeur?
Je revoyais ensuite la bataille aérienne, où il avait fait preuve de tant de sang-froid, où ses braves amis s'étaient élancés dans le vide avec un si beau mépris de la mort — de quelle mort!
C'était alors l'effarante course vers le Pôle, et l'accès de folie, et l'abattement, et le retour au sang-froid, à la bravoure, à la témérité native.
J'entrevoyais comme un cinématographe dont les images se déroulaient devant mes yeux, — devant mes yeux fixés sur la natte, car je n'osais les lever vers notre ancien compagnon, non plus que Pigeon, ni vers le tribunal.
Le retour de l'Austral désemparé vers des régions plus clémentes, le Magnus Lagaboete, où le petit lieutenant nous avait tant fait rire sous son déguisement féminin, l'entrepont du Minnesota, la chasse que les fous lui avaient donnée au War Insanes Asylum...
Puis c'était sa réapparition en servante, le coup de dent féroce au nègre, le coup de poignard au guetteur du sémaphore, le coup de poignard encore au second du Krakatoa... Mes sourcils se fronçaient à l'évocation de ces trois victimes sanglantes.
Et pourtant c'était pour nous aider, Marcel Duchemin et moi, à nous tirer d'affaire que le lieutenant Wami avait eu recours à ces moyens don't on n'a pas le temps de discuter l'emploi, quand il s'agit de sauver sa propre vie ou celle d'êtres qui vous sont chers.
Nous étions donc chers à ce petit homme jaune, puisqu'il avait agi avec tant de dévouement à notre égard?
Sans doute, Wami ne pouvait être pour nous qu'un défenseur chaleureux. Il avait appris à temps qu'on nous envoyait ad patres; à toute vitesse il accourait pour défendre ses anciens compagnons de guerre.
On ne passe pas impunément par les épreuves que nous avions connues ensemble. Il en reste une amitié profonde, sincère, qui ne s'atténue jamais.
Comment pouvais-je même me demander si Wami venait nous défendre? Douter c'était lui faire injure. Quel dommage que Pigeon ne pût me donner son avis! Mais je pensais bien qu'il avait là-dessus la même conviction que moi-même.
— Mets-toi à la place de ce petit Wami, me disais-je. Que ferais-tu? Redescendrais-tu du fond des cieux, où serait ton poste ordinaire, pour déposer contre lui? Non. Tu viendrais expliquer au tribunal des tas de choses qui modifieraient sa conviction, qui l'engageraient dans la voie de la clémence. Bref tu mettrais tout en oeuvre pour sauver la vie de ces deux camarades-là. C'est ce que fait notre ancien pilote de l'Austral, indubitablement.
Tout en raisonnant j'avais fini par lever la tête.
D'abord parce que la posture inclinée commençait à provoquer dans mes tempes des battements exagérés, précurseurs d'un étourdissement. Ensuite parce que les tons successifs que Wami employait pour faire triompher sa rhétorique m'intriguaient à mesure qu'ils gagnaient en acuité.
Après avoir été sobre au début, à l'exemple des grands avocats, notre lieutenant s'était échauffé.
Maintenant, au bout d'une longue demi-heure, à l'orée de sa péroraison, il s'emballait.
Aux petites phrases sautillantes du commencement de sa plaidoirie succédaient des cris gutturaux, des gloussements même, où je tâchais de deviner un moyen de persuasion familier aux orateurs japonais.
Il parlait, parlait, avec des gestes.
Je vis alors qu'il nous regardait d'un oeil déplaisant. Cette attitude me parut choquante, tout d'abord, mais je ne tardai pas à lui découvrir un mobile adroit.
Pour obtenir du tribunal quelque commutation importante de notre peine, — nous ne pouvions guère espérer autre chose — Wami faisait certainement celui qui ne tenait pas à notre sympathie.
C'était clair. Il nous jetait à l'eau, en tant que Français, devenus en quelques jours les ennemis de son cher Japon; mais pour nous repêcher par quelque artifice.
Sans doute il déclarait que nous n'étions pour rien dans les affaires d'Erickson, que notre profession de chroniqueurs nous exposait à mettre de temps en temps un pied en territoire dangereux, mais que nos intentions, en somme, n'étaient point hostiles.
Sûrement il expliquait notre rôle de croque-notes de guerre, au jour le jour, exempts de toute animosité personnelle contre les sujets du Mikado.
Les juges, le président, les greffiers, les yacounins, l'interprète, le secrétaire du président me parurent impressionnés par le discours de notre défenseur improvisé. Ce qui me fit remarquer que l'on ne nous avait donné aucun avocat d'office, contrairement aux usages des pays civilisés.
Enfin Wami, ayant apostrophé le tribunal une dernière fois et nous ayant montré du doigt longuement, dans un geste où je relevai de l'arrogance et quelque férocité — feinte à n'en pas douter, pour amadouer le gros poussah et ses acolytes — lança des cris de victoire, comme des vivat, des hoch, des hourrah. Cependant je n'entendis point le traditionnel Banzaï.
Ah! que je regrettais de ne pas savoir le premier mot de cette langue japonaise, parlée devant moi par tout ce monde sans que je pusse rien y démêler!
Lorsque le lieutenant eut achevé, le président prit à son tour la parole. Ce fut pour contester certains points, car il y eut riposte et discussion, assez animée même.
Il ne paraissait qu'à demi convaincu lorsque des petits papiers sortirent du paravent par la voie ordinaire.
Alors ce fut fini. La cause était entendue.
Solennellement le président du conseil de guerre débita un jugement qui réformait le premier.
Il fallait bien qu'on nous le fît connaître. L'interprète nous déclara donc, sans un mot qui pût nous donner une idée de ce que Wami avait pu raconter pendant quarante-cinq minutes:
— La peine de mort est maintenue contre les deux accusés, ainsi que la petite torture qui la précédera de quelques heures. Toutefois l'exécution des supplices pourra être ajournée si telles autorités que nous désignons le jugent à propos.
On m'eût assommé sur le coup que je n'eusse pas été plus complètement étourdi.
Comment! Wami venait de plaider si longuement pour nous, et c'était tout ce que nous avions gagné à son intervention!
Une aggravation des peines! Car c'était aggraver les peines que de les laisser ainsi en suspens.
Nous étions ajournés sans délai! Avec je ne sais quelle porte ouverte au bon plaisir. De qui?
C'était incompréhensible.
Comment je me retrouvai dans ma cage, je n'en sais trop rien.
On me soutint sous les deux bras évidemment, pour me faire chausser mes guêtas à la porte de la salle et regagner la prison à tout petits pas.
Quand j'eus conscience des choses, il était nuit. Inutile de dire que je ne dormis guère,
Le petit jour, filtrant par les lucarnes de la geôle, me trouva sur mon séant, en proie à la plus atroce des hallucinations. Je voyais déjà les bourreaux apprêter leurs chevalets, le pal peut-être.
Sait-on jamais avec ces Asiatiques.?
Où pouvait bien commencer et finir ce qu'ils appelaient si délicatement la petite torture?
Je n'avais plus d'espoir en qui que ce fût, ni en quoi que ce fût, et charitablement j'étais en train de me demander comment mon pauvre Pigeon, que je savais si impressionnable, pourrait résister trois mois à la torture morale, prélude de l'autre et de l'infamante décollation, lorsqu'il me sembla entendre remuer à peu de distance de ma cage.
J'écoutai.
On remuait certainement. Des soupirs humains venaient de l'in-pace installé en face du mien. Evidemment on avait amené là un prisonnier la veille, pendant que j'étais au conseil de guerre, peut-être même pendant la nuit.
J'écoutai encore. Plus de doute, la cage voisine était occupée. J'avais un compagnon.
Ce fut une lueur de joie qui dura le temps des lueurs.
Un compagnon, me dis-je. Et après? Quel compagnon peut-on me donner ici? Quelque bandit de grand chemin. Eût-il tué père et mère que je serais indulgent pour sa férocité s'il parlait le français ou l'anglais. Mais c'est quelque Jap de la plus basse classe, qu'on a peut-être installé là-dedans pour me surveiller, tout bêtement. C'est un mouton. Aucun intérêt...
Et je me remis à soupirer, à recommencer l'échafaudage de mon échafaud, tel qu'il se dresserait à quelque jour sur une place publique, en ce pays ou ailleurs.
Comme le prisonnier faisait du bruit dans sa boîte, je demandai en français:
— Qui est là?
L'idée falote m'était venue qu'on avait peut-être, sur les instances de Wami, logé Pigeon près de moi, de telle sorte que nous pussions nous entretenir, fût-ce de loin, pendant les derniers jours qui nous restaient à vivre.
Mais l'homme qui s'agitait derrière les planches hermétiquement closes de la cage ne comprenait pas le français. Il ne répondit rien.
J'en conclus que c'était un Japonais. Au même instant une planchette céda sous les efforts qu'il faisait avec une longue pointe pour la déclouer. Je vis apparaître sa tête dans la déchirure qu'il venait de pratiquer au bas du panneau; c'était un Chinois, un vieux Chinois.
Sa peau ridée, ses os proéminents, sa barbe rare et grise dénonçaient un pauvre hère qui dépassait la soixantaine. Quelque sordide filou; un sorcier peut-être, un vagabond-détrousseur?
Je détournai la tête. La sienne, dans une contorsion que je trouvai très méritoire pour un vieux bonhomme de sa génération, m'apparut craintive, comme si le prisonnier eût redouté quelque délation de son voisin le prisonnier blanc.
Le geôlier-nain venait faire le ménage du matin, vite la planche du box où gisait le vieux Chinois fut replacée; je retins mon souffle tant que dura la visite du gnôme, car, je redoutais que la ruse du Chinois fût découverte.
Mais l'autre ne s'aperçut de rien. Dès qu'il fut parti, la planche se déplaça dans le bas du panneau et la figure bizarre de mon vieux compagnon d'infortune y reparut.
Quelle fut ma surprise lorsque j'entendis ce Chinois me demander: comment que ça va? dans un anglais abominablement incorrect, mais qui me parut aussi limpide que du Dickens. En un pareil moment on n'est guère difficile sur les syntaxes.
Il avait dit: comment que ça va? le vieux prisonnier, et il attendait que je lui répondisse, ce que je ne tardai pas à faire, car je craignais que « comment que ça va » ne fût tout son répertoire.
Mais non; il marmottait en anglais dénaturé d'autres lambeaux de phrases qu'il avait dû apprendre à Canton ou à Hong-Kong, sur les quais d'un port, en y traînant ses grègues de coulie misérable.
Je lui demandai avec intérêt ce qu'il faisait là, autrement dit pourquoi on l'avait emprisonné.
— Malice, me répondit-il en clignant deux yeux chassieux.
Sous le demi-jour qui nous venait des lucarnes, je vis sa figure décharnée se contracter dans un sourire grimaçant.
— Malice?
— Oui. Trouvé moyen de pénétrer ici. Beaucoup d'argent donné.
— A qui?
— A marchand de cercueils.
— Comprends pas.
C'était vrai; je ne comprenais pas. J'allais comprendre. Un rapide interrogatoire à voix basse me mit au courant.
— Homme riche venu de Fa, poursuivit le vieux.
— Fa?...
Je cherchais dans mes souvenirs ce que pouvait bien me rappeler ce mot: Fa. Il ne m'était pas inconnu.
Ce fut bientôt comme un choc délicieux que je reçus en plein coeur.
J'y étais!
Fa, Fa! C'était l'un des quatre ou cinq mots de chinois que je connusse: Fa! En chinois Fa veut dire la France, comme Jing signifie l'Angleterre, I l'Italie, et Pi la Belgique. Le chinois est la langue concise par excellence.
Un homme venu de Fa!... Un homme venu de France, beaucoup d'argent donné... Je devinais déjà, ou presque!
— Beaucoup d'argent donné à toi?
— Non. A marchand de cercueils. Moi pas besoin d'argent. Trop vieux. Toujours pauvre comme vieille sapèque. Mais si content de savoir que mort aurai beau cercueil! Homme venu de Fa offert cercueil plus beau que celui d'un tao-tai (1). Moi engagé pour venir apporter ici lettre.
(1) Fonctionnaire des grandes villes, sorte de préfet de police.
— Une lettre? Pour moi?
Etait-ce possible? Mais oui! C'était si bien possible que j'avais peut-être le salut à portée de ma main.
— Tu as reçu d'un homme venu de Fa une lettre que tu vas me donner?
— Oui.
— Fais voir.

Il me montra l'enveloppe jaune, je reconnus l'écriture
large et volontaire de Martin du Bois. (Page 569.)
Avec précaution le pauvre diable regarda dans le corridor, écouta si personne ne s'approchait de la porte.
Quand il fut tranquillisé, ses doigts décharnés cherchèrent au fond d'une poche qui se dissimulait sous ses habits crasseux: il en sortit une lettre, dont l'enveloppe jaune, toute fripée, était scellée à la cire.
Hélas! quatre mètres séparaient ma cage à barreaux du dos de son box.
Mon bras tendu pouvait à la rigueur réduire à trois mètres la distance, et le sien, allongé, en gagner encore un. Il resterait toujours deux mètres à franchir. Deux mètres! Un gouffre qui subsisterait entre les doigts du vieux et les miens pour s'opposer au passage de la lettre providentielle.
Comment m'y prendre pour l'amener dans ma boîte? Nous n'avions ni baguette, ni bâton; rien ni l'un ni l'autre.
— Montre l'écriture, dis-je en attendant l'idée qui ne pouvait manquer de lui venir, ou bien à moi.
Il exhiba de sa main tendue. L'écriture était large et volontaire. Celle de mon excellent patron!
Martin du Bois!
C'était une lettre de M. Martin!
Et M. Martin, c'était l'homme venu de Fa!
En Amérique! Voilà qui ne m'étonnait point puisque l'alliance entre les peuples de race blanche avait succédé à une guerre idiote. |
Mais dans quelle ville de l'Amérique ce Chinois avait-il été soudoyé, au prix d'un cercueil de luxe, par le directeur de l'An 2.000? Pas à San-Francisco sûrement. Où donc? Je le demandai à l'intéressé, en lui faisant comprendre qu'il devait soigneusement cacher cette lettre tant que nous n'aurions pas imaginé le moyen de la faire passer de son cachot dans le mien.
— Où l'as-tu rencontré, l'homme venu de Fa?
— A Vancouver.
— A Vancouver! Tu viens de Vancouver?
— Oui.
— Avec cette lettre? Et comment es-tu entré
— Ici prison des espions. Moi fait des bêtises pour être arrêté comme espion.
— Alors on va te juger bientôt?
— Pas avant dix jours.
— On te coupera la tête.
— Oui.
— Cela te paraît tout naturel?
— J'aurai un beau cercueil.
Et ses yeux s'ouvraient à une félicité parfaite.
— On n'ira pas le chercher à Vancouver, ton cercueil, surtout si tu as la tête coupée sur une place publique de Harouko.
— Il est ici. Acheté dans Chinatown, grand marchand, par ami. Payé cher, beaucoup cher. Bourreau est obligé d'accepter cercueil. On est content de mourir quand on sait qu'on aura beau cercueil.
— Allons tant mieux, mon bon, tant mieux, continuai-je en français. Quoique... de toi à moi, c'est pour une drôle de récompense que tu as vendu ta pauvre défroque à mon excellent patron. Enfin! Des goûts et des couleurs ne discutons pas.
Je repris en anglais:
— Comment faire pour que cette lettre arrive entre mes doigts?
— Ficelle.
— Tu en as une?
— Je vais en faire.
— Avec quoi?
— Couvertures, ce soir.
J'étais désappointé. Mais il fallait se rendre à l'évidence et patienter.
La journée me parut interminable. Enfin le soir vint, avec les couvertures que le geôlier-nain nous distribua.
Toute la nuit je restai éveillé, cherchant à deviner ce que contenait cette lettre, et pensant beaucoup aussi à ce Chinois sexagénaire, misérable comme Job, qui tressait silencieusement de la ficelle sans y voir et s'exposait à la mort pour le plaisir d'être enterré dans un cercueil de préfet.
Au petit jour j'étais éveillé. La planche s'écartait, comme la veille, au bas du box où mon Chinois n'avait cessé de préparer sa ficelle avec des filaments extraits de ses couvertures. D'une main lentement agitée le vieux bonhomme essaya de me la lancer; mais comme elle ne pesait pour ainsi dire rien, c'était un jeu inutile.
— Dommage, disait-il, qu'on n'ait pas quelque objet pour faire poids.
A la rigueur le clou dont il s'était servi pour détacher la planche pouvait être utilisé. Il allait le risquer lorsque je me souvins des zénis que j'avais ramassés dans le palanquin, pendant la procession d'infamie.
Je les retrouvai dans la poche de ma manche et lui en lançai deux.
Il eut tôt fait de les attacher à la tresse qu'il venait de confectionner.
Elle m'arriva; je la saisis vivement par un bout tandis que le messager providentiel fixait la lettre à l'autre bout. Je n'eus plus qu'à tirer, comme un pêcheur qui ramène sa ligne.
Quelle pêche! Une lettre du patron!
La demi-clarté qui nous était mesurée n'eût certes pas permis la lecture d'un volume; mais pour déchiffrer quelques lignes, on y voyait assez.
Je me jetai sur le document. Il n'y avait pas là de supercherie — l'idée d'une comédie sinistre m'était venue à l'esprit, par un excès de méfiance qui s'expliquait.
C'était bien l'écriture de M. Martin du Bois.
Je décachetai et je lus.
Mon cher ami.
Informé rapidement de vos dramatiques aventures, je suis arrivé à Vancouver pour y diriger en personne les opérations qui nous permettront de vous arracher bientôt, j'espère, aux griffes des Japs. Chez les Jaunes on arrive à tout avec de l'argent. J'en ai apporté beaucoup et ce nerf de la guerre sera aussi le nerf de votre évasion. Faites de point en point ce que vous dira votre geôlier. Il paraît que c'est un nain, tandis que celui du brave Pigeon est un colosse. L'un et l'autre auront reçu, à l'heure où cette lettre vous sera remise, de quoi nous assurer une utile complicité. Le nécessaire est fait pour que Pigeon soit prévenu en même temps que vous. Exécutez l'un et l'autre, à la lettre, les instructions que vous donneront ces deux hommes, et tout ira bien. Le vieux Chinois vous fournira de vive voix des détails complémentaires. N'ayez pas l'air, surtout, d'être prévenus. Bien cordialement à vous.
Banzaï! Ayez confiance! Je ne veux pas que vous restiez dans les mains de ces sauvages. Faites manger cette lettre par le magot qui vous la remettra, l'ingestion de ce papier n'ayant rien d'agréable, je pense, pour un estomac qui se respecte.
Signé: Martin du Bois.
Je relus trois fois cette lettre, pour la relire encore une quatrième.
Quand je la sus par coeur, je la réexpédiai au vieux par le même procédé: ficelle et zénis combinés, en lui intimant l'ordre de l'avaler, comme le voulait l'homme venu de Fa.
Ce fut avec la plus parfaite docilité que le misérable s'exécuta.
Recroquevillé dans sa cage, l'oeil malicieusement tourné vers moi, il commença par déchirer la feuille de papier en petits morceaux; puis, une à une, les boulettes que confectionnaient ses doigts osseux passèrent dans son gosier comme de simples pilules. En un quart d'heure tout fut absorbé.
Je lui demandai alors ces détails complémentaires dont me parlait la lettre de Martin du Bois. Il s'apprêtait à reprendre la conversation de la veille lorsque le gnôme au trousseau de clefs entra.
Je fis l'ignorant, puisqu'on me le recommandait; le geôlier-nain aussi. Ce n'était pas encore ce matin-là qu'il me donnerait la marche à suivre pour sortir de cette cage!
Dès qu'il fut parti, je repris l'interrogatoire.
Toujours accroupi dans le coin de sa boîte, le vieux me considérait du même regard singulier qui m'avait déjà frappé la veille.
Peu à peu des ressouvenirs de Célestes déjà vus me revenaient, et bien qu'il en fût pour moi des Chinois comme des autres Asiatiques, bien qu'entre dix mille Chinois entrevus il me parût difficile d'en reconnaître un seul, le rictus de mon voisin, ses yeux, son nez, sa tête entière me rappelèrent subitement Wang-Tchao, mon pauvre domestique jaune, que Jim Keog m'avait si brutalement tué le premier jour de cette guerre, aux environs de Mézières.
Je m'attardais à considérer une identité bizarre des traits et à raisonner sur les analogies lorsque machinalement, avant de reprendre la conversation, je demandai à mon homme:
— Comment t'appelles-tu?
— Wang-Tchao.
Je ne pus m'empêcher de tressaillir. Jusqu'à son nom qui était exactement celui-là même que portait mon boy défunt!
Vous me direz que sur dix mille Chinois, pour nous en tenir à ce chiffre comparatif, il y en a trois mille qui s'appellent Wang (Roi), trois autres mille qui s'appellent Li (Prunier), autant qu'on nomme Tcheou (Circonférence); que le dixième mille se partage entre Liù (Forêt), Ya (Mois), Tchang (Etendre), Lieou (Sabre), Song (Maison), Hiu (Permettre) et quelques autres verbes ou substantifs, lesquels s'additionnent pour désigner, par de multiples combinaisons, les humains qui peuplent la Chine par centaines de millions.
Tout de même la coïncidence me parut bizarre, et, je ne savais pourquoi, de mauvais augure.
J'entamai, néanmoins, la conversation. Wang, le miséreux sexagénaire, qui avait vendu sa vie à M. Martin pour un cercueil, me fit comprendre que le patron avait enrôlé, pour réussir à coup sûr une double évasion, trente bonshommes influents de la Chinatown, tous affiliés à une société secrète dont les desseins politiques s'accommodaient fort d'un enlèvement par la ruse, d'un bel incendie, ou d'un pillage à l'occasion.
Il m'expliqua tant bien que mal que le chef de la bande qui devait tout mettre en oeuvre à bref délai pour nous délivrer s'appelait Chen Pi; que M. Martin était très généreux et qu'il avait donné à la section commandée par Chen Pi des montagnes de pièces en argent et de billets de banque, dont les deux geôliers recevraient, s'ils n'avaient déjà reçu, la plus grosse part.
Ce détail m'inquiétait déjà, car je connaissais la fourberie chinoise. Il me parut aussitôt que M. Martin s'était bien aventuré en accordant sa confiance à ce Chen Pi, lequel garderait probablement tout l'argent pour lui, sans en montrer la couleur aux deux hommes qu'il importait avant tout de compter parmi nos affidés: le colosse et le nain.
Mais j'avais tort. Comme mon estomac marquait les environs de midi, le nain-geôlier entra brusquement dans le corridor qui nous séparait et surprit la conversation de ses deux prisonniers. Je crus qu'il allait tempêter, singer l'indignation et se montrer offensé de cette connivence. Mais au contraire il se mit à sourire, et demanda au Chinois de lui servir d'interprète.
Alors s'avançant dans ma cage, il me fit un discours bref, qu'il acheva en me présentant une petite bouteille.
— Il dit, résuma le Chinois, que tu dois boire ceci, pour arranger les affaires.
Diable! C'était grave. Le flacon libérateur, qu'on nous avait pris au camp, dans le Sud, m'apparut plus terrible que jamais sous cette forme nouvelle.
— Qu'est-ce donc? demandai-je.
— Une liqueur pour dormir, dit l'interprète jaune, après avoir attendu la réponse du nain.
Je demandai des explications.
Une liqueur pour dormir, pour dormir... Mais combien de temps? Quelques heures ou l'éternité? J'avais de la méfiance. Qui n'en eût éprouvé à ma place?
Voilà un gaillard, me disais-je, qui a touché d'avance le prix de son concours, c'est indubitable, sans quoi nous ne le verrions pas se découvrir avec une telle imprudence. Qui me dit qu'il ne va pas essayer de se débarrasser de moi tout à fait, à présent? Ni vu ni connu. Les amis de Martin du Bois, qui est à Vancouver, c'est-à-dire fort loin d'ici, à la frontière canadienne, ne sont pas en peine de lui raconter une histoire...
Le vieux Wang-Tchao, voyant que j'hésitais, me fit alors une conférence sur la loyauté des Chinois, surtout lorsqu'ils font partie d'une société secrète.
L'adhésion des geôliers valait de l'or. Ils en avaient reçu un bon poids. Et voici ce qui se passerait: endormis pour deux jours environ, par cette liqueur verdâtre que le nain m'offrait de boire, je resterais et Pigeon aussi, dans une léthargie qui durerait deux jours. On dirait aux autorités: ils se sont suicidés.
Elles viendraient s'en assurer. Le médecin de la prison le constaterait par amour des dollars mexicains (1) qu'on lui avait également fait tenir. Si bien que nous passerions pour morts...
(1) Monnaie courante en Chine.
Je fis un geste de protestation épouvantée à l'énoncé de cette comédie.
Les deux Asiatiques me regardaient avec une surprise apitoyée qui me rendit le courage.
Sûrement l'un et l'autre me prenaient pour une femmelette. S'effarer d'un subterfuge aussi bénin! Refuser de faire le mort pendant quarante-huit heures quand on est certain d'être décapité au premier jour, après une séance de « petite torture »!
Je frissonnai. Je m'interrogeai. Je me débattis contre l'autre moi qui, en dedans, me conseillait d'aller de l'avant et de faire ce que me disait ce geôlier. Puisque la lettre du patron ne laissait prise, là-dessus, à aucune équivoque!
En analysant les sentiments qui se combattaient dans mon for intérieur, je reconnus la raison majeure qui m'incitait aux hésitations. C'était la préoccupation du sort de Pigeon. Si j'allais accepter, et que lui refusât?
S'il n'était pas prévenu?
Si son geôlier avait fait défection?
Douloureuse alternative! Je compris pourtant qu'il était impossible d'hésiter plus longtemps. D'un côté je voyais le supplice certain; de l'autre l'évasion probable. Tout semblait indiquer un complot parfaitement machiné.
— Tu m'affirmes, dis-je au nain par l'intermédiaire de Wang-Tchao, que mon ami est prévenu comme moi et qu'il va boire une drogue pareille à celle-ci.
— Il a déjà obéi à son maître, gloussa le nain. Il est plus hardi que toi.

— Donne donc ton élixir de sommeil,
avorton! dis-je à mon geôlier. (Page 572.)
— Donne donc ton élixir de sommeil, avorton!
Et cette fois, ayant mesuré de l'oeil le petit flacon, je bus d'un trait, sans vouloir réfléchir une seconde de plus.
Ce liquide était désagréable. Il me brûla légèrement le gosier.
Le nain me fit entendre qu'il fallait conserver à côté de moi la petite bouteille, afin de rendre palpable l'hypothèse du suicide.
Je compris. Il était temps, car un grand trouble m'envahissait. Je tombais inerte sur les genoux; puis, ma tête s'inclinait profondément sur ma poitrine sans que j'eusse désormais la force d'ouvrir les yeux, ni de remuer les lèvres.
J'entendis les pas du porte-clefs qui se retirait.
Le Chinois prisonnier marmottait des encouragements tirés de la doctrine de Confucius, sans doute. Dans son anglais barbare elles m'eussent fait sourire si j'avais eu l'esprit moins frappé.
Peu à peu sa voix s'affaiblit, ou plutôt ce furent mes tympans qui s'oblitérèrent, de même que mes membres s'engourdirent.
Je sentais que tout en moi faisait faillite, sauf le cerveau. Un froid singulier s'était emparé de mon individu; néanmoins la pensée restait claire.
J'eusse entendu parler quelqu'un près de moi. Mais toute volonté, toute notion du mouvement demeuraient abolies, au point que je ne pouvais me déplacer.
Les veux fermés, la gorge sèche, les veines glacées, je restai dans cette posture incommode pendant toute la nuit. Lorsque l'heure vint de la première visite du geôlier-nain, au petit jour, j'entendis la porte s'ouvrir, et le susdit pousser un cri d'étonnement simulé. Il disparut pour revenir aussitôt avec des hommes qui parlaient tous à la fois. L'affaire entrait dans la phase dangereuse. L'éveil était donné sur ma prétendue mort. Qu'allait-il se passer?
Je sentis que des mains inquiètes me palpaient: celles du médecin acheté par Chen Pi, c'était vraisemblable. D'autres se promenèrent sur mes tempes, sur mon cou. Un corps s'accroupit sur le mien; une oreille se colla sur mon coeur pour y entendre complaisamment qu'il ne battait plus, puisque c'était là le programme.
On me prit alors par les jambes et par les bras pour me transporter sur ma natte, que le geôlier avait étendue avec les couvertures, la veille au soir, sans que j'eusse rien entendu de son manège.
Il y eut un grand conciliabule de vingt minutes. Puis tout le monde disparut. J'entendis alors très distinctement le vieux Wang déclouer sa planche et m'interpeller, comme un homme qui connaît les effets de la liqueur verte.
— Tout va bien, disait-il en son langage baroque. Les médecins sont venus, appelés par le geôlier; le directeur de la prison aussi. Tu es bien mort. On va t'enlever dans la journée pour te conduire au cimetière des diables étrangers. C'est là que l'homme venu de Fa te fera enlever par la société de Chen-Pi.
Le miséreux se mit alors à bercer ma léthargie par une sorte de complainte consolatrice, où je reconnus la doctrine de Confucius.
« A quoi bon s'occuper des choses du ciel? psalmodiait sa voix nasillarde. Nous n'en pouvons rien connaître.
« Les choses de la terre sont déjà bien assez compliquées. On a tant de mal à les comprendre qu'il y faut apporter toute notre attention.
« Honorons les ancêtres et maintenons leurs traditions.
Respectons les vieillards, et surtout nos parents. »
Ce vieux m'ennuyait avec ses psalmodies. Enfin, ayant assez rabâché, il se tut.
Des heures s'écoulèrent sans que personne s'occupât de moi.
Evidemment on préparait ma « feuille de route » et les moyens ordinaires de faire sortir un mort d'une maison japonaise pour le transporter quelque part.
Je songeais avec inquiétude à ce quelque part.
Où était-il?
Comme « diable étranger », comme Blanc détesté, comme ennemi de la Lune rouge, je n'avais droit à aucun des égards dont sont entourés les corps des Japonais après la mort, pour peu qu'ils soient ceux de personnages quelque peu notables.
Quelque charnier public devait constituer le cimetière des étrangers.
Le cimetière?... Tout à coup je sentis le froid s'accentuer par tout mon corps, bien que je me crusse déjà aussi refroidi que les Japonais dans le bras Bienville.
Un doute effroyable me venait.
J'entrevoyais le cimetière. Mais où donc avais-je l'esprit? Est-ce que les Japonais ne brûlent pas les corps, voire ceux des étrangers que le hasard prive de la vie sur leur territoire? Je me rappelais alors l'autodafé du lac Pontchartrain, et des récits de voyageurs où l'incinération des corps tient en effet sa place, une grande place.
On allait donc me déposer dans quelque four crématoire et non sous des mottes de terre comme font les Chinois? Diable! Il s'agissait de ne pas aller jusqu'au bout de l'opération! Et je me voyais déjà oublié par les séides de Chen-Pi, abandonné par les conjurés que l'affaire n'intéressait plus dès qu'ils avaient touché leurs arrhes.
J'entrevoyais quelque sinistre champ du feu, avec un bonze de bas étage envoyé par un couvent pour sauver la face.
Mais aussi, pensais-je, Martin du Bois a été assez fin pour ne délivrer que des arrhes à tous ces gens-là! La forte somme complémentaire, il ne la leur paiera que lorsque je serai avec Pigeon, bien vivant comme lui-même, dans l'île de Vancouver!
Ces réflexions étaient absolument dépourvues de gaieté, nul n'en doutera. Un bruit de pas et de voix vint les interrompre, mais ce fut pour en doubler l'angoisse. Là, ma foi, ce fut la sueur froide qui m'inonda le visage. Au bruit des objets, je devinais ce qui allait se passer, ce fut abominable.
Depuis la minute où j'avais accepté la proposition de mon directeur je m'étais familiarisé avec l'idée de sortir de cette prison comme un mort, c'est-à-dire dans l'ordinaire cercueil. Encore que cette idée n'eût rien d'agréable, elle ne m'effrayait déjà plus. Qui veut la fin veut les moyens. Je me répétais l'adage à chaque instant pour m'encourager.

J'avais oublié qu'au Japon les morts ont pour cercueil un tonneau, où les
rites veulent qu'on leur donne une posture symbolique. (Page 574.)
Mais de même que l'idée de la crémation ne m'était pas venue, de même celle du tonneau dont on se sert au Japon pour enlever les morts de la basse classe ne s'était pas présentée à mon esprit. Elle surgit tout à coup, abominablement terrifiante, lorsque j'entendis le bruit caractéristique de l'objet roulé sur le plancher de ma cage, par deux spécialistes, probablement.
L'idée qu'on allait me tasser de droite et de gauche pour me faire entrer dans un tonneau de douves en sapin, cerclé en écorces de bambou, me brisa positivement la boîte crânienne.
Il me sembla qu'elle fût émiettée en mille parcelles.
J'avais oublié aussi que les Japonais imposent à leurs morts, dans le fût de bois qui les emporte vers le bûcher, une attitude spéciale, celle que le peuple, en son langage imagé, dénomme « en chien de fusil ».
A l'idée que ces hommes allaient s'emparer de moi et me fourrer dans le tonneau que je savais là, près de ma couchette, j'eus envie de crier, de protester, d'interrompre la sinistre comédie dont l'issue me paraissait affreusement inquiétante à présent.
Mais je n'en eus pas la force.
Une véritable anesthésie me tenait cloué sur la couchette.
Je comprenais tout et je ne pouvais rien. L'élixir verdâtre procurait vraiment à qui l'absorbait les apparences de la mort.
L'impuissance me rendait fou de désespoir. Pour la première fois depuis le premier jour de la guerre j'eus du regret d'avoir accepté la mission de renseigner les lecteurs de l'An 2.000. Et le croira-t-on, ma pensée, à cette atroce minute, allait encore vers eux, tant il est vrai que la communion s'établit intime et forte, à la longue, entre un chroniqueur et son public.
Mais un ordre bref coupa court à mes réflexions. Je me sentis empoigné par les croque-morts. L'un d'eux commençait à me déshabiller, conformément aux rites, lorsque la voix du chef protesta sur un ton de mépris. J'eus tôt fait de comprendre que pour un chien de Blanc, point n'était besoin de ces délicatesses rituelles.
Grand merci, pensai-je, tandis que mes deux tortionnaires me plongeaient assez brutalement dans le tonneau. D'une forte pesée sur les épaules ils me forcèrent à m'accroupir. Leurs mains nerveuses me saisissaient aussitôt les jambes, et les repliaient sous mon pauvre corps.
Ce fut ensuite le tour des bras. Ils me les croisèrent sur la poitrine...
Vraiment il m'est impossible de trouver des expressions pour dépeindre la terreur qui me tenait. J'étais logé dans cette posture incommode, courbaturé; par deux fois j'avais cru que ces gaillards sans scrupules m'avaient brisé les os.
D'autres voix que la leur se faisaient entendre: celle du geôlier-nain sûrement, celle du médecin, que je crus reconnaître aussi; une autre encore. Il y avait là cinq Japonais achetés par Chen-Pi, qui risquaient leur peau pour me conduire hors de ma cage.
En tenant compte de ce que Chen-Pi détournait sur les sommes qui leur étaient destinées, il fallait encore estimer à un fameux chiffre l'indemnité que Martin du Bois servait à tout ce monde.
Il s'agissait de partir en bon ordre. Sur deux bambous le tonneau était bientôt suspendu par le milieu, grâce à deux oeillères, et je venais d'être enlevé de terre, soi-disant mort, comme dans un cango, lorsqu'un tintamarre épouvantable fit trembler la prison. Du coup mes croque-morts s'arrêtèrent et je retombai lourdement dans mon tonneau, sur le plancher de la cage.
Sûrement il y avait du grabuge. Peut-être était-ce à cause de mon évasion?
Justement! Dix ou douze voix emplissaient de tumulte les corridors. Des pas précipités, des cliquetis d'armes.
— Adieu tout espoir, pensai-je aussitôt. L'affaire avorte. Nous sommes perdus.
C'était trop exact. Au milieu des vociférations de la soldatesque qui semblait apostropher les complices de Chen-Pi une voix que je reconnus tout de suite donnait des ordres brefs et rugissait des injures: celle de Wami.
La porte de la cage fut fermée lourdement. Je tremblais de tout mon corps en songeant à ce qui pouvait se passer.
Ce fut épouvantable.
Un feu roulant de pistolets éclata, sans avis préalable, sans autres formalités. J'entendis les corps des victimes tomber lourdement les uns sur les autres, entre deux interjections sourdes, sans plaintes, sans hurlements, presque avec résignation.

J'entendis les corps des victimes tomber les uns sur les autres. (Page 574.)
Le fracas des vingt et quelques balles tirées m'avait assourdi. Je conservais tout de même assez d'ouïe encore pour deviner que les soldats vengeurs de la fidélité au drapeau se félicitaient à leur manière d'avoir puni sans autres délais les traîtres soudoyés par les Chinois.
Evidemment il ne restait pas un homme vivant des cinq qui tout à l'heure se préparaient à m'emmener au champ des incinérations. Je pensai alors que les agents de Martin du Bois devaient m'y attendre en vain, de même que Pigeon, dont la fugue était très probablement éventée, comme la mienne.
Alors sur un ordre furieux je fus aussitôt happé par quatre bras vigoureux, sorti du tonneau funèbre et jeté comme un paquet sur ma natte.
— Coupez-lui donc un doigt, dit Wami en anglais. Nous allons voir s'il est mort.
L'appréhension d'un premier supplice, l'idée qu'on pût me mutiler pour le seul plaisir de voir si j'étais mort ou encore vivant, la terreur angoissée que j'éprouvais au milieu de ce drame bruyant et rapide, tout cela fit que, hors du tonneau macabre, je parvins à contracter mes traits et mes doigts, de manière à donner signe de vie.
J'étais sauvé, car Wami donna contre-ordre. Une voix répondit; un homme sortit de la cage et y rentra bientôt pour m'envoyer des flots de vinaigre en pleine figure.
Alors j'ouvris les yeux sans trop d'efforts et peu à peu mes lèvres purent remuer.
Le soldat qui m'avait aspergé m'épongea le visage avec une serviette en papier.
Je n'osais regarder notre ancien compagnon de misères, tant l'attitude qu'il adoptait à mon égard me paraissait monstrueuse.
Lui ne pensait pas de même, sans doute, car il dardait sur moi ses yeux d'épervier.
Je les devinai d'abord. Mais par une attraction irrésistible les miens finirent par se tourner vers ces deux prunelles fauves, d'où jaillissait l'éclair de la fureur.
Trait pour trait son masque me rappelait alors celui du Jap aliéné qui jetait tout par-dessus bord, quand l'Austral désemparé fuyait sous la bourrasque, après la bataille livrée dans le ciel de Londres.
— Il n'a tenu qu'à moi, dit le lieutenant avec dédain, que vous fussiez mis en pièces par ces hommes, dès qu'ils ont su de quel crime leurs compatriotes, ce misérable nain, ce médecin, ces portefaix, s'étaient rendus coupables en vendant leur concours à des Chinois. Eux sont déjà punis par la mort. Je n'ai pas voulu qu'il en fût de même pour vous. J'ai mieux à vous offrir. Puisque vous avez si bien trouvé le moyen de pénétrer chez les Américains et de vous rendre compte de leurs moyens de défense, il est bon que vous appreniez aussi, avant de payer votre dette, ce que savent faire mes compatriotes. J'ai pensé que vous trouveriez en notre compagnie, des sujets d'articles qui valent certainement la peine d'être étudiés et confiés au papier pour l'An 2000. Nous aussi nous avons des Erickson! Ils sont peut-être moins prompts à parler de leur supériorité que celui dont vous avez si complaisamment chanté les louanges dans vos télégrammes de ces derniers jours. Mais leurs talents valent qu'on les apprécie, tout de même, et je suis certain que vous les apprécierez. Pour cela il faut que vous en touchiez du doigt les effets.
A ce mot, qui me rappelait la sinistre et stupide plaisanterie de Jim Keog au-dessus de Francfort, je ne pus m'empêcher de faire une grimace.
Le Nippon semblait s'amuser de la gêne qu'il me causait. Il comprenait, en tout cas, l'amertume de la plaisanterie, car je lui avais raconté comme aux autres, et il avait lu comme les autres mes aventures à bord du Sirius. Il insista.
— Vous serez très bien avec nous, pendant ces trois mois que le tribunal vous a, sur ma demande, accordés. Et, si au bout de cette expérience le Japon est satisfait de vos personnes; si vous avez su reconnaître, la plume à la main, que nous faisons aussi grand que n'importe quel peuple blanc, alors peut-être pourrai-je obtenir que la peine capitale vous soit épargnée. C'est là ce que j'ai expliqué au conseil de guerre. Il s'en est remis à moi de la direction à donner à vos études. Il a fait sagement. Je vais vous en faire voir, comme vous dites, de toutes les couleurs, car on m'a donné sur vous deux droits de vie et de mort. Après quoi vous direz si nous sommes vos inférieurs. Mais de grâce, écrivez à M. Martin du Bois — je mettrai moi-même la lettre à la poste avec beaucoup de plaisir — qu'il a bien tort de donner tout son argent à des Chinois incapables et menteurs. Ils lui mangeraient toute sa fortune sans parvenir à tromper notre vigilance. Voyez-vous, commandant, pour venir à bout de notre police il faut être malin, très malin. Et ces Chinois sont bêtes. Tout ce qu'ils entreprennent est lourd et grossier. Vous êtes encore très heureux que ceux-là ne vous aient pas donné à boire un autre élixir, qui vous eût endormi pour des milliers d'années. Non, entre nous, pas de ces malices, je vous en prie. Qui mieux que moi sait pratiquer l'art des évasions? Rappelez-vous celle de Charleston. Sans moi, elle n'était pas à tenter. C'est que je m'y connais pour les entreprendre, mais aussi pour les contrecarrer. Ecrivez à M. Martin du Bois qu'il perdra son temps à lutter contre notre vigilance. A moins que ce monsieur ne soit très têtu. En ce cas libre à lui. Nous ne craignons rien de ses tentatives.
Wami persiflait. A la façon dont il débitait ses aperçus et les reproches dont je ne voyais encore que le commencement, je comprenais bien qu'il était complètement retourné.
On pouvait parler sans contrainte, aucun de ses soldats ne sachant dix mots d'anglais. Je ripostai donc, d'une voix étranglée par l'émotion:
— Je ne m'attendais pas, monsieur, après les épreuves que nous avons subies ensemble, à une attitude aussi injuste de votre part.
— Vous aviez tort. Rien n'est plus logique. Hier vous étiez un allié; aujourd'hui vous êtes un ennemi. Notre mikado nous ordonne aujourd'hui de punir comme des traîtres ces Français et ces Anglais que nous considérions hier comme des soutiens de notre drapeau. Cela suffit. L'empereur a parlé: je ne vous connais plus. Si l'occasion s'en présentait et que je reçusse l'ordre de vous tuer de ma main, croyez-vous donc que j'hésiterais?
— Oui.
— Non.
La façon dont ce non était dit ne laissait place à aucun doute.
Je compris bien que pour ces Jaunes l'amitié, la reconnaissance, la gratitude la plus élémentaire, le souvenir d'heures pénibles passées en commun dans le danger sont autant de sentiments inconnus ou méprisés.
J'étais, comme le disait crûment Wami, devenu l'ennemi de son empereur, et l'on me traitait comme tel. Item, Pigeon.
Où était-il dans tout cela, Pigeon?
Qu'était-il devenu, le malheureux?
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.