
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
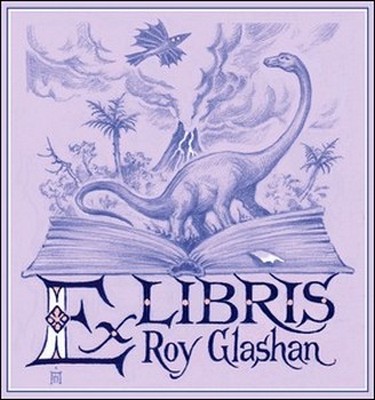

Les ballons allemands, en forme de colossales saucisses, déversent, comme
de simples grains de sable, leurs dix mille occupants sur le sol anglais.

La bataille s'annonçait terrible dans le ciel de Londres.

La guerre — une guerre infernale — met aux prises Anglais et Allemands. En vertu de l'entente cordiale, la France a dû prendre parti pour l'Angleterre. Le correspondant de l'An 2000, grand journal parisien, raconte les événements sensationnels auxquels il assiste et en particulier les exploits féroces d'un véritable bandit, l'Américain Jim Keog, inventeur d'une machine volante dont le pouvoir destructif est foudroyant. Vainement le journaliste cherche à décider son gouvernement à faire l'acquisition de cet engin, offert au dernier enchérisseur. La routine des bureaux, l'opposition d'un confrère jaloux: l'An 3000, font rater l'affaire. La France se laisse devancer par l'Allemagne qui achète le secret. Bien qu'il n'en soit pas responsable, le reporter de l'An 2000, afin de calmer l'exaltation de ses compatriotes, jure de s'emparer, mort ou vif, de Jim Keog et de ruiner son invention.
Dans ce but il part pour Londres, où se prépare une lutte effroyable entre les flottes aériennes de France et d'Allemagne. Le petit dirigeable de l'An 2000, l'Austral, le conduit sur les bords de la Tamise, grâce au concours de pilotes improvisés, cinq Japonais chargés par leur gouvernement d'une mission auprès du gouvernement anglais et qui ont saisi avec empressement cette occasion de passer en Angleterre, ce dont ils risquaient d'être empêchés par l'interruption des services postaux. Même leur joie est à son comble quand l'aéramiral français consent à militariser l'Austral et son équipage. Justement Keog ne tarde pas à signaler sa présence. Du haut de son Sirius, — c'est le nom de son mystérieux engin, — il lance une bombe explosible qui produit dans le sous-sol londonien des ravages effroyables. Tout Londres, en effet, s'est réfugié en des galeries creusées à la hâte dans l'argile sur laquelle la cité est construite: le projectile de Jim Keog défonce le plafond de celles de ces galeries qui passent sous la Tamise et les eaux du fleuve envahissent la ville souterraine. Des milliers de victimes sont noyées. Après avoir coopéré au sauvetage, le narrateur retourne à Sydenham d'où les troupes anglo-françaises s'apprêtent à partir pour repousser l'invasion allemande, tentée par la mer et par l'air à la faveur du brouillard.
En quelques minutes le train spécial nous avait amenés à Sydenham. Il était à peine minuit, et pourtant nous trouvâmes tout le monde levé.
En grande rumeur nos monte-en-l'air, sous les hangars énormes, se préparaient à ce début qu'ils poursuivaient si ardemment de leurs voeux depuis le commencement de la guerre.
Le triomphe leur avait paru facile jusqu'alors: l'ennemi ne s'était pas encore montré dans les airs. Mais on allait voir désormais la couleur de sa flotte, de cette flotte de débarquement dont il était tant parlé dans les feuilles depuis quinze jours.
A force de lire et de relire les avis que donnait la presse alarmiste de sa valeur tactique on finissait par croire que « c'était arrivé », que vraiment cette flotte de 2.000 aérocars transporteurs et combattants menaçait l'Angleterre, l'Ecosse et au besoin l'Irlande d'une formidable descente.
Pour la première fois je réfléchis à ce que le chiffre présentait d'invraisemblable.
— Il est certainement exagéré par la crédulité populaire, m'avait dit Tom Davis dans le train qui nous amenait. Mettons que les Allemands aient réussi à établir un arsenal capable de donner le vol à cinq cents aéronats de belle dimension, et ce sera déjà fameux.
C'était aussi l'opinion de Pigeon, qui citait des auteurs, faisait des calculs et démontrait par A + B l'impossibilité matérielle pour une nation, si moderniste fût-elle, de grouper dans un effort utile une aussi grande quantité d'aéronats.
— Le plus clair de l'affaire, concluai-je en pénétrant avec mes deux compagnons dans le garage de l'Austral, c'est qu'on ne sait jusqu'à présent rien de positif sur la composition de cette Armada volante qui s'avance. vers nous. Une pareille incertitude suffit à démoraliser le peuple, ici comme ailleurs.
Le capitaine Mourata manifesta par un sourire sa joie de nous revoir. Les autres vinrent, tout joyeux aussi, nous serrer la main. Ils eurent une série de plaisanteries dans leur langue à l'adresse du pauvre Wami, dont le déguisement les amusait.
Le petit lieutenant disparut, pour revenir bientôt dans l'uniforme de son grade, que ses camarades avaient endossé déjà, et il se mit à la besogne.
Pigeon regarda quelques instants notre équipage arrimer ses projectiles. L'artillerie, à la demande du capitaine, nous avait délivré des grenades percutantes de six kilos, dont la chute seule, pourvu qu'elle fût perpendiculaire, suffirait à déterminer une catastrophe.
Nous en avions d'autres, de petit calibre, qui suffiraient encore à incendier proprement, le cas échéant.
Et l'incendie dans les airs équivaut à la destruction totale.
Pigeon regardait d'un oeil qui me parut troublé le va-et-vient de nos petits Jaunes et de leurs provisions.
Il exprimait le regret de ne pas faire avec eux à Boulogne le voyage d'agrément dont j'avais parlé.
Je compris que sa timidité naturelle, encore que deux semaines d'aventures aussi singulières l'eussent un peu secouée, commençait à s'inquiéter de ces arrimages pyrotechniques. Aussi lui donnai-je immédiatement des instructions faites pour le rassurer.
— Vous allez rester à terre, Pigeon...
Ce préambule avait rendu au visage de mon lieutenant la plus complète gaieté.
— Vous allez rester à terre pour y faire le compte rendu de ce que vous verrez, tandis que je me charge, moi, des notes à prendre en l'air, de visu aussi.
Mais alors il objecta:
— Est-il bien nécessaire que vous alliez là-haut? On sera beaucoup mieux renseigné d'ici sur l'ensemble, à mon avis. Supposons une bataille entre les forces aériennes. De là-haut vous ne saisirez que des épisodes. Tandis qu'en bas on aura sous la main tous les éléments d'information. Ce n'est pas de là-haut, au surplus, que vous pourriez noter les noms des éclopés, car il y en aura, ni les transmettre en France par le câble qu'on va sûrement nous rendre. Aux premières hostilités engagées, il faudra bien que le télégraphe fonctionne à nouveau... Qu'est-ce que vous ferez là-haut, patron, en bonne conscience? Rien de pratique. Restez donc en bas à côté de moi! Laissez vos Japonais s'amuser avec l'Austral: ils sont fous de joie à l'idée d'emporter des grenades. C'est leur affaire. Mais vous, patron, un père de famille qui n'a plus rien à voir au service militaire depuis quelques années déjà, quel besoin éprouvez-vous d'aller risquer vos membres dans les airs? Restez donc à côté de moi. Nous ferons une besogne superbe à deux. Tandis que séparément. Voyez-vous, je crois que séparément nos articles sur la grande bataille, si bataille il y a, ne vaudront pas cher. Restez donc!
Je compris tout ce qu'il y avait d'amicale prudence dans les propos de mon lieutenant.
Il se disait avec raison que les Japonais et l'Austral risquaient fort de ne pas redescendre en bon état des hauteurs où leur fantaisie guerrière allait les conduire, et qu'en restant avec lui sur le plancher des vaches, je ne courrais aucun des graves dangers auxquels une ascension téméraire m'exposerait.
Je compris et je remerciai Pigeon d'un mot affectueux. Mais ma résolution était prise depuis deux jours déjà.
Il eût fallu, pour comprendre le désir immodéré que j'avais de manoeuvrer là-haut, d'y suivre de près la bataille, que Pigeon fût moi, qu'il pût saisir en un instant toutes mes rancoeurs, la hâte que j'avais de voir le Sirius attaqué par quelques-uns de nos mammouths, frappé au défaut de la cuirasse que je connaissais si bien, et détruit, avec son équipage de forbans, sous mes yeux, si possible, afin que ma joie fût doublée par cette autre: montrer au peuple de Paris que j'avais su tenir ma promesse.
Assurément l'idée ne me venait pas — elle eût été trop ambitieuse — que notre petit Austral pût servir à grand'chose dans l'exécution de la vengeance tant souhaitée; mais l'Austral allait me permettre d'assister de près aux tentatives que feraient nos officiers pour atteindre le Monstre.
Car de toute évidence le Monstre serait là, au milieu de ses nouveaux amis, qu'il devait surpasser, j'en étais bien sûr d'avance, en mobilité dans les évolutions.
Rester à terre! Non, non, non!
Je monterais là-haut avec mes cinq Japs.
Oh! je saurais les modérer de toute la force de mon autorité patronale, c'était sûr, et mon intention n'était nullement de mêler l'Austral aux aérocars combattants, français ou anglais. M. de Troarec avait bien voulu lui donner le rôle de mouche au service de la flotte. Il porterait des ordres, voilà simplement à quoi se bornerait son emploi. C'était encore un rôle où il faudrait ouvrir l'oeil.
Les Japonais préparaient de leur mieux quelques projectiles à bord de notre croiseur aérien?
C'était prudent. Il fallait bien que nous eussions de quoi nous défendre à l'occasion.
— Mais rassurez-vous, déclarai-je à Pigeon, je ne commettrai pas d'imprudences. Je vais là-haut en observateur, et point en belligérant. Tout de même, il faut bien être en mesure de riposter, si, par hasard, on nous attaque, n'est-il pas vrai? Voilà pourquoi vous voyez ces messieurs faire provision de grenades. Les Anglais les utilisent de préférence aux fusées que préconisait Rapeau. N'est-ce pas, capitaine, que nous n'allons pas là-haut pour combattre, mais pour observer?
— Pour exécuter vos ordres, chef, me répondit Mourata dans une grimace qui voulait être souriante et respectueuse à la fois.
— Vous voilà fixé, Pigeon! N'ayez donc plus de crainte! Et surtout ne me parlez pas des choses sentimentales, qui d'après vous, me décideraient à rester en bas. Vous savez que si je meurs au service de l'An 2000, aucun des miens ne sera oublié par Martin du Bois.
— Certes, certes. Mais tout de même, j'aimerais mieux...
Le timide Pigeon n'acheva pas. Je lui mis la main sur les lèvres en le priant d'un mot bref de ne pas insister. La cause était entendue.
Un bruit grandissant annonçait au dehors que toute l'armée était sur pied, procédant à ses derniers préparatifs. Nous allâmes, jusqu'à trois heures du matin, faire un tour d'inspection sous les coupoles de Sydenham Palace. Le spectacle y était merveilleux. Nous retrouvions là nos amis de Munich et de Francfort, empressés à faire le plein de leurs monstres, en hydrogène comme en essence motrice. Une fois de plus, je considérai les gigantesques réservoirs où, par milliers de litres, on entonnait les provisions de carburants. C'était stupéfiant. Jamais encore je ne m'en étais autant aperçu.
Le brouillard restait compact et gênant au point qu'il nous empêchait, sous les hangars, de percevoir nettement l'arrière d'une grosse unité, pour peu que nous fussions placés à son avant.
Je serrai des mains amies çà et là. Le meilleur esprit animait les officiers. Les monte-en-l'air n'étaient pas moins vaillants.
Chacun d'eux comprenait que ce serait ce jour-là, vendredi 4 octobre, le vrai début à la guerre de l'aérotactique, l'ouverture des immensités de l'air aux ruées féroces d'humains contre humains, blasés sur les vieilles méthodes de combat, impatients de s'entre-tuer dans le vide.
C'était impressionnant.
Nous passâmes au bureau de M. de Troarec pour y prendre les ordres. Une ruche bourdonnante!
— L'Austral me sera dès ce matin d'une grande utilité, messieurs, nous dit l'aéramiral entre deux colloques avec ses commandants, car voici ce que disent les rapports de l'espionnage anglais télégraphiés du War-Office. La flotte allemande qui vient sur Londres compte cinq cents aérocars environ, et non deux mille comme le raconte le populaire. Mais, ce que personne n'avait encore jamais soupçonné, ces aérocars, si les renseignements sont exacts, ont plusieurs gabarits: la moitié de leur effectif se compose de ballons très allongés qui portent chacun cent hommes.
— Cent hommes! fit Pigeon en sursautant.
— D'autres en ont jusqu'à deux cents.
— Deux cents! fis-je à mon tour, effaré.
— Et d'autres encore, qui ne sont montés que par une escouade, affectent des formes incompréhensibles. Votre premier voyage de la journée est tout indiqué. Allez, aussi vite que possible, vérifier ces choses, et vous reviendrez de même nous dire ce qu'il en est.
— Alors, demandai-je au grand chef, nous partons sans délai, amiral?
— Sans délai. J'appareille avec tout mon monde à cinq heures. Il est minuit et demi. En vous élevant dans trente minutes, vous aurez quatre grandes heures d'avance sur nous. Tâchez d'apercevoir l'ennemi dans l'est de Londres, vers Gravesend. C'est, de toute évidence, le cours de la Tamise qu'il compte remonter. Le brouillard y est plus intense qu'ailleurs. Et le brouillard, c'est son grand protecteur, à ce qu'il croit du moins...
Je venais d'entendre notre aéramiral émettre à son tour, sur le rôle du brouillard, une opinion bizarre. Il connaissait donc, et rien n'était plus naturel, le secret que Tom Davis avait tenu à garder?...
Je pensai qu'il était bon qu'à mon tour je l'apprisse, ce secret d'importance, et j'interrogeai discrètement. La tradition de Rapeau n'était pas reniée par son successeur, que diable! Je m'en aperçus.
— Comment! vous ne savez pas?... Mais il faut que vous sachiez! Il faut absolument!
Le va-et-vient des officiers augmentait dans la grande salle de l'hôtel où M. de Troarec tenait son quartier général.
— C'est bien simple, dit le grand chef en m'entraînant dans l'embrasure d'une fenêtre, où notre colloque fut respecté les deux minutes qu'il dura. Les Anglais ont depuis quelques années, en vue d'une attaque de Londres par les airs, étudié, eux aussi, un moyen original de défense. Le brouillard dont la nature les gratifie trop souvent joue chez eux le rôle inconscient d'un traître. Il permettrait à l'ennemi de se dissimuler, par conséquent de surprendre. Or, il faut n'être pas surpris. Comment faire pour n'être pas surpris? En retournant contre l'agresseur l'arme dont il croit se servir...
Je suivais de mon mieux l'explication rapide, sans comprendre encore. M. de Troarec compléta.
— De ce traître les Anglais ont fait un allié. Le brouillard, dont ils subissaient jusqu'ici les caprices, est maintenant à leurs ordres. Sans doute ils ne le provoquent pas encore à volonté: ce serait trop beau. Mais ils le suppriment, et c'est quelque chose. A point nommé, grâce à douze énormes établissements qu'on ne visite pas et sur lesquels guides et journaux font un patriotique silence, le brouillard de la Tamise peut être à présent chassé à volonté, dispersé dans l'air. Les installations sont terminées depuis quelques jours à peine. On voulait faire une épreuve, hier, pour éclairer notre arrivée, mais par prudence, pour ne point donner l'éveil à ennemi, le gouvernement y a renoncé.
— C'est vrai?
— Vous en aurez la preuve bientôt. Les usines ont jusqu'ici fonctionné isolément, pour ne pas éveiller la curiosité des espions. Sans doute tout se sait, tout s'apprend; mais enfin les Allemands n'ont pas l'air de connaître dans sa superbe étendue le progrès ainsi-réalisé par les ingénieurs de ce pays. Vous verrez ce matin les nappes de brume qui s'étendent sur Londres se déchirer, s'envoler par lambeaux et retomber en rosée sur les toits des maisons, le ciel se nettoyer et des coins d'azur apparaître. En tous cas une zone de cinq cents mètres en hauteur s'éclaircira sur toute la ville, et si le mouvement des douze usines de chasse est, comme on l'espère, synchronique pendant une demi-heure, il ne restera pas trace du brouillard complice de l'ennemi.
— C'est vrai? réitérai-je, stupéfié.

Deux cent quarante canons d'acier, hauts comme des cheminées, se déchargeront
sans trêve dans les airs jusqu'à ce que la plus épaisse brume soit liquéfiée. (Page 294).
— Vous allez en juger, encore une fois. Vous entendrez de là-haut les explosions de l'acétylène et des autres gaz que deux cent quarante canons d'acier, hauts comme des cheminées — ils ont plus de vingt mètres de long et deux mètres de diamètre, —se déchargeront sans trêve dans les airs jusqu'à ce que la plus épaisse brume soit liquéfiée. Ainsi qui croit surprendre sera surpris.
— C'est admirable!
— Les usines sont situées, comme autant de bastions, autour de la ville, sur une circonférence qui se trace ainsi Clapham, Camberwell, Deptford, India Docks, Highbury, Hampstead, Kilburn, Hammersmith et Fulham.
On se pressait autour de nous pour aborder l'aéramiral. Je pris congé, non sans lui dire:
— Et notre Keog? Croyez-vous, à présent à sa valeur marchande?
Mais M. de Troarec n'était pas convaincu, décidément.
— Certes, dit-il, le coup de cette nuit fut terrible. Son effet sera désastreux ici et ailleurs. Chez nous ses obus ont touché Paris en démolissant le ministère. Mais je m'en tiens à ce que j'ai dit. Attaqué par plusieurs sangliers, un ours sera toujours battu. Vous verrez cela tantôt aussi, je l'espère. L'émulation est grande chez nos officiers, ce dont je ne saurais trop vous remercier, car c'est vous, monsieur, qui l'avez provoquée. C'est à qui d'entre eux se promet d'estoquer le minotaure. Vous verrez cela. Il y aura du sport là-haut, ou je me tromperais bien. Au revoir, monsieur, bonne chance! Vous me retrouverez au milieu de la flotte. Vous connaissez mon pavillon? Flamme jaune et bleue au-dessous de l'étendard tricolore. Quant à vous, chacun des nôtres vous reconnaîtra aisément, les Anglais aussi, car je les ai prévenus, à l'exiguïté de votre gabarit et aux lettres gigantesques qui se lisent à l'avant de votre aérocar. Bonne chance sur l'Austral! Vos Japonais sont de hardis manoeuvriers; c'est parfait. Efforcez-vous de m'apporter du nouveau le plus vite possible. J'estime qu'à la vitesse réduite de vingt kilomètres à l'heure la flotte aérienne des Allemands ne doit pas être encore au milieu de la mer du Nord. Vous aurez le temps de la devancer et de nous rapporter une première impression sur cette horde de barbares. Tâchez surtout de ne pas vous laisser prendre! Allez haut, très haut! D'après ce que je sais de leur construction, c'est la souplesse qui manque aux Allemands...
— Dans les airs comme à terre, complétai-je en filant au travers d'une haie d'officiers. A bientôt, amiral!
Je me sauvais pour rejoindre Pigeon, que je mis au courant en quelques mots.
La révélation des batteries braquées en l'air pour dissiper le brouillard avec des charges puissantes de gaz variés le plongea dans une joie qui n'était pas sans mélange, car il ne comprenait pas bien le mécanisme de cette curieuse artillerie.
Ce n'était pas moi qui pouvais le lui expliquer.
— Vous vous ferez documenter plus tard, lui dis-je. Pour le moment venez assister à notre départ. Mission officielle de l'aéramiral! Quelle réclame pour l'An 2000! N'oubliez pas de tout mettre en oeuvre pour que nos dépêches passent aujourd'hui! Voyez l'ambassadeur de France. Faites-lui mes excuses de n'avoir pu lui rendre visite hier. Arrangez tout pour le mieux, Pigeon. Je m'en rapporte à votre expérience et à votre entregent. Allons au hangar, vite! L'heure passe!
C'était une cohue autour de nous. Je ne dirai pas un désordre. Mais quelle incessante poussée d'officiers et d'hommes courant en tous sens pour activer les derniers préparatifs de l'appareillage!
On y voyait là comme en plein jour, en dépit du brouillard, grâce aux feux électriques semés à profusion.
Chaque équipage prenait ses dispositions, donnait le coup d'oeil aux enveloppes, aux moteurs, aux accessoires de tout ordre. Et ce remue-ménage rappelait à nos oreilles celui du Mont-Blanc...
C'était au surplus la même flotte, à quelques unités près — pauvres victimes! — qui procédait au même branle-bas de départ pour le combat, avec cette différence que l'ennemi, cherché l'autre jour en vain, n'allait pas nous faire faux-bond cette fois-ci.
J'avais chargé le capitaine de se procurer un lot de couvertures épaisses et de fourrures bien chaudes, par prudence. Je m'assurai qu'il avait exécuté mes instructions.
Dix-huit heures pour franchir la mer du Nord, c'était long; mais aux débuts pratiques de la locomotion aérienne, c'était encore très beau.
La joie de mes Japonais fut telle quand je leur dis que nous partions les premiers, et sans tarder, qu'ils se laissèrent aller à des gambades drôlatiques, comme des enfants.
Le capitaine Mourata m'ayant affirmé que tout était prêt, je lui demandai s'il avait songé aux provisions de bouche. On pouvait en avoir besoin. Il me montra une caisse remplie d'un tas de comprimés français qu'il s'était fait délivrer à l'intendance. Il y avait là des vivres pour un mois, en berthelottes, sa propre valise, placée sous un fauteuil, et une dizaine de ballonnets d'oxygène en manière de gourdes, que chacun mit dans sa poche.
Comme je crus nécessaire d'emmener tout le monde à l'hôtel pour y prendre un léger repas, j'entendis le lieutenant Motomi dire quelques mots au capitaine. Celui-ci prit alors dans sa valise une bouteille bizarre qu'il plaça sur la table, bien en évidence, comme si elle eût contenu quelque breuvage divin.
Avant de commencer à souper il en versa une rasade à chacun, en commençant par moi.
— Saké, me déclara-t-il avec une sorte de fierté. C'est la liqueur qui chez nous se boit avant le repas. Elle réchauffe qui l'aime. Et toujours avant de combattre, le général en chef fait distribuer une ration de saké aux soldats de notre souverain bien-aimé le Mikado. Vous en goûterez pour porter avec nous la santé de Sa Majesté, patron?
— Si j'en goûterai! fis-je avec élan. Plutôt deux fois qu'une, capitaine, et monsieur Pigeon aussi.
Mourata me versa un grand verre de saké; je le levai cérémonieusement à la longue vie et au bonheur de Sa Majesté nipponne.
— Banzaï! crièrent en même temps les petits Japs en levant aussi leurs verres.
Il ne me parut guère fameux au goût, saké, mais puisque c'était une liqueur patriotique!
Comme nous posions nos verres vides sur la table, je me retournai tout surpris d'avoir entendu derrière mon dos une sixième voix pousser l'étrange cri de guerre.
C'était le vicomte Asama, qui du seuil de la porte nous considérait, souriant et approbateur.
Je ne pus m'empêcher de trouver à mes cinq Japs et à leur ambassadeur un je ne sais quoi d'étrange, de sauvage.
Le souvenir de leurs compatriotes que j'avais connus de près, jadis, en Extrême-Orient, me revenait à l'esprit avec des évocations de combats héroïques jusqu'à la folie, de fureurs guerrières dont notre courage européen, plus froidement raisonné, ne donne pas une idée suffisante.
Ils étaient vraiment heureux tous les six de penser qu'on allait là-haut chercher l'ennemi. Un instant l'idée me vint de calmer leur fièvre par un petit discours où j'eusse exposé mon plan, le seul plan qui convint à la mouche de la flotte.
Je voulais leur dire que notre mission consistait à découvrir au plus vite l'ennemi, et à rapporter de même à l'aéramiral ce que nous aurions vu, mais sans combat. Au contraire!
Un scrupule me prit. Il me sembla que j'eusse fait piteuse figure en commençant par une déclaration de ce genre notre voyage à l'ennemi.
Que diable, me dis-je, émoustillé, je le sentais bien, par le verre de saké, à la guerre comme à la guerre! S'il pleut des pruneaux là-haut, on y goûtera!
J'avais bu de leur saké une seule fois, avec des officiers japonais, précisément, dans un camp de Mandchourie. L'apéritif national des Nippons m'avait laissé le souvenir d'une mauvaise eau-de-vie, très âcre. Celui que je venais d'avaler d'un trait me parut plutôt savoureux, comme s'il eût été parfumé.
Je sentais qu'il m'avait réchauffé le sang, et cette impression n'eut rien que d'agréable.
Tout de suite j'y soupçonnai quelque addition de la fameuse « liqueur de bravoure ». L'intendance japonaise la fait distribuer régulièrement, dit-on, aux troupes de terre et de mer avant leur départ pour la bataille.
J'étais certainement, quoi qu'il en fût, dans un état de gaieté qui me plaisait; et sans ajouter d'autre importance à l'incident, je me félicitai d'avoir réparé ainsi, d'un trait, les forces que mon bain dans les souterrains de Finsbury Park avait quelque peu entamées, c'était incontestable.
Ce qui me confirma dans l'opinion que le saké possédait une vertu stimulante, ce fut la loquacité subite de Pigeon.
Il invita le vicomte Asama, lui avança un siège, nous plaça cordialement à table, les uns et les autres, pressa le garçon et veilla sur le service, tout en jacassant comme une pie.
Il fallait bien se dire aussi que ce verbiage procédait de la satisfaction qu'il avait ressentie à l'annonce du rôle de tout repos que je venais de lui confier.
Deux estafettes, trois estafettes se succédèrent qui me cherchaient avec des plis.
Gravement, après en avoir demandé la permission à Son Excellence, qui se contentait d'acquiescer en fermant ses petits yeux fauves, je les décachetai.
Dans le premier l'aéramiral m'ordonnait de suivre autant que possible le cours de la Tamise et de m'avancer au besoin jusqu'à dix milles en mer, mais pas plus loin. Retour immédiat si dans ce parcours nous n'avions rien découvert.
Le second m'indiquait le pavillon de ralliement à hisser pour la journée: vert et blanc. Il m'invitait à vérifier à bord de l'Austral la provision des flammes et carrés destinés aux signaux, dont le troisième pli contenait un code complet.
Je sentis mon front se contracter à la lecture de ces documents. Ils étaient pour nous de première importance, évidemment, mais je redoutais de ne pas en avoir assez l'habitude pour m'en servir, le cas échéant.
Après tout les Japonais n'étaient-ils pas là pour assurer le fonctionnement de cette technique? Je passai les lettres de l'aéramiral au capitaine. Ce fut le signal du départ.
Chacun des Japs lut et relut, puis s'élança vers le hangar tout proche, où le récolement des pavillons fut opéré — le capitaine Narabo déclara qu'il avait établi dès la veille, de concert avec un officier anglais.
— Embarquement! commandai-je.
Chacun trouva aussitôt sa place dans la nacelle.
Il était 1 h. 30 du matin. Les derniers préparatifs prenaient fin. Mourata donna l'ordre d'ouvrir le hangar et de sortir l'Austral à bras d'hommes pour le maintenir dehors. Il voulait passer une dernière revue des arrimages à quelques mètres du sol.
Sous les éclats des feux électriques, chacun de nous regarda si tout était en bon ordre. Sikawa et Wami, les deux vigies à l'avant, comme la veille; Narabo et Motomi au moteur, le capitaine aux instruments et à la direction; moi le grand-maître, commodément assis dans mon fauteuil, seul à l'arrière. Il me manquait un compagnon, sans doute. Je demandai à notre pilote s'il avait chargé assez de lest et remplacé le poids de Pigeon par quelques sacs de sable. Tout était prévu; je m'en doutais un peu. Je vérifiai une fois encore le paquet des couvertures et des peaux de bête. Il était à côté de moi.
A terre, Pigeon et l'ambassadeur, après nous avoir serré la main, n'attendaient plus que le signal du départ, lorsqu'un soldat anglais s'approcha de nous au pas de course. Il faisait des signes catégoriques.
— Ne lâchez pas l'aérocar! signifiait-il aux lamaneurs qui nous tenaient.
Essoufflé, il ne put que me dire:
— Captain, un gentleman arrive derrière moi de la gare. Il a demandé avec insistance le hangar de l'Austral. Le voici!
— Marcel Duchemin!
C'était notre naufragé.
— Enfin, je vous trouve, s'écria le jeune officier, revêtu d'un uniforme emprunté aussi aux magasins d'habillement de l'Angleterre. Il y a trois heures que je suis arrivé à Londres, avec mes derelicts (*). Le temps de les remettre aux autorités maritimes et me voilà. C'est M. Johnson qui m'a donné votre adresse. Je n'ai pas perdu de temps, comme vous voyez: Voici un télégramme du patron qui vous dit en deux mots: Nous comprenons le silence temporaire, par raison d'Etat. La consigne rigoureuse sera levée demain. Bon courage à tous! Et en avant pour l'An 2000!... Mais où allez-vous ainsi?
(*) Nom que les marins anglais et américains donnent aux épaves qui errent sur les océans. Exactement: abandonnés.
— On va redescendre pour vous le dire, criai-je à mon ci-devant chef de file sous l'Elbe.
J'étais trop heureux de le revoir, le brave et obligeant Marcel, de le serrer dans mes bras et de lui présenter mon personnel, ainsi que Pigeon, qu'il connaissait à peine, et Son Excellence l'ambassadeur du Japon.
A peine si la quille de la nacelle eut frôlé le sol, doucement amenée par les lamaneurs, que je sautai à terre, pour étreindre de mes deux bras le charmant compagnon que j'avais cru tué à bord d'un navire anglais par les projectiles allemands. En quelques mots où je dis toute ma reconnaissance, il se trouva présenté à Son Excellence, à mes amis nippons et à Pigeon.
Le jeune homme serra nerveusement les mains qui venaient de se tendre vers lui.
En quelques mots, il nous confirma sa courte odyssée, sa chute à la mer, du bord d'un destroyer, le Sunbeam, son arrivée sur l'épave où il avait rejoint Allemands et Anglais.
— Vous savez le reste, fit-il en fixant l'Austral et mes Japs d'un regard de convoitise. Mais où allez-vous ainsi?
— Là-haut!
— Qu'y faire?
— Jouer les éclaireurs.
— Où cela?
— Vers Gravesend.
— Vous êtes six là dedans, mais il y a sept places?
— M. Pigeon reste ici pour assurer le service télégraphique du journal.
— Excellente idée!
— Vous voudriez venir avec nous?
— N'est-ce pas mon devoir?
— Dites votre droit. Beau-frère du propriétaire de l'engin!...
— Ne parlons pas du droit. M'emmenez-vous? Je grille d'envie de voler dans les airs, à présent que je connais le fond des eaux.
— Vrai?
— Comme je vous le dis.
— Nous aurions cette chance?
— Vous l'avez.
— Un vaillant compagnon de plus? Un officier de notre marine?
— Je n'ai rien à faire à Londres. Je n'y suis qu'un naufragé en instance de rapatriement. L'inaction m'y pèserait, mais je la subirais s'il le fallait. Or, je vous vois là, prêt à filer dans les airs, vers des émotions qui seront, je n'en doute pas, autrement neuves que celles dont notre vie maritime est faite. C'est-à-dire que la Providence m'a envoyé juste à temps, dans un train de nuit formé pour évacuer la foule qui fuit devant l'inondation! Je n'entends rien à la navigation aérienne, malheureusement, mais un marin peut toujours se rendre utile à quelque chose, quand ce ne serait qu'au service des signaux.
— Des signaux! Justement je viens d'en recevoir tout un choix qui ne laisse pas de m'embarrasser. Le capitaine Mourata, ici présent, ne peut, quoi qu'il en dise, être à sa direction et au jeu de pavillons. Une erreur pourrait nous coûter chaud. Vous arrivez bien, mon bon Marcel. Montez à bord de l'Austral! Je vous sacre timonier en chef! Voilà votre emploi trouvé! Montez vite à côté de moi, nous avons des couvertures et des vêtements pour tout le monde. Les provisions de bouche sont à leur plein; l'enveloppe est gonflée à bloc pour quinze, vingt jours si l'on veut. Quelle joie de vous embarquer! Quelle chance!
L'enseigne sauta de terre dans la nacelle comme un jeune chat, endossa un caban et s'assit à côté de moi.
— I am ready! cria-t-il tout joyeux aux Japonais.
Un brouhaha se fit entendre. L'aéramiral, en compagnie de Tom Davis et de plusieurs officiers, venait assister à notre départ.
Je recommandai une fois encore à Pigeon les démarches à l'ambassade pour obtenir qu'on transmit vite nos dépêches. Le vicomte Asama me promit d'accompagner mon lieutenant auprès des autorités, et de tout aplanir.
Tom Davis me faisait d'en bas des gestes attendris; l'amiral nous salua de la casquette, et tous ses officiers l'imitèrent.
— Il n'y manque que la Marseillaise, criai-je en riant, tandis que le capitaine donnait l'ordre du lâchez-tout, après m'avoir consulté de l'oeil.
Aussitôt, comme pour répondre à mon observation, une fanfare de phonographes que je n'avais pas aperçue dans son armoire grande ouverte, sous le portique de l'Aerial Fleet Restaurant, lança dans les épaisseurs embrouillassées notre hymne national.
Le moteur tourna: l'Austral s'éleva comme une plume dans l'atmosphère humide et grasse, tandis que sur la terre nos amis poussaient en notre honneur de chaleureux vivats, qui couvraient les éclats de la fanfare mécanique.
En quelques secondes nous avions atteint cent mètres dans la brume épaisse et glacée, que nos feux de position rouges, verts et jaunes trouaient avec peine de leurs piteux halos.
Pendant quelques minutes, j'éprouvai une indicible sensation de malaise.
Perdus entre ciel et terre, sans autres points de repère que nos fanaux, pouvions-nous servir à quelque chose, vraiment?
Espérions-nous que le trajet de Londres à la mer s'effectuerait sans qu'un fâcheux hasard nous fît entrer en collision avec quelqu'un des aérocars français ou anglais en surveillance au-dessus de Londres?
En surveillance! Ironie des mots! Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien surveiller dans ce pays des ténèbres impénétrables?
Le silence que nous gardions tous était impressionnant. Le capitaine Mourata, penché sur ses cadrans, qu'une ampoule électrique coiffée de son abat-jour éclairait tout juste, ordonnait d'une voix brève, en japonais, les manoeuvres utiles, de sorte que je n'y comprenais rien.
Etait-ce un bien? Etait-ce un mal? Après tout, il valait peut-être mieux, pour mon incompétence, que je ne fusse pas tenu au courant des détails. Ils m'importaient peu; c'était l'affaire de mon équipage. Pourvu que l'Austral fît honneur à l'An 2.000 et que nous ne fussions pas mitraillés, c'était tout ce que je demandais.
L'inspection des instruments suffisait à me renseigner. Je poussai du coude Marcel Duchemin que les cris rauques des Japonais interloquaient tout d'abord.
Il se pencha comme moi vers les aiguilles indicatrices, éclairées par l'ampoule, et comprit que nous aurions toujours là un contrôle exact de la direction, de la vitesse et de l'altitude.
Les Nippons s'égosillaient drôlement. A cou sûr, jamais ces régions éthérées n'avaient entendu pareil jargon.
Pendant dix bonnes minutes nous restâmes sans mot dire, Marcel et moi, partagés entre l'inquiétude que justifiait l'intensité de la brume, et notre admiration pour l'adresse manoeuvrière des Japs.
Sikawa et Wami, couchés à l'avant du poste, criaient à tour de rôle des mots courts, à sonorités bizarres.
Ce n'étaient pas toujours les mêmes. Evidemment ils entretenaient avec le pilote une conversation destinée à maintenir la sécurité de la marche.
Tout de suite nous atteignîmes l'altitude de cent cinquante mètres, le cap à l'Est, avec la vitesse, prudente en un pareil moment, de vingt-cinq kilomètres à l'heure.
— Qu'on entre dans le flanc d'un confrère, dit ironiquement Marcel, même à cette allure modérée, et l'on exécutera ensuite une descente plutôt mouvementée sur le sol britannique!
Pourtant nous fûmes assez vite familiarisés avec notre extravagante situation, et l'on s'abandonna aux confidences.
Instinctivement, nous les échangions dans notre langue maternelle tandis que nos compagnons parlaient la leur.
— C'est égal, fis-je, celui-là m'eût trouvé bien incrédule, qui m'eût dit il y a quinze jours que je serais à cette heure, à deux heures du matin le vendredi 4 octobre, en mission à bord d'un aérocar militarisé, au-dessus de la banlieue de Londres, par un brouillard à couper au couteau, cherchant une flotte aérienne qui arrive d'Allemagne pour déverser sur les bords de la Tamise cinquante, ou soixante mille hommes... Sûrement qu'il m'eût trouvé bien incrédule.
— Tout arrive, reprenait Marcel Duchemin philosophe, et en moins de temps à présent qu'autrefois. Comment faisaient les gens de jadis pour se battre pendant cent ans? Nous voilà au quinzième jour de cette guerre imbécile — car il n'y a pas d'autre mot pour la caractériser...
— J'en cherche un sans le trouver...
— Le quinzième jour de cette guerre imbécile commence et déjà — en ce qui concerne l'Europe — plus de désastres sont accumulés que dans tout le cours du règne batailleur de Napoléon Ier.
— C'est vrai.
— Récapituler est même impossible. On s'y perdrait. Ce qu'il y a eu de plus atroce a meublé notre mémoire pour quelques jours, jusqu'à ce que d'autres catastrophes effacent en horreur le souvenir des premières, demain, après-demain, les jours qui suivront; on ne peut pas dire les semaines, car il est impossible que ces abominables malheurs se continuent des semaines. La ruine est partout. Plus d'argent nulle part, et les dettes commencent à cuber aussi vite que le reste!
— C'est vrai...
— Quel jour à commencé la guerre?
— La nuit même de l'histoire stupide du sorbet, parbleu! Le 20 septembre, un vendredi aussi. C'est bien simple, il y a juste quinze jours ce matin.
— Donc, le vendredi 20, incendie de La Haye par les Allemands.
— Ça, ce n'est pas prouvé. J'inclinerais à croire aujourd'hui que l'incendie de La Haye fut plutôt l'oeuvre de notre forban. S'il ne s'en est pas vanté devant moi, il m'a laissé entendre son Sirius n'était pas étranger à l'affaire.
— Dans quel but?
— De brouiller les cartes plus vite, et de placer plus avantageusement sa Tortue géniale... Car il n'y a pas à dire le contraire, mon cher ami, la Tortue de ce Keog est une conception géniale... Vous allez la voir, sans doute, aujourd'hui même. Gare la casse!
Marcel Duchemin suivait une idée fixe de mathématicien; il continua:
— Le même jour, torpillage de sir Henry Newhouse, l'ambassadeur d'Angleterre et de ses compagnons, comme ils se rendaient à Douvres...
— Le lendemain, samedi 21, explosion de Belfort; explosion d'un bâtiment dans l'arsenal du Mont-Blanc. Le dimanche 22, incendie de Munich par votre serviteur et consorts... Prise de possession d'Augsbourg et de la forte somme... en billets faux! Le lundi 23, incendie de Francfort. Victoire n° 1 des armées de la République à la frontière... x mille morts, x mille blessés, x mille disparus.
On n'a pas encore appris qu'il y eût un numéro 2?
— Pas encore. Je crois qu'il n'y aura plus jamais de victoires pour personne, ni sur la terre, ni sur la mer. Sous les eaux, oui, encore. Et dans les nuages, où présentement, nous faisons une assez triste figure, à cause du brouillard. Dans les nuages, ça commence seulement. Ça va commencer aujourd'hui. Boum, boum, Krrrrraaaa!.... Nous y verrons du neuf, dans les nuages!
— Le mardi 24, farce spirituelle de nos bons anarchistes. Explosion du Palais-Bourbon. Le vendredi 27, opérations au fond de l'Elbe. Boum, boum, Krrrraaaa! Exécution vivement enlevée des cinq cuirassés de 26.000 tonnes...
— Par les deux citoyens ici présents, fis-je en saluant dans le vide, et une compagnie d'autres fameux crustacés! Pauvre commandant Réalmont, tout de même! Je le vois avec ses deux trompes.
— Et ses éléphants!
— Et les autres qui sont morts affreusement là-bas.
— Les Anglais qui nous ont hébergés à leur bord ne tarissaient pas en éloges sur notre exploit. On peut dire qu'il a épouvanté le monde.
— Et ensuite?... Bah! Restons-en là. On s'embrouillerait à rechercher tout ce qu'ont amoncelé de morts, de blessés et de ruines, en ces quelques jours, les premiers chocs de notre belle humanité en mal de carnage.
Justement le capitaine Mourata me demandait ce que je penserais d'un bond à deux mille mètres.
— Comme vous voudrez, capitaine. A deux mille, à trois mille, à quatre mille mètres, où vous voudrez, je suis votre homme! Vous conduisez comme un maître. Attention à Keog, voilà tout ce que j'ai à vous dire.
Aussitôt, avec une sensation très nette de l'envolée rapide, que confirmait la baisse constante du baromètre, nous arrivons à l'altitude de deux mille mètres sans effort, par la seule manoeuvre de l'appareil élévateur que le moteur actionne.
— Ouf! s'écrie Marcel Duchemin en respirant à pleins poumons, nous, voilà hors du brouillard, c'est déjà quelque chose. Regardez! Autour de nous à présent on ne voit goutte, puisqu'il fait nuit et qu'il n'y a pas de lune; mais on n'a plus la sensation de cette abominable bruine, saupoudrée de suie, froide et paralysante où nous avons manoeuvré depuis Sydenham. Voyez nos feux...
En effet, la brume était à présent, en couche épaisse, étendue au-dessous de l'Austral. Dans l'atmosphère presque claire où nous avancions contre un vent assez vif d'Est-Nord-Est, les fanaux lançaient de fulgurants rayons.
— Je crois que nous ferions mieux de les éteindre, opinai-je.
— Impossible, observa Mourata. Ils sont obligatoires pour toutes les unités: des flottes alliées. Autrement, les risques d'abordage seraient trop grands.
— Brigadier, vous avez raison.
Nous dévions être bien près de Londres. Marcel Duchemin alignait des réflexions sur la maladresse commise par les Anglais au commencement du siècle lorsqu'ils refusèrent si énergiquement de creuser avec nous un tunnel sous la Manche.
— Croyez-vous que leur situation serait autre aujourd'hui, disait-il, si des trains électriques leur amenaient de France, sans discontinuer, pendant une ou deux journées, cinquante mille hommes prêts à doubler l'effectif de leur armée terrienne? Alors ils seraient vraiment invincibles, et ce qu'ils considéraient comme l'instrument d'une déchéance apparaîtrait comme l'outil de leur salut.
— Ecoutez! crièrent les vigies en anglais. Ecoutez! Les canons tapent contre le brouillard!
En effet, de lourdes déflagrations venaient de nous émouvoir aussi. Ce n'était pas le bruit du canon de guerre, aux temps où le canon de guerre emplissait encore l'air de ses grondantes détonations. C'était comme la déchirure d'une incommensurable feuille de zinc.
Au premier coup, dix coups succédèrent avec la même sonorité métallique, puis vingt, puis cent et plus.
Enfin, nous comprîmes que les deux cent quarante canons destructeurs du brouillard, dont l'aéramiral m'avait révélé l'existence, commençaient à cracher sans discontinuer leurs gaz purifiants dans la couche épaisse de ce real London fog dont les Anglais d'autrefois étaient presque aussi fiers que de leur Westminster et de leur National Gallery.
Nous étions par le hasard admirablement placés pour voir s'accomplir le miracle, si les procédés employés par les ingénieurs de la ville réussissaient à donner les résultats tant souhaités.
Miracle! Dans leur tapage assourdissant, les canons-cheminées surpassaient toutes les espérances.
Ils n'avaient pas mitraillé l'air plus de dix minutes que les couches de suie et de brume opaque se clarifiaient.
Peu à peu nous commencions à entrevoir au-dessous de nous, très bas, des taches jaunes, puis rougeaudes, violâtres, qui nous indiquaient les points les plus abondamment éclairés de la capitale.
Enfin, le dernier voile se déchira. Les cent mille feux de Londres nous apparurent dans l'air purifié. C'était féerique.

Les feux de Londres nous apparurent enfin dans
l'air purifié. C'était féerique. (Page 300).
Nous ne pûmes retenir nos cris et nos applaudissements devant un coup de théâtre aussi soudain.
— Envoyez quelques appels de sirène, dis-je au capitaine, et redescendez à deux cents mètres. On comprendra ainsi, en bas, que nous avons été suffisamment édifiés.
Il nous devenait aisé d'apercevoir désormais plusieurs aérocars de l'une ou de l'autre flotte qui croisaient au-dessus de Londres: deux dans l'Est, deux dans le Nord, un cinquième au Sud.
L'écho de notre sirène leur parvint et l'idée de cette approbation parut originale à leurs commandants, car nous entendîmes bientôt beugler l'un après l'autre leurs appareils sonores aux quatre coins du ciel.
L'aspect de Londres à cette heure de la nuit, avec ses lignes de lumière, enchevêtrées, restera toujours dans mon souvenir comme l'un des tableaux les plus surprenants que j'aie vus de ma vie.
L'effet des canons, des antifogs comme on appelait à l'état-major ces engins si mystérieusement installés autour de la ville, au prix de dépenses colossales, ne cessa de nous occuper pendant des minutes.
Ce fut un véritable concert d'éloges, jusqu'au moment où nous reconnûmes Greenwich.
Là, c'était fatal, les antifogs n'avaient plus d'action et les brouillards de la Tamise y redevenaient aussi épais, aussi âcres, aussi décourageants que nous les avions trouvés en amont.
Le vent fraîchissait à l'approche de l'aube et de la mer; l'Austral tanguait comme un navire sur les vagues, ce qui ne laissa pas de m'étonner.
Je ne l'avais jamais vu ainsi.
Marcel me poussa le coude à son tour et me fit comprendre que le capitaine Mourata s'amusait à de successives expériences. Il nous enlevait de nouveau vers les hauteurs où l'on dominait la brume, jetait des poignées de lest et calculait ensuite la longueur du bond en hauteur que valaient à l'Austral quelques grammes de sable envoyés par-dessus le bord.
Comme il vit que nous le regardions avec attention poursuivre son manège dans l'obscurité, le studieux Jap nous dit qu'il établissait des chiffres pour monter très haut, le cas échéant, et que la souplesse de l'Austral, son obéissance à la commande du moteur, aussi bien dans la translation horizontale que dans le déplacement en hauteur, lui paraissait merveilleuse.
La montre du bord indiquait trois heures. Encore trois autres heures avant l'arrivée du jour!
Et si cette brume protectrice, mais bien gênante pour reconnaître une flotte ennemie à l'horizon, allait persister sur la mer du Nord? .
Nous reviendrions bredouilles.
— C'est à craindre, dit Marcel avec l'autorité que lui donnaient ses connaissances spéciales. Il est tout probable que si les radeaux et les aérocars se sont mis en mouvement de concert, c'est que la brume s'y prêtait.
Le moteur tournait toujours avec son imperturbable rapidité. A mille ou douze cents tours par minute, combien de' révolutions cet appareil diabolique opérait-il dans une journée?
Comment pouvait-il être assez robuste, étant si petit, pour résister à l'échauffement, même avec les appareils refroidisseurs dont il était pourvu? Vraiment c'était un bijou magique, dont j'avais trop tôt médit, ainsi que Morel, lorsque le premier jour nous l'avions substitué à regret au transformateur électrique, à présent inutilisable sous le hangar de Brochon.
J'expliquais de mon mieux à Marcel les détails de notre installation. Il devinait, bien entendu, ce que j'oubliais de lui dire, et parfois le capitaine, sans quitter des yeux ses cadrans, complétait d'un mot; car la conversation, maintenant, se poursuivait en anglais; le capitaine ne donnait en japonais à ses camarades que les ordres techniques, et ceux-ci continuaient à lui envoyer leurs méthodiques impressions, combien concises! Presque toujours de bizarres monosyllabes.
Seuls, dans l'immensité noire, au-dessus de l'épais matelas de brouillards qui suivait jusqu'à la mer le cours de la Tamise, nous fîmes ainsi les vingt-quatre milles qui séparent Londres de Gravesend. Nous avions passé au-dessus de Woolwich, sûrement, et de ses grandes installations d'artillerie, au-dessus du port monstre de Londres et des Docks de l'Inde, encombrés de marchandises que la guerre y emprisonnait.
— Trente-huit kilomètres et le pouce, dit Marcel en consultant les cadrans. Il est trois heures et demie. Nous maintenons l'allure de 25 kilomètres à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? Voici l'embouchure de la Tamise. Il suffira d'une heure à cette vitesse pour nous mener déjà loin au-dessus des vagues. Et si la flotte de nos gaillards n'allait pas venir en ligne droite? Si elle prenait un détour, comme c'est fort possible?
— Monsieur l'enseigne a raison, dit le capitaine. Nous risquons de perdre notre temps en poussant vers l'Est au-dessus de l'eau. Je serais d'avis d'employer deux heures, à remonter la ligne des côtes, sans nous aventurer trop loin en mer, de manière à risquer la rencontre sur une multitude de points. Tandis qu'avec un raid à l'Est nous n'avons qu'une chance pour nous; ce n'est pas. assez vraiment.
L'avis était sage. Adopté!
La mer est bientôt au-dessous de nous. On entend les vagues, assez fortes, déferler sur le rivage.
Encore un quart d'heure de route à l'Est, à deux cents mètres au-dessus du niveau, et l'Austral exécute un virage savant. Notre allure est aussitôt augmentée, car le vent, de plus en plus frais, nous pousse par le travers.
Nous remontons désormais vers un point de la côte qui pourrait être Harwich. Une carte dépliée sous la lampe, le capitaine Mourata donne les ordres à voix plus basse, par le petit téléphone qui va de la direction au moteur, placé plus près de l'avant. Nous remarquons avec Marcel que les vigies ne crient plus. La consigne contraire vient leur être donnée. Au lieu d'avertir souvent, elles ne doivent plus rien dire, tant que leurs yeux de chat n'auront pas découvert dans l'épaisseur de la brume quelque chose d'insolite.
Une demi-heure s'écoule ainsi, dans un silence triste, angoissant, que trouble seul le ronflement du moteur. L'Austral se tient à deux cents mètres: puis subitement les feux sont éteints.
Plus ferré que moi sur la théorie en temps de guerre, l'officier japonais sait que les prescriptions qu'il a suivies jusqu'ici ne sont plus valables dès que l'unité aérienne cesse d'être au-dessus de la terre britannique.
C'est donc avec une extrême précaution que nous avançons ainsi dans le noir: dix kilomètres à peine.
Il fait froid. Nous doublons les couvertures. Les Japonais s'en tiennent toujours à leur capote d'ordonnance, en forme de robe de chambre. Ils éternuent de temps en temps; c'est le seul bruit qui pourrait nous trahir vers cinq heures du matin, car l'ordre d'arrêter le moteur vient d'être donné par l'impassible capitaine.
— Qu'y a-t-il? demandons-nous à voix basse, comme si nous fussions entrés dans une zone dangereuse.
— Ecoutez!!
Le ballon plane à présent, ou plutôt il dérive. Assez vite même. Nous sommes toujours au-dessus de la mer.
— Ecoutez! dit à son tour Wami après un sifflement bizarre. Signal conventionnel, évidemment
Nous écoutons. C'est devenu chose aisée, car le silence qui nous environne est indéfinissable de grandeur.
Doucement l'Austral descend, descend encore... Nous voilà établis à cent mètres au-dessus de l'eau qui clapote.
— Des voix! chuchote à nos oreilles le capitaine.
Nous tendons le cou, nous retenons notre respiration.
— Oui, fait Marcel de même. Des voix en bas... sur l'eau.
— Nous allons sonder, dit Mourata.
Il transmet alors par téléphone quelques mots de japonais aux vigies.
Sans bruit, l'une d'elles — c'est le lieutenant Sikawa — se glisse vers l'un des coffres où sont logées les armes.
Quelques secondes et une détonation éclate dans l'air avec un beau fracas.

L'explosion terrifia les gens d'en bas qui crurent à un envoi
de mitraille, suivi peut-être d'autres envois. (Page 302).
Inoffensive, elle l'est presque, puisque son effet incendiaire serait neutralisé par l'eau. Mais les gens d'en bas n'en savent rien. L'explosion les a terrifiés! Ils croient à un envoi de mitraille, qui sera suivi d'autres envois.
Alors, en dépit d'une consigne qui, sans nul doute, leur a été donnée, ils poussent des cris de peur.
Alors aussi notre émotion est profonde.
Ce ne sont pas dix, ni vingt, ni cent cris, mais des centaines, oui, des centaines qui montent de la mer toute proche. Avec une habileté consommée notre pilote exécute une manoeuvre audacieuse. Il descend encore jusqu'à ce que nous apercevions confusément dans le noir ces hommes si nombreux qui ont crié.
Il descend toujours, un sac de lest à la main.
Tout à coup, il jette le sac par-dessus bord, et nous remontons dans la brume, comme si un ressort nous eût lancés au zénith.
Mais en un clin d'oeil nous avons eu le temps d'apercevoir des masses grouillantes. Beaucoup d'hommes flottent sur un long radeau, traîné par un remorqueur dont l'hélice s'entend à peine du point où nous sommes.
Nous cherchions les aérocars, et nous tombons sur les radeaux.
Celui-là s'allongeait, nous les devinions, comme ces longs trains de bois qui descendent les grands fleuves.
Il portait sûrement plusieurs centaines de soldats. Et il n'était pas seul de son espèce à venir à la côte. Combien d'autres avaient dû passer comme lui, à la faveur des brouillards, entre les vapeurs placés en surveillance de demi-mille en demi-mille?
Vite! Le cap à l'ouest pour signaler cette désagréable nouvelle.
Nous attendions des coups de feu, car on nous avait sûrement entendus et peut-être aperçus. Mais, là encore, la consigne était de se taire, et elle fut observée.

On entendait au loin, vers la haute mer, le bruit d'une canonnade furieuse. (Page 303).
Nous n'entendîmes au loin, vers la haute mer, que le bruit d'une canonnade furieuse. Tous les radeaux ne passaient pas sans dommage, évidemment.
La présence de celui-là sous notre nacelle démontrait que les Allemands n'avaient pas abandonné l'idée d'une invasion par mer.
— Ils en ont construit moins qu'on ne dit observa judicieusement Marcel; ils les ont construits plus grands, ça revient au même. S'il en passe seulement un soixantaine de ce type-là, les Anglais auront de la besogne sur leurs grèves.
— Raison de plus, dis-je, très nerveux, pour que nous dépistions, si possible, les cohues qui se préparent à tomber du ciel. Vite, capitaine!
En quelques minutes, vent arrière, nous arrivions à la côte. Le phare de Southend nous apparut à si courte distance que nous faillîmes le décoiffer.
Je redoutais quelque méprise. Pourvu, me disais-je, qu'une sentinelle de l'armée de terre ou de la marine ne nous tire pas dessus par erreur, dès que nous allons émerger de ce maudit brouillard!
Mais le capitaine Mourata, qui n'oubliait rien, nous avait fait annoncer par les coups de sirène mentionnés au manuel de l'aérotactique anglaise qu'il avait pris soin d'étudier quatre coups longs et deux brefs dans le rythme du God Save the King.
Deux fois la sirène actionnée par le moteur, répéta son cri rauque dans le mouvement de l'air national:
God save our gracious king.
Personne ne bougeait. Nous commencions à nous demander si nous étions bien à Southend lorsqu'enfin la sirène du phare nous envoya les quatre notes piquées de la réplique:
God save the king...
— Attention! fit le capitaine. Nous descendons à portée de la voix pour une minute à peine...
— Communication urgente! criai-je à un homme qui parut sur le môle.

Un guetteur nous expliqua que depuis une heure il ne cessait
de téléphoner à Londres de graves nouvelles. (Page 303).
L'Austral s'approcha, son moteur ralenti, pour flotter quelques instants au-dessus de l'estacade.
Un guetteur, dans son caban, nous expliqua que depuis une heure il ne cessait de téléphoner à Londres de graves nouvelles.
— Sur le débarquement? Nous avons dépisté un radeau à deux milles d'ici et nous venions vous l'annoncer...
— Oh! Ce n'est pas le premier qu'on me signale cette nuit de la côte! Depuis Harwich les sémaphores en ont compté déjà quinze ou seize sur les petites plages, par deux, par trois. Ils arrivent à marée basse, avec ça. La garnison d'ici est partie pour recevoir ceux que vous avez vus à coups de fusil, et plus d'un est sûrement coulé par nos navires au large. Mais avec un pareil brouillard, qu'est-ce que vous voulez faire à la mer? Pour les bateaux, grands et petits, il n'y a qu'à mouiller. J'ai toujours dit que nous verrions ça un jour... Des étrangers profiter du brouillard pour pénétrer chez nous.
Tandis que le gardien du phare nous faisait ces déclarations plutôt pessimistes, l'Austral dérivait et s'éloignait de lui.
Quelques tours du moteur nous ramenèrent à portée de la voix.
— Qu'est-ce que vous avez téléphoné à Londres exactement? lui demandai-je.
— Qu'à mon appréciation cinq ou six mille Allemands ont déjà débarqué sur nos grèves, dans le secteur qui commence ici pour finir à Harwich. Je ne sais rien de ce qui se passe plus haut, s'il s'y passe même quelque chose. Les chefs militaires sont prévenus à Londres. Je ne peux rien faire de plus. Mais vous, gentlemen, ne savez-vous rien d'autre?
— Nous avons entendu le canon au large. C'est tout.
— Vous retournez à la mer probablement? Et je devrai le téléphoner à Londres.
— Sans doute! Nous venions vous. aviser de l'apparition de ces radeaux de malheur; mais puisque vous nous avez devancés...

Des pécheurs qui relevaient leurs filets à marée basse
assistèrent les premiers au débarquement de cinq ou six
mille soldats de l'Allemagne armés jusqu'aux dents! (Page 303).
— Ils ont commencé à se montrer à trois heures. Des pêcheurs qui relevaient leurs filets à marée basse, même assez loin d'ici, sont arrivés comme des hallucinés. Vous pensez, gentlemen! Des bonnes gens qui s'en vont vérifier si la mer en se retirant a laissé une douzaine de soles ou de mulets dans leurs parcs et qui voient arriver du large, sautant de rocher en rocher, des soldats de l'Allemagne armés jusqu'aux dents! Nos pêcheurs ont pris leurs jambes à leur cou, et sont accourus jusqu'ici. De la plage la plus proche ils ont encore fait plus de trois milles à pied pour m'informer. C'est que partout où ces radeaux s'échouent le désert est complet. Ce sont des dunes ou des marais. Comme vous savez, notre rivage est assez bas. Nos gaillards ne sont pas en peine de trouver les endroits favorables.
— Il n'y a donc pas de fortifications par ici? demanda Marcel, ni de troupes en surveillance?
— Non, monsieur, pas de fortifications. On n'a jamais voulu en construire. La flotte suffira bien à vous défendre, nous disait-on. Voyez ce qu'elle vaut, notre flotte, par un brouillard comme celui-ci! Rien, absolument rien. Elle est paralysée; elle ne peut que faire des bêtises, si par hasard on lui demande quelque chose. Les navires qui manoeuvrent là-dedans sont perdus.
Une sonnerie retentissait, impérieuse, dans la tour du phare.
— Téléphonez au War-Office, dis-je au gardien qui se pressait de rentrer, que l'aérocar Austral, de la French aerial fleet, a rencontré un radeau à deux milles, et qu'il va de nouveau se mettre à la recherche de l'armée aérienne.
— Car il est bien évident, continua Marcel, tandis que nous remontions dans l'insupportable brume, que la descente est combinée, comme on l'a toujours dit: aérocars et radeaux. Supposez qu'il arrive cinquante mille hommes par en bas et la moitié, le quart seulement par en haut. Ce n'est pas drôle pour l'Angleterre, dites? Et si braves que soient ses soldats, je ne vois pas qu'il soit très facile de rejeter à la mer ces soixante mille ou soixante-quinze mille hommes, quand la mer les aura déversés sur le sol britannique!
Il me sembla voir le jour pointer au large.
Le brouillard se colorait en blanc, c'était tout ce qu'il y avait de changé dans le ciel. Le froid restait vif, l'humidité désagréable.
Nous étions abattus par l'insuccès de ce début, sans parler de l'ennui que nous causait la révélation du plan décidément suivi par les Allemands, même après les explosions de l'Elbe.
Pouvait-il en être autrement? Et la conception napoléonienne de la descente en Angleterre devait-elle subir de ce fait autre chose qu'un retard? Non, à bien y réfléchir, non. L'idée primitive s'exécutait même avec une promptitude singulière.
— Où allons-nous? me demanda le capitaine, lorsque nous eûmes repris l'altitude de cinquante mètres.
Mais je n'eus pas le temps de lui répondre.
Un appel strident de la sirène du phare nous fit dresser l'oreille. Le gardien nous envoyait le signal de revenir à portée de la voix.
Un son prolongé, trois brefs, répétés par trois fois, signifiaient clairement, dans le manuel, l'injonction de passer aux ordres.
Ce fut chose aisée.
— Qu'y a-t-il? Est-ce pour nous? demandai-je au guetteur, aussitôt que nous fûmes à bonne distance.
— C'était précisément à votre sujet, gentlemen, qu'on m'appelait tout à l'heure au téléphone. Voici l'ordre qui m'est transmis: Aviser l'Austral de la French aerial fleet que sa mission n'a plus d'objet dans l'Est. La flotte aérienne allemande, trahie par un accident, est signalée au-dessus de Saint-Albans. Elle s'avance donc vers Londres par le Nord. Rallier immédiatement le pavillon de l'aéramiral.
— Compris! criai-je de toutes mes forces au guetteur. Merci, mon brave!
Et cette fois ce fut après avoir mis le cap à l'Ouest que nous remontâmes à cent mètres dans la bruine.
Les Japonais avaient échangé quelques mots d'étonnement, de regret plutôt.
Je devinais leur ennui d'avoir manqué la flotte aérienne dans la mer du Nord et de manquer peut-être à présent le spectacle de son arrivée au-dessus de Londres, où deux cents aérocars anglo-français l'attendaient dans le traquenard d'un ciel industriellement nettoyé.
— C'était à prévoir, mâchonnait le capitaine. La route directe était trop simple. Qu'une escadre, que des radeaux flottants sur la mer prennent la ligne droite pour diminuer leurs risques, c'est explicable, mais qu'une armée aérienne les imite, voilà qui ne rimerait à rien. Dans l'air, même embrumé comme celui de ce pays, déshérité vraiment par la nature, il n'y a pas d'obstacles. Rien ne s'oppose à ce qu'on fasse un détour, prolongé au besoin, pour tromper ennemi. En tirant dans le nord de Londres pour se rabattre à angle droit sur Saint-Albans, Watford ou Chipping Barnet, les Allemands ont agi en tacticiens prudents. Ils supposaient, je pense, que la flotte française les guettait par ici...
— Ou en mer, à quelques milles, dit Marcel.
— Enfin, observai-je pour conclure, nous l'avons manquée. Il s'agit à présent de nous distinguer, de venger un échec dont nous ne sommes pas responsables, certes, mais qui, tout de même, agace notre amour-propre.
Je ne sais ce qui me bourdonnait dans la tête: c'était comme un accès de fureur.
Il y avait de la vanité blessée, du chagrin et de la colère dans le flot de pensées qui me montait au cerveau.
J'avais hâte de sortir de ce linceul glacé qui nous enveloppait.
— En grâce, dis-je au capitaine, tâchez de nous emmener à Londres à la plus grande vitesse. Assez de brouillard, assez!
— Avec vent arrière, répondit le Japonais, nous mettrons moins d'une heure.
Et ce fut, en effet, moins d'une heure après, que l'Austral franchit la dernière nappe embrumée.
Dès Greenwich l'effet des antifogs se faisait sentir.
Le jour était levé.
Nous n'avions cessé d'épiloguer tous les trois, en route, sur les conséquences du débarquement.
Mais cette préoccupation, encore qu'elle fût singulièrement grave, cédait bientôt le pas au spectacle qui tout d'un coup nous frappa de stupeur.
L'horizon, très clair au nord de la ville, était littéralement criblé d'aérocars de toutes formes et de toutes dimensions, qui peu à peu grossissaient au bout des lorgnettes et montaient lentement dans le ciel.
Nous étions bien, cette fois, en présence de l'ennemi.
Prudemment dissimulé dans les derniers replis du brouillard, l'Austral évoluait à cinq cents mètres au-dessus de Southwark, sortant de la zone protectrice juste assez pour nous permettre de saisir d'un coup d'oeil encore lointain la tactique de nos adversaires.
— Celle de l'aéramiral était tout indiquée, dit Marcel. Il a fait la même manoeuvre que nous faisons ici. Informé à temps de l'arrivée de la flotte adverse, il a caché la sienne dans les épaisseurs de brume qui forment un cirque autour de Londres. De cette façon les envahisseurs auront deux surprises. La première, avec laquelle ils viennent de faire connaissance: un ciel de Londres balayé, alors qu'ils comptaient le trouver très sale.
Les antifogs continuaient à déchirer les airs de leurs déflagrations assourdissantes...
— La seconde, compléta le capitaine au milieu de ce fracas: les flottes alliées sortant subitement de l'invisible et leur tombant dessus de tous les côtés à la fois. C'est bien joué.
L'heure du choc aérien était donc venue!
Nous arrivions trop tard pour nous mettre à la recherche de l'aéramiral. Je n'avais au demeurant rien à lui apprendre, et pour cause.
— Attention, Messieurs, dis-je aux Japonais. Quoi qu'il arrive, ne vous lancez pas dans la mêlée! Nous sommes ici pour faire un compte rendu de ce qui va s'y passer et non pour batailler. Il est donc de toute nécessité que nous évitions les projectiles. Tenons-nous à distance raisonnable. Compter les coups, telle est notre mission.
Je vis bien que ce rôle passif n'enchantait pas nos Japs, mais Marcel Duchemin l'approuva; et ce n'était pas la bravoure qui lui manquait, à lui non plus.
Toute ma vie je n'ai cessé de répéter à ceux de mes confrères qui se jettent à corps perdu dans les aventures en temps de guerre:
— A quoi bon? Vous n'êtes pas ici pour prendre part aux batailles, mais bien pour en suivre les phases et les décrire ensuite à vos lecteurs. Toutes vos préoccupations doivent donc se résumer dans ce mot d'un ancien: primum vivere. D'abord il faut vivre... D'abord ne pas vous faire tuer, ni démolir en plusieurs morceaux, ce qui vous empêcherait d'exécuter le travail pour lequel on nous a précisément envoyés dans les régions où l'on se bat.
Il me fallut une certaine dose de sang-froid pour expliquer ces choses, une fois de plus, à mes amis nippons.
Je sentis bien qu'elles ne correspondaient guère à leurs penchants pour les plaies et les bosses: mais ce n'était pas le moment de risquer notre destruction complète.
Il s'agissait bien au contraire pour le représentant de l'An 2000 d'être là, de se maintenir là, autour des belligérants dont les corps à corps allaient commencer, et de se borner au rôle modeste de spectateur.
— Ma foi, dis-je à Marcel, en nous maintenant à belle distance du champ de bataille — et c'était la surface entière du ciel de Londres — nous serons comme dans un de ces promenoirs de théâtre où l'on circule tout en suivant la représentation. Voici une vue d'ensemble qui vaut qu'on l'examine. Mâtin!
Le lieutenant Motomi ralentissait l'allure, de manière à décrire une courbe qui nous rapprochait insensiblement du centre. Il s'agissait de ne pas perdre un détail du tableau qui se déroulait dans le ciel.
Par bandes serrées les aérocars allemands émergeaient du Nord les uns après les autres. Ils pouvaient être cinq cents au plus, mais non deux mille ni quinze cents, ni même un millier.
Il y en avait de gigantesques, de moyens, de tout petits.
Marcel m'en signala qui ressemblaient à des jouets et ne pouvaient sûrement pas porter plus d'un homme. D'autres affectaient des formes bizarres. Evidemment l'Allemagne avait fait appel à toutes les conceptions réalisées, disponibles, et vaille que vaille, elle avait chargé de soldats ce matériel disparate.
La vue d'une telle agglomération de navires aériens n'en était pas moins ahurissante. Tout de suite j'évoquai la mémoire de l'aéramiral défunt.
— Pauvre Rapeau! dis-je à mes compagnons. Qu'est-ce qu'il eût dit de ça?
Les dépêches américaines étaient exactes. L'Allemagne avait pris le problème sous une autre face que nous, loin de s'en désintéresser comme l'avaient dit d'imprudents optimistes.
Par ballons aussi bien que par radeaux il s'agissait de jeter du monde sur le sol anglais. C'était à terre, de toute évidence, que les Allemands comptaient combattre. Radeaux et aérocars n'étaient que des moyens d'acheminer les combattants dans l'île
Ces nuées de chargements humains circulant dans les airs me troublaient, encore que mes yeux fussent déjà familiarisés avec les formations de notre flotte.
Quant à mes compagnons, y compris Marcel, qui jamais n'avaient vu plus de trois ou quatre engins de ce genre se déplacer à la fois, leur surprise allait jusqu'à la stupéfaction.
Songez que sur l'horizon ces cinq cents points noirs — pour adopter le chiffre le plus proche de la vérité — montaient, montaient,
Comme un vol de corbeaux carnassiers dans l'aurore.
Nos exclamations partaient du bord sans discontinuer.
Chacun surveillait sa besogne d'un oeil, suivant l'expression populaire, et dévorait de l'autre le vol en avant des envahisseurs.
Leur plan d'enveloppement se dessinait.
En forme de fer à cheval, sur cinq lignes de profondeur, le centre et les deux ailes avançaient dans le ciel. Celles-ci s'éparpillaient aussitôt vers Regent's Park à l'Ouest et Victoria Park à l'Est; le centre se maintenait en arrière, au-dessus de Highbury.
— Quelles formes bizarres!
— Et combien variées!
— Mais tout cela semble lourd!
— Qui a parlé de deux cents hommes transportés par un seul de ces machins-là? demanda Marcel.
— Les espions anglais, répondis-je.
— Ils ont eu l'oeil. C'est absolument exact. Voyez, capitaine.
Le capitaine Mourata, debout pour la première fois depuis le départ, regardait attentivement cette profusion d'engins de guerre.
— C'est incroyable, dit-il. Il y a là une tentative bien audacieuse, car le danger est grand. Voyez comme les pilotes se tiennent à faible altitude.
— Ils cherchent à descendre à terre.
— C'est bien clair. Suivez la manoeuvre en remarquant les dimensions des aérocars qui forment les ailes extrêmes. Ce sont les plus grands, ceux qui portent 200 hommes. Que voulez-vous qu'ils fassent dans les airs? Rien dès qu'ils ont réussi à s'amener au-dessus de leur objectif. Le but évident est de jeter à terre tous les Prussiens en armes dans Regent's Park. Il n'y a pas un bataillon anglais qui soit affecté à la défense de ce côté-là. Terroriser la ville, c'est bien cela.
— Elle l'est déjà, fis-je. Regardez donc les rues, les avenues! Il n'y a plus personne! Ce qui reste de souterrains disponibles est sûrement bondé jusqu'aux orifices!
En effet, nous avions beau chercher des yeux une foule, des groupes, des passants isolés; rien de vivant n'apparaissait sur les voies publiques.
On eût dit une nécropole, dont les antifogs pouvaient assez bien figurer les cheminées crématoires.
Nous n'étions pas là depuis deux minutes que de l'énorme jardin partirent deux volées de mitrailleuses.
— Le bal commence, murmura Marcel en riant.
En effet, une batterie d'obusiers amenée à toute vitesse crachait en l'air ses projectiles, fort capables, nous dit Mourata, de toucher un aérocar à mille mètres de hauteur. Il connaissait la pièce nouvelle dont l'Angleterre se servait pour cet objet; l'invention en était due à l'un de ses compatriotes, le commandant Foujima.
Pourtant aucun ballon ne parut blessé. Pour toute riposte, une trentaine d'aérocars immenses, cubant bien, eux aussi, 70.000 mètres, se laissèrent choir d'en haut avec une surprenante rapidité. Leurs équipages faisaient feu sur les artilleurs anglais, avec une vitesse vertigineuse.
Evidemment, il s'agissait pour les Allemands d'occuper Regent's Park et d'en faire le noyau d'une redoute improvisée.
Ces événements se passant à 4 kilomètres de la zone où nous croisions, nos oreilles ne percevaient aucun bruit. Nos yeux seuls, grâce aux jumelles, voyaient les fusils s'abattre vers la terre, les soldats anglais tomber et les Allemands, dans une apparente confusion, mettre le pied hors des longues nacelles, puis descendre à terre comme des singes, mais comme des singes ailés.
Chacun d'eux, en effet, se laissait couler dans le vide, sous un parachute original, à trente mètres du sol, qu'il atteignait ainsi vivant, blessé ou mort; car déjà les balles commençaient à porter.

En dépit des coups de feu, les Allemands opéraient
ainsi une descente à toute vitesse. (Page 307).
En dépit des coups de feu, les Allemands opéraient de la sorte leur descente à toute vitesse, par centaines, et aussitôt sur le sol, se formaient en tirailleurs pour ouvrir le feu contre les vestes rouges, tandis qu'au centre du parc, nombre d'entre eux piochaient déjà la terre et s'apprêtaient à improviser une forteresse. Cette façon de débarquer, sans atterrir les aérocars, simplifiait à vrai dire singulièrement les choses.
— Ils sont fous, m'écriai-je pourtant. Quand bien même ils réussiraient à déposer ainsi, brutalement, quelques milliers d'hommes, ces malheureux ne tiendront pas dix minutes contre les troupes que le War Office expédie sûrement de toutes les casernes et de tous les camps de la banlieue vers Regent's Park. Avant dix minutes, elles seront là...
Je regardais ce qui se passait en attendant: des ballons, en forme de colossales saucisses, au nombre de cinquante au moins, ne cessaient de déverser, comme de simples grains de sable, leurs occupants, au nombre de dix mille au moins, sur le sol anglais.
Deux de ces fantastiques transports avaient déjà repris l'air, délestés de leur marchandise humaine et gagnaient les couches plus élevées pour y tenir un autre rôle, évidemment.
— Diable! pensai-je, voilà tout de même un noyau dangereux que la défense n'eût pas dû laisser se former.
— Que font donc les flottes alliées? demanda le capitaine Mourata en fronçant le sourcil. Elles auraient dû se montrer déjà...
Mais au même instant, la manoeuvre souhaitée s'opérait, magnifique, magique!
Tandis que les aérocars allemands, embarrassés par les opérations du débarquement, si rapide et si aisé que le rendit l'emploi des parachutes, se tenaient à deux cents mètres, avec, pour unique objectif, la mise à terre de leur armée, on vit surgir de tous les points de l'horizon, à six cents mètres, les deux cents unités de combat commandées par l'aéramiral de Troarec et par son collègue anglais Sir John Burnside.
A cette vue, qui passait toute imagination, nous ne pûmes retenir dés cris de. joie sauvage, des hourras frénétiques, à l'adresse de nos braves:
— Vive la France! Vive l'Angleterre!
Et j'ajoutai, électrisé:
— Vive le Japon!
— Rapprochons-nous, dis-je au capitaine; on verra mieux.
Les Japonais ne se firent pas répéter l'invitation. L'Austral gagna un kilomètre environ; nous pouvions suivre, désormais sans difficulté, les phases de la bataille qui s'engageait.
Elle me donna tout de suite — et à mes compagnons, cela va sans dire — une impression singulièrement neuve.
Pour la première fois depuis qu'il en était tant question sur la terre, les hommes allaient s'entre-détruire dans le ciel.
Et ce spectacle encore invu, dont les imaginations des écrivains et des dessinateurs nous avaient plus d'une fois prédit l'atrocité, les détails féroces, je l'avais devant moi. Il allait commencer et j'y assistais, comme on dit, aux premières loges!
Fidèle à son procédé, ma folle du logis ne manqua pas de bifurquer, un centième de seconde, sur une réminiscence baroque.
Savez-vous ce qui me hantait l'esprit, à cet instant solennel, que des milliers d'hommes instruits m'eussent acheté bien cher?
Le souvenir du théâtre de Bayreuth, où Wagner faisait exécuter la Chevauchée des Walkyries pour un seul spectateur: le roi Louis de Bavière, son pauvre roi fou.
N'étais-je pas seul, ou presque, dans le ciel incessamment balayé par les antifogs, pour assister à cette première sensationnelle?
Mais ce ne fut que l'affaire d'un centième de seconde. Avec un fracas tel que nous l'entendîmes à la distance où nous étions — plus de trois kilomètres — les deux cents aérocars des alliés déchargèrent sur les engins allemands tout ce qu'ils purent de mitraille et de pyrotechnie.
La tactique observée par M. de Troarec semblait triompher du premier coup. Tandis que les aérocars allemands, libérés de leur corvée de la mise à terre, ou encore occupés à jeter en bas des sections et des compagnies, remontaient péniblement à. cinq cents mètres ou se maintenaient à deux cents, la flotte française convergeait de tous les points. de l'horizon à mille mètres au-dessus de la Tamise, tournoyait comme un vol immense de vautours, au-dessus de la proie facile que lui offrait la flotte allemande et l'accablait de fusées, de grenades que nos monte-en-l'air jetaient à la main, joyeusement, en poussant des cris dont l'écho nous arrivait:
Vive la France! Vive la République!
Spectacle d'une horreur inconnue! A deux cents mètres et à cinq cents, une innombrable masse de. ballons multiformes, une nuée de barques, de cargo-boats et de chalands aériens, construits pour transporter des hommes et non pour combattre.
Au-dessus l'autre nuée, celle de nos vaillants du Mont-Blanc, dont les 70.000, les 33.000 et les 16.000 mètres cubes évoluaient à mille mètres avec une admirable agilité.
Sur les flancs de notre flotte à nous, les Anglais, moins prompts à gagner les hauteurs, plus lourds dans leurs mouvements, mais fort utiles en ceci qu'ils prenaient en écharpe les adversaires attardés en dessous.
— Ralentissez le moteur, commandai-je, et laissons dériver. Personne ne viendra nous inquiéter par ici.
Nous nous trouvions précisément, pour voir ce début de la bataille, au-dessus de la Tour de Londres et de la cohue d'espions que j'y avais laissée.
Notre indicateur d'altitudes marquait 900 mètres.
Nous étions tous debout, les lorgnettes collées aux yeux, et je ne puis dire quelles exclamations le commencement de ce spectacle grandiose arracha aux Japonais.
Ils gazouillaient dans leur langue. Avec une rapidité fébrile ils échangeaient les plus vives impressions.
Et de Wami, de Sikawa, de Motomi, de Narabo. c'était à qui porterait le premier un jugement sur les choses, à mesure qu'elles s'accomplissaient.
Le capitaine Mourata se tenait sur la réserve, à cause de son grade, sans doute. Mais il suffisait de le regarder pour comprendre que le choc tant attendu le mettait au comble de la joie. Il tressaillait derrière sa lorgnette, et sa bouche se plissait rageusement. Joie secrète et impatience contenue!
L'effet du premier envoi de nos monte-en-l'air fut extraordinaire.
Trente aérocars allemands, quarante peut-être, frappés perpendiculairement, éclatèrent et furent précipités sur le sol avec les hommes qui les montaient encore.
La plupart de ceux que nous regardions culbuter ne portaient guère que leur équipage réduit au strict nécessaire, ayant vidé leur lot de passagers par le moyen des ingénieux parachutes. Mais deux transports énormes, aussi puissants que le Montgolfier, de triste mémoire, descendirent à toute vitesse sur les arbres de Regent's Park avec leur cargaison au complet.
Plus de quatre cents hommes étaient ainsi lancés à terre, d'un seul coup.
Les nacelles s'étant retournées par la force des explosions, tous semblaient voués à la mort épouvantable de Wang.
Mais, comme leurs camarades, tous étaient munis du parachute ingénieux que notre aérotactique n'avait pas encore adopté, soit que les modèles proposés par quelques inventeurs n'eussent pas plu aux grands hommes de nos bureaux, soit qu'en fin de compte nos chercheurs n'eussent pas trouvé le système vraiment pratique.
Les Allemands l'avaient découvert; voilà ce qui ne faisait aucun doute pour qui voyait leurs luftdragonen (dragons de l'air, c'était leur mot) se jeter dans le vide comme vous vous jetteriez à l'eau, sûrs des qualités d'une bonne ceinture de sauvetage.
Rien n'était tragi-comique, en dépit de l'horreur de cette scène, comme l'éparpillement dans l'espace de tous ces êtres humains, bottés, armés, ceinturonnés, que la chute de leurs corps transformait aussitôt en pantins à antennes.
Leurs pieds gigotaient drôlement, comme pour communiquer quelque vertu au parachute fixé dans le dos de chaque homme, par des bretelles.
Evidemment ce petit appareil n'avait aucun rapport avec les merveilleux mécanismes qui permettaient à nos voleurs de naviguer dans l'air, d'y combattre et d'y vaincre les masses de fantassins terrorisées; mais pour descendre d'une hauteur de deux cents mètres sur le sol ou dans les branches des arbres, c'était suffisant, puisque de leurs deux mains parfaitement libres les luftdragonen continuaient à tirer sur les habits rouges des coups de pistolet tant et plus.
Combien d'entre eux arrivèrent sains et saufs à terre, où leurs compagnons formés en carré les protégeaient contre les assauts de l'ennemi, c'est ce que je ne pouvais démêler. Mais Wami, qui voyait tout, nous cria que plus des trois quarts des hommes ainsi précipités de leurs nacelles touchaient le sol sans dommage. Et ce qui dépassait toute imagination, les transports aériens débarquaient de là-haut de l'artillerie légère!
Munis de parachutes aussi, les pièces, les projectiles en caissons, les affûts, les roues, descendaient sans trop de secousses, graduellement, comme si une force intelligente les eût retenus en l'air à point, jusqu'au moment de leur arrivée à terre.
Morts, blessés, ou simplement rejetés en dehors de la zone protectrice, les soldats qui n'avaient pas la chance de bien atterrir étaient lamentables à voir: ceux que les balles avaient tués tombaient raides, tout droits; ceux qui souffraient se tordaient, se recroquevillaient sous la douleur; ceux qui n'avaient rien joignaient les mains et demandaient leur grâce bien avant d'arriver au sol, où les Anglais se bornaient, pensai-je, à les faire prisonniers. Ceux-là ressemblaient vraiment à ces anges que les imagiers naïfs représentent les ailes étendues, descendant du ciel.
De trois côtés à présent s'avançaient à grande allure les mitrailleuses automobiles, les compagnies d'infanterie rappelées de la périphérie où le War-Office les avait échelonnées en prévision d'une attaque très différente.
— Cette tactique des Allemands, dit Marcel, est vraiment audacieuse; je suis bien de l'avis du capitaine. Mais si elle réussit, quel coup de dés! Voyez donc. Déjà dix mille hommes sont établis dans Regent's Park. Ils ont trouvé le moyen de descendre des nues avec de l'artillerie! Pour les déloger de là, disons pour les faire prisonniers ou les exterminer, il faut que les Anglais amènent vite des troupes d'infanterie en nombre égal, et de l'artillerie à l'avenant. Or, nous n'avons vu qu'une partie de l'opération. Elle a une toute autre envergure puisque derrière la première ligne d'aérocars il en arrive quatre autres avec la même formation en fer à cheval.
— Poum, poum, bing, boung! criaient les Japonais en voyant éclater par essaims, à présent, les aérocars des envahisseurs sous le déluge de feu que leur lançaient les nôtres. Marcel voyait juste:
— Admettons que les cinq cents unités qui sont venues jusqu'à Londres à la faveur de l'épais brouillard soient l'une après l'autre pulvérisées, et qu'il n'en reste plus une seule dans deux heures d'ici...

Déjà deux mille Allemands avaient trouvé le moyen de descendre des nues
avec de l'artillerie et de s'établir solidement dans Regent's Park. (Page 310).
— Parbleu! interrompit le capitaine Mourata qui devinait le raisonnement de l'enseigne, ça leur est égal! Il y a ce parachute nouveau, merveilleux, qui ne figurait pas au calcul des prévisions. Grâce à lui cinquante mille Prussiens, Saxons, Bavarois et autres confédérés allemands vont prendre terre ici comme des oiseaux. Ils occupent déjà dans le coeur de Londres une position qu'ils vont, en deux heures aussi, rendre difficile à reprendre.
— Voyez déjà les épaulements qui s'élèvent, cria Sikawa, le lieutenant du génie. Deux hommes sur quatre creusent des abris.
— Non seulement ils ont de l'artillerie, ce qui est très fort; mais voyez: ils ont aussi jeté à terre des outils, des instruments que nous connaissons bien, à l'aide desquels ils peuvent creuser là, eux aussi, des galeries protectrices. Pendant ce temps-là les radeaux ont peut-être réussi à débarquer sur trente points de la côte. Admettez que trente mille hommes aient réussi à passer...
— Ça ferait quatre-vingt mille, déclarai-je un peu émotionné. Quatre-vingt mille Allemands dans l'île en si peu de temps, c'est beaucoup...
Le capitaine nous regarda, Marcel et moi, comme un homme qui trouvait que la partie s'engageait mal pour l'Angleterre.
— A quoi tiennent les destinées! fis-je en philosophant. Tout le succès de cette manoeuvre allemande vient de ce petit parachute grâce auquel les combattants peuvent être lancés à terre d'une hauteur respectable, comme de la poussière de charbon et s'y poser de même, avec armes et bagages, au lieu de s'y fracasser comme nos monte-en-l'air..
Au même moment nos jumelles se dirigeaient vers un affreux épisode.
Nos transatlantiques, au nombre d'une quinzaine, exterminaient avec une précision sauvage autant de transports ennemis du plus gros tonnage.
Vides, hélas! C'est-à-dire débarrassés de leurs troupes et livrés à quelques hommes qui essayèrent de les sauver ou de se sauver comme leurs camarades. Mais avec un acharnement que provoquait le succès de ce procédé d'invasion, les nôtres, et aussi quelques équipages anglais, canardaient à courte distance ces malheureux sacrifiés.
On les voyait tomber sans vie, avec des contorsions atroces et s'étaler brutalement sur les toits des maisons; car l'action s'étendait assez loin autour de Regent's Park.
Tout à coup un cri de fureur sortit de nos poitrines.
De la coque des ballons allemands fracassés, démolis, qui flottaient comme des épaves, s'envolait une myriade d'appareils bizarres que nous n'avions pas encore vus. On reconnaissait à leur silhouette des hélicoptères. Ils s'élançaient rapidement vers le zénith, avec la rectitude d'un projectile.
Combien en vîmes-nous partir ainsi, lancés par les derniers occupants des aérocars-monstres entraînés vers la terre?
Or, pour mieux achever la perte de leurs adversaires, nos grosses unités, et aussi deux grands croiseurs anglais venaient de quitter l'altitude de neuf cents mètres. Elles étaient imprudemment descendues au-dessus du troupeau de baleines crevées, désemparées, que leurs hommes achevaient à coups de grenades.
On voyait là, dans un secteur du ciel, comme une mêlée de mastodontes où les distances réglementaires n'étaient plus observées.
Le piège avait été bien tendu. On attirait sur un même point tout un groupe de nos gros engins, tandis que les autres besognaient, dans l'immensité de l'air, contre la nuée des aéronefs en fuite.
C'est au milieu de ces puissants engins ramassés en troupe que nous voyons tout à coup les hélicoptères s'envoler, dans une trajectoire irrésistible.

Nous vîmes tout à coup les hélicoptères s'envoler,
dans une trajectoire irrésistible. (Page 311).
Les commandants ont aperçu le danger, car ce sont autant de brûlots qu'on leur envoie.
De longues flammes d'alcool et d'essence bavent au-dessous de ces appareils audacieux.
Au jet des fusées de haut en bas, les Allemands ripostent par l'envoi des fusées de bas en haut.
La course de celles-ci est faible, mais toutes ont la force de parcourir les deux cents mètres qui les séparent de leur but.
Comme des torpilles, elles vont arriver avec le feu qui les suit dans la coque ou dans l'enveloppe des ballons de soie; celle-ci fût-elle en trente-six épaisseurs que l'incendie est certain.
Nous voyons très nettement la troupe des cachalots exécuter un mouvement de recul.
Mais ce mouvement, s'il en sauve quelques-uns, perd les autres. Les torches destructives, lancées par quelque catapulte, vont frapper aux endroits délicats, crèvent les parois d'une nacelle, entrent dans une soute, mettent le feu aux artifices, font éclater à leur tour trois ou quatre de nos aérocars, en dépit de la sécurité que semblait leur assurer l'altitude.
Pour éviter l'incendie qui monte vers eux, les commandants font de brusques manoeuvres, et des collisions tragiques nous apparaissent déjà, irrémédiables. L'un des croiseurs anglais est éventré par le Général Meusnier, que je reconnais à son pavillon amiral. L'Anglais se dégage, mais c'est pour recevoir en plein ventilateur deux hélicoptères qui provoquent son explosion. Le voici qui s'ouvre lamentablement et tombe sur les arbres de Regent's Park.
Nous assistons alors à ce spectacle désespérant: les cloudcompellers anglais sont fusillés avant d'arriver à terre par les Allemands établis dans Regent's Park, tandis que sur ceux-ci tirent sans rémission trois compagnies de highlanders amenés par une centaine d'autobus.
Alors c'est une chute de corps effroyable qui commence. Ceux de nos équipages dont l'aérocar a été incendié, périssent affreusement. Pendant quelques minutes les vivants et les morts tombent pêle-mêle de deux cents mètres sur le sol.
— Quand je pense, dis-je à Marcel, que la plupart de ces pauvres gens se suicident à cette minute pour éviter la fin de Wang!
Et les chutes continuaient, par grappes, tandis que les étoffes, dégonflées subitement, s'abattaient aussi, entraînant des machineries pesantes qui tombaient avec elles sur l'ennemi, sur les maisons environnantes, dans les rues.
J'estimai que plus de cinq cents hommes, de la flotte aérienne anglaise et de la nôtre, venaient de périr ainsi sous nos yeux, abominablement. Quelle guerre que celle qui va prendre maintenant les nuages pour champs de bataille!
Nos Japonais grinçaient des dents; je sentais une rage sourde me mordre au coeur, et certainement Marcel, qui ne disait plus rien, souffrait autant que moi de voir nos braves monte-en-l'air périr ainsi devant nous.
— Je sais bien, mâchonnai-je, qu'on ne fait pas la guerre sans risquer des vies: on n'y fait même que ça. Mais cette forme nouvelle de la bataille, vrai, nous surprend, nous irrite par son imperturbable cruauté. Hardi! Troarec! A mort toute cette racaille! Le feu sur ce qui reste de l'Armada prussienne! Il faut que dans deux heures, comme nous le disions à l'instant, il n'en reste pas un atome!
On eût pu croire que l'amiral m'entendait.
A la vérité, la manoeuvre qu'il ordonna au même instant n'était que logique.
Dans un magnifique mouvement en hauteur, il enleva tous ses navires hors de la portée des torches volantes. Puis embossant méthodiquement les deux flottes combinées au-dessus des transports allemands, presque aussi nombreux qu'à la première minute de l'action, car il en restait au moins les trois quarts dans l'espace, il donna par signaux à chacun des commandants français et anglais l'ordre de cribler de fusées les unités allemandes, grosses ou petites, qui se trouveraient au plus près.
L'éparpillement des masses combattantes — plus de six cents aérocars des trois nations louvoyaient à ce moment au-dessus de la partie Nord-Ouest de Londres — permettait désormais de choisir les victimes. En quelques minutes, on pouvait arriver à la destruction rêvée.
On y arriva presque, et ce fut le caractère singulier de cette journée fantastique. En moins de cinquante minutes les flottes alliées firent exploser tout ce qui naviguait au-dessous d'elles. Les équipages de chaque unité allemande se trouvaient pris entre deux feux. Par en haut, ils recevaient les fusées et les grenades de leurs adversaires aériens. Par en bas, dès qu'ils cherchaient à fuir, en se rapprochant de terre, ils étaient canardés par les troupes anglaises qui, en bataillons entiers, entraient à présent dans la zone du carnage.
C'était un spectacle terrifiant.
Pas un ballon allemand qui ne fût visé d'en haut et d'en bas; pas un qui ne fût atteint, surtout par en haut.
Désireux de venger leurs camarades tués quelques instants plus tôt das la bagarre, nos monte-en-l'air et les cloudcompellers s'acharnèrent, on le voyait bien, sur les carapaces dont le gros dos, impuissant à s'élever aussi haut qu'eux-mêmes, leur offrait une cible facile.
Les Allemands restés à bord des nacelles envoyaient méthodiquement, suivant une tactique qu'ils avaient étudiée aussi bien que nous, encore qu'elle fût différente de la nôtre, des torches-torpilles. Mais la distance que maintenait M. de Troarec était trop grande pour leur faiblesse ascensionnelle
Il devenait évident que la destruction du formidable matériel qui avait amené l'armée d'invasion n'était plus qu'une question de minutes.
Le réduire à néant, ôter la vie aux équipages qui le maintenaient dans les airs, c'était le but que poursuivaient, de toute évidence, l'aéramiral français et sir John Burnside.
Priver les envahisseurs de tout moyen de fuir, c'était un résultat.
A vrai dire, je craignais que ceux-ci ne l'eussent escompté, et que le sacrifice du matériel et des hommes qui le défendraient jusqu'au bout ne fût inscrit en tête de la conception si hardie que l'Allemagne réalisait à cet instant, en dépit des efforts faits pour l'en empêcher. L'exemple de Fernand Cortez brûlant ses vaisseaux les avait sûrement hantés.
Je pensais tout haut. Le capitaine Mourata me répondit par une judicieuse appréciation:
— Après qu'il aura fait du matériel un beau tas de ferraille, dit-il, l'aéramiral ne manquera pas de venir très fort au-dessus de Regent's Park. Le corps d'invasion pourra se démener alors; il n'aura aucune défense à opposer aux flottes aériennes coalisées contre lui. Elles le couvriront de grenades et de fusées tandis que les troupes de Sa Majesté, de plus en plus compactes, le canonneront sans trêve ni merci. Voilà une heure que la bataille a commencé. Parions que le War Office a déjà concentré vingt mille hommes autour de l'armée allemande.
— Vingt mille, fis-je, c'est quelque chose, certes. Croyez-vous que ce soit assez? Combien sont-ils, les Luftdragonen descendus de là-haut? Et les Seedragonen qui vont arriver de la mer, d'un instant à l'autre? La jonction opérée, si elle peut s'opérer, c'est soixante-quinze mille Allemands retranchés en pleine capitale.
Soixante-quinze mille Allemands retranchés en pleine capitale de l'Angleterre! C'était pourtant vrai. Et ce spectacle incroyable, nous l'avions devant nous!
Il se déroulait depuis bientôt une heure sous nos yeux.
Je remarquai que l'Austral s'en était sensiblement rapproché.
Au bruit des antifogs qui continuaient à déchirer l'air avec une régularité mathématique, nos Japonais nous avaient amenés peu à peu au-dessus d'Oxford Street. C'est dire que nous pouvions désormais suivre à l'oeil nu les phases de la lutte aérienne.!
Le capitaine Mourata fit observer qu'il serait convenable de signaler notre présence à l'aéramiral et de lui demander des ordres.
J'acquiesçai bien volontiers. Vous croyez peut-être que ce fut parce que tout danger me semblait écarté? La raison dominante fut, au contraire, tout autre.
Je sentais des fureurs batailleuses me monter au cerveau. La façon dont plusieurs de nos plus beaux croiseurs avaient été mis à mal par les Allemands m'irritait au point que je me sentais bien près d'oublier les recommandations par moi-même adressées aux Japonais dès le début de la bataille et les promesses que j'avais faites à Pigeon.
Nos pavillons montèrent et descendirent le long de la drisse à signaux, et l'aéramiral répondit; mais ce fut pour nous inviter à ne pas nous éloigner du gros de la flotte, tout en planant beaucoup plus haut qu'elle et à surveiller au lointain les troupes d'invasion qui pourraient venir de la mer.
Etait-ce un effet des incessantes décharges envoyées dans le ciel depuis neuf ou dix heures par les imperturbables canons à gaz? L'extension de leurs effets à grande distance, ou plus simplement résorption naturelle par une modification de la température?°
Toujours est-il que les brouillards disparaissaient peu à peu de la périphérie londonienne et qu'on y pouvait voir, dorénavant, avec les lorgnettes, à trente kilomètres à la ronde.
Nous n'avions qu'à nous élever à cinq cents mètres pour nous assurer une vision utile à quatre-vingts kilomètres. Ce qui fut fait. Les Japonais étaient dans la jubilation. Cette entrée dans l'action, pour tardive qu'elle fût, pour platonique qu'elle leur semblât, puisqu'il s'agissait en somme d'occuper un poste de guetteur, les comblait d'aise.
Ah!ils eurent vite fait de nous enlever aux cinq cents mètres et d'y établir la faction expectante de l'Austral!
Toutes nos jumelles fouillèrent l'horizon. Nous aperçûmes de divers côtés des troupes en marche dans la direction de Londres; mais il était encore impossible vraiment, de distinguer leur nationalité. Ce qui paraissait sûr c'était que par longs convois des automobiles amenaient toutes les garnisons environnantes.
On redescendit à vive allure pour signaler cette première constatation à l'aéramiral. Il nous répondit de la renouveler de quart d'heure en quart d'heure.
Nous voilà donc remontés à l'altitude favorable. Notre aérocar s'y promène seul, décrivant un cercle dont Hyde Park est maintenant le centre.
Comment se fait-il que nous ayons passé tous du secteur de Regent's Park dans celui de Hyde Park? C'est que les flottes alliées y suivent avec acharnement une kyrielle de ballons nouvellement apparus, aux formes bizarres, rigides, qui ne paraissent pas le moins du monde flotter à la dérive.
Ils sont à deux cents mètres de terre et les nôtres à trois cents, ceux-ci criblant ceux-là de fusées dont les projectiles ricochent sur des carapaces métalliques, et de marrons explosibles.
Cette escadre est spécialement destinée à quelque objet qui nous échappe encore.
Marcel Duchemin n'est jamais venu à Londres, non plus que nul des Japonais qui sont avec nous, mais moi qui connais la topographie de la capitale, je sais que Buckingham Palace est tout près de Hyde Park, que ce palais historique abrite le roi George V et la famille royale. C'est donc par une ruse, probablement, que les ballons métalliques en question entraînent les nôtres de ce côté.
Les Anglais ne s'y sont pas trompés! Voici les quarante aérocars disponibles de l'armée britannique qui se portent au plus vite au-dessus du château royal pour empêcher les Allemands d'y mettre le feu. Car il n'est plus douteux que c'est là le plan poursuivi par cette division de la flotte ennemie.
Elle entre en scène à son heure. Les ballons qui la constituent n'ont rien de fusiforme. Ils sont sphériques, comme ceux du bon vieux temps. Mais, me fait remarquer le capitaine, chacun d'eux est remorqué par un aérocar du même tonnage que notre Austral.
— Qu'est-ce que vous voulez parier, dit Marcel que ces ballons sphériques, qu'on est obligé de remorquer, portent des citernes de pétrole en guise de nacelles et que c'est le bouquet du feu d'artifice qu'on va tirer au-dessus des appartements du roi?
— Ah! les sauvages! criai-je avec fureur.
Les Japonais eussent peut-être gardé quelque réserve si ce nouveau procédé leur avait été révélé sur un autre point de la mêlée. Mais au-dessus du palais de Sa Majesté, alliée de leur souverain, l'attentat leur parut d'une audace qui méritait tous les châtiments.
En vain nos monte-en-l'air déversaient-ils sur ces étranges accouplements leur pyrotechnie ruisselante, les autres avançaient toujours; de guingois, mais ils avançaient. Ils étaient maintenant à proximité du palais et il devenait impossible de les y poursuivre sans risquer de mettre le feu aux toitures royales qu'on voulait précisément sauver de l'incendie.
La manoeuvre de sir John Burnside ne nous parut pas heureuse.
Oubliant le premier principe de l'aérotactique qui consiste à lutter avec son ennemi suivant la perpendiculaire et non autrement, sir John, outré sans doute de voir les incendiaires se couler à portée des toits du palais de son roi, voulut à tout prix empêcher une profanation que les projectiles français n'avaient pas suffisamment retardée.
Alors, comme sur la mer, les Anglais se montrèrent dignes de leur vieille renommée.
Après avoir dépassé le troupeau des épaves aériennes, et fait une volte-face magnifique, les quarante aérocars de sir John Burnside descendirent au niveau de leurs adversaires pour foncer sur eux et les culbuter.
Ce fut un abordage terrible, un enchevêtrement d'armatures et d'enveloppes. D'en haut nous apercevions nettement l'atroce bagarre, où coup sur coup les explosions succédèrent aux explosions.
Arrêtés net, criblés de balles, mitraillés à la main, les agresseurs nous donnaient bien l'impression de leur victoire certaine, encore que ce fût au prix de gros sacrifices, car une demi-douzaine d'aérocars anglais sautaient aussi, et tombaient lourdement sur le sol des rues où plusieurs régiments de ligne s'employaient de leur mieux à sauver la vie des équipages.
Besogne difficile, car il fallait se défier d'un tir confus qui eût frappé à la fois les vainqueurs et les vaincus.
La même attitude s'imposait à la flotte de l'aéramiral de Troarec. Elle assistait impuissante aux corps à corps qui se prolongeaient dans la zone inférieure, ses pyrotechniciens n'osant eux non plus frapper au hasard dans le tas des combattants éperdument accrochés.
Le spectacle de cette épouvantable mêlée, où les équipages se fusillaient, dépeçaient en lambeaux les enveloppes, se couvraient de mitraille, tandis qu'en bas, à faible distance, l'infanterie anglaise, déjà plus nombreuse, commençait le siège de Regent's Park, nous rappelait les épopées navales de Trafalgar et de Tsoushima, transportées dans le ciel par une génération enragée.
Mais nous n'avions pas tout vu. Au moment où l'aéramiral anglais exécutait sa charge héroïque contre le groupe compact des luftdragonen, ceux-ci coupaient les câbles qui retenaient les remorqueurs aux ballons-citernes.
Emportés par le vent, dont la direction avait été soigneusement observée, les aérocars incendiaires planaient au-dessus de Buckingham Palace et laissaient tomber de leurs réservoirs, ouverts automatiquement, des flots d'essence minérale qui s'enflammaient au contact des brandons en suspension dans l'atmosphère:
Une véritable nappe de feu s'épandait sur le palais du roi et le transformait en un colossal brasier.

Des ballons incendiaires planaient au-dessus de
Buckingham Palace et
laissaient tomber de leurs réservoirs des flots d'essence qui s'enflammaient
au contact des brandons en suspension dans l'atmosphère. (Page 315).
Nous vîmes s'opérer avec méthode le mouvement des troupes chargées de protéger le sauvetage des personnes royales, une douzaine d'automobiles emmener vers Windsor, sous la protection de deux mille hommes, George V et sa famille. C'était navrant et atroce.
— Voyez donc ce qui s'allume dans l'Est à présent, nous cria Wami.
Une escadrille de ces damnés brûlots errants avait filé en vitesse, pourchassée par trente croiseurs de M. de Troarec qui les criblaient de fusées et les anéantissaient en dix minutes, mais non sans que des flots d'essence enflammée eussent été déversés sur les docks, les gigantesques docks de la Tamise.

Le plus colossal des incendies, allumé de tous les côtés à la fois par les foyers
volants, commençait à détruire les gigantesques docks de la Tamise. (Page 316).
Le plus colossal des incendies commençait à les détruire, allumé de tous les côtés à la fois par ces foyers volants qui tombaient à la centaine, avec les ballons crevés et les cadavres sur les toits des magasins, bourrés de marchandises, de coton surtout.
Jamais je n'avais vu et je ne reverrai sûrement un aussi lamentable tableau. C'était l'incendie de Rome à présent, dont le souvenir venait me hanter, et Néron, et la destruction des monuments de Paris par les gens de la Commune en 1871:
Nous étions tous dans un état de fureur indicible, car la situation s'aggravait.
— Nous pensions que Rapeau avait atteint du premier coup la perfection dans la sauvagerie, dis-je en rappelant à mes compagnons les incendies de Munich et de Francfort, mais voilà qui le surpasse!
L'action de la ville s'étendait désormais sur tout le nord .
Regent's Park devenait le centre de la tuerie à terre, car on s'y battait ferme et les mitrailleuses, les canons, les fusils y faisaient rage.
Les assiégeants, de plus en plus nombreux, y couvraient d'obus les assiégés, qui se défilaient néanmoins avec une prestesse inimaginable dans les abris souterrains creusés à toute vitesse.
Mais dans le ciel de Londres c'était une chasse impitoyable aux aérocars allemands dispersés, désemparés, prompts encore, en dépit de leurs blessures, à fuir devant leurs exécuteurs.
Nos monte-en-l'air détruisaient en effet, avec une méthode admirable, ce qui survivait de l'Armada tout à l'heure inquiétante.
— Il n'en restera pas, dit le capitaine Mourata. C'est bien le moins qu'on les extermine jusqu'au dernier.
Marcel comptait les épaves qui flottaient dans le ciel, poursuivies sans merci par nos croiseurs.
— De trente à quarante! dit-il.
Les Japonais dénombraient de seconde en seconde ceux qui tombaient à terre, frappés sans merci:
— Un, deux, quatre, sept!
On eût vraiment dit un sinistre jeu de massacre.
Ces chutes nous remontaient le moral. Au-dessus des effroyables bûchers allumés aux quatre coins de la ville, les incendiaires, justement punis, se voyaient impitoyablement précipités à terre avec leurs engins flasques, déformés, troués, impuissants à les soutenir.
L'instinct de la conservation leur faisait ouvrir le parachute mirifique, mais c'était pour prolonger leur agonie, car dans toutes les rues à présent il y avait du monde, une foule, des foules armées à la hâte, qui sortaient de dessous terre à mesure que le nombre des assaillants diminuait.
Et cette foule tirait sans pitié surtout ce qui tombait du ciel dans un uniforme allemand.
Le feu ne détruisait pas seulement les docks sur une étendue immense; il faisait de plusieurs quartiers du Strand, de Whitechapel, de Holborn, de Liverpool Street, des brasiers fantastiques dont la fumée montait jusqu'à nous en colonnes épaisses.
On devinait pourtant, au milieu de ce déchaînement du feu et de la mitraille, que la population se ressaisissait. Le courage revenait aux timides; des hommes de toutes professions épaulaient des fusils et tiraient sans merci sur toutes les chauves-souris qui dégringolaient des nues.
Malheureusement, ce ne fut qu'un répit.
La contemplation de cet indescriptible désastre ne pouvait nous faire oublier notre mission. Le second quart d'heure venait de s'écouler. Il fallait aviser l'aéramiral.
— Voyez à Blackwall, criai-je après avoir alternativement pointé une lorgnette au delà de Greenwich. Ce sont les Prussiens! Regardez!
Et comme moi-même, Marcel, Mourata, Wami, les autres constatèrent qu'une longue colonne, forte de quinze mille hommes au moins, s'avançait à marche forcée vers Londres.
— Vite, en bas! commandai-je.
Une minute plus tard, nous signalions le fait à l'aéramiral.
Avec une promptitude admirable, les flottes combinées se formaient sur quatre lignes de file.
De toute la force des moteurs, qui, tournaient toujours avec une jolie résistance, en vérité, une centaine d'aérocars exempts d'avaries filaient le long de la Tamise, et nous les suivions, à notre altitude de cinq cents mètres aisément reconquise.
Ce déplacement subit de la force aérienne avait pour résultat de jeter à nouveau la panique dans toute la ville. Sans doute aussi, les gens d'en bas étaient avisés de l'apparition inquiétante par les communications téléphoniques.
Comme nous passions au-dessus du War Office — les deux flottes à deux cents mètres et l'Austral à cinq cents — un jeu de pavillons nous confirma la marche sur Londres du corps de débarquement allemand, fort de quarante mille hommes, disaient les signaux, car la télégraphie sans fil était impraticable dans cette fournaise.
Je remarquai le dispositif de l'armée aérienne: les Anglais y tenaient la tête, sur les quatre files, et se comportaient vraiment bien. Quoi qu'on en eût dit, le faible effectif de leur aérotactique avait sa valeur, et nos alliés nous secondaient bellement.
— On dirait que le premier de tous nous fait des signaux, hasarda Marcel.
En effet, le Prince-of-Wales, croiseur amiral, nous envoyait un message:
HOURRA POUR LA VIEILLE ANGLETERRE ET POUR LA FRANCE AMIE! SIGNÉ: TOM DAVIS.
Tom Davis était donc à bord de celui-là! Toujours le premier au danger! Le fait ne pouvait me surprendre.
J'allais dicter ma réponse à Marcel, timonier en chef, lorsque le capitaine Mourata m'adressa gentiment une prière:
— Permettez-vous, monsieur, que nous disions aussi quelque chose?
— Comment donc! Tout ce que vous voudrez!
Le Japonais alors dicta:
VIVE L'ANGLETERRE, LA FRANCE ET LE JAPON, UNIS POUR VAINCRE ENSEMBLE! SIGNÉ: CEUX DE L'«AUSTRAL».
— Très bien, capitaine, fis-je. Et je crois que ça va chauffer.
Marcel, tout en hissant ses petits drapeaux, ajouta:
— Parbleu, voici le soleil qui se montre!
Le soleil! C'était bien lui en effet, qui faisait son apparition. Dix heures! Il était déjà haut et inondait le ciel d'une lumière aussi bienfaisante qu'inattendue.
Rien ne pouvait nous être plus agréable, en vérité, que l'apparition de ce camarade. A lui seul, il valait une escadre de renfort.
Autant nous étions contristés tout à l'heure, autant la chaleur de ses rayons nous ragaillardissait.
Il nous fallut vingt minutes à peine pour arriver au-dessus de la colonne qui s'avançait vers Londres.
La flotte s'était élevée à quatre cents mètres pour éviter les flammèches que le brasier des docks envoyait par myriades dans les airs. Le passage franchi sans encombre, nous entendîmes le tapage sinistre des explosions recommencer.
De chaque bord, on lançait sur l'armée en marche tout ce qui restait dans les soutes; fusées et grenades jetaient le désordre dans les rangs des envahisseurs. Mais je dois à la vérité de déclarer que stoïquement les rangs se refermaient et se reformaient sur tous les vides provoqués par les projectiles.
Les hommes tombaient, et contrairement aux vieux us encore pratiqués sur le continent, on ne les ramassait plus. Il s'agissait évidemment d'arriver sans retard à Regent's Park pour y joindre les assiégés avant que les troupes anglaises eussent trouvé le temps de se réunir en nombre assez considérable et de boucher le passage.

Nous apercevions les détachements d'éclaireurs et les batteries d'artillerie
automobiles qui venaient inquiéter les flancs de la colonne allemande. (Page 318).
De-ci, de-là, nous apercevions bien des détachements d'éclaireurs, quelques batteries d'artillerie automobiles qui venaient inquiéter les flancs de la colonne. Mais, en vérité, il nous parut que le commandement en chef des troupes à terre était bien lent à expédier la petite armée indispensable pour retarder la marche de celle-là, en attendant qu'on l'envoyât tout entière, celle-là, dans la Tamise toute proche.
Depuis deux heures on se battait, et Londres n'avait pas encore quarante mille hommes pour la défendre.
Joie, allégresse! Voilà maintenant que sur la rivière apparaissaient des fruits de torpilleurs.
Le brouillard a disparu, les marins sont redevenus disponibles. Plus de trente petits navires s'avancent ainsi, parallèlement à l'armée allemande, et commencent à la couvrir d'obus.
Mais la malchance veut que l'ennemi entre à cet instant dans la presqu'île que la rivière forme vers Poplar. Les torpilleurs doivent dessiner une boucle tandis que les envahisseurs coupent au court, suivant la corde de l'arc. Comme on les culbuterait bien dans l'eau, si du Nord arrivaient seulement deux divisions à cette minute tragique!
Prise entre trois feux: ceux des torpilleurs, ceux d'une armée de terre et les nôtres, la colonne audacieuse serait anéantie jusqu'au dernier homme!
Pourquoi faut-il que les plus belles occasions de vaincre échappent ainsi!
Quand Napoléon — le vrai, celui de Waterloo — comptait sur Grouchy pour achever la déroute de ces mêmes Anglais devenus nos alliés, c'était Blücher qui arrivait, avec 30.000 Prussiens, consommer la sienne!
Nous allions avoir notre Blücher!
Et vraiment c'était un peu singulier que personne d'entre nous n'eût jusqu'à présent remarqué qu'il n'était pas là.
Qui donc?
Eh! Jim Keog, ce bandit!
Sûrement son absence était combinée avec les mouvements ordonnés par le fliegende Marschall (*) descendu à terre comme les autres, le malin, avec un parachute.
(*) Le maréchal volant, le chef de l'armée allemande de l'air (das Luftheer).
Jusqu'au moment d'une entrée en scène décisive, Jim Keog attendait dans la nue, à quatre mille mètres. Invisible, il l'était vraiment.
M. de Troarec, non plus que ses monte-en-l'air de l'école Rapeau ne pensaient guère à lui; ou s'ils y pensaient ils ne le disaient pas. Mais moi qui connaissais l'homme et l'engin, comment n'avais-je pas jusqu'alors été surpris de ne point les voir apparaître, l'un portant l'autre, et avec le Sirius les redoutables projectiles de deux calibres, les gros et les petits, les lourds obus et les marrons somnifères, l'artillerie impressionnante de ce génie du mal?
Les Japonais, qui m'avaient tant de fois parlé de Keog comme de l'homme qui excitât le plus leur curiosité belliqueuse, s'étaient tus aussi sur son compte depuis le commencement de la bataille, ce qui ne voulait pas dire qu'ils n'eussent pas le pressentiment de son apparition.
Au moment où la colonne allemande, chassant tout devant elle et laissant derrière elle morts et blessés, pénétrait dans la presqu'île, nos yeux furent éblouis par un vibrant éclair.
— Le soleil qui s'amuse! fit Marcel.
Mais je ne m'y trompais pas.
— Ce n'est pas le soleil, criai-je avec humeur, c'est Jim Keog!
On eût dit qu'un ressort venait de lancer en avant les bustes des petits Jaunes.
Les yeux plaqués aux lorgnettes, au point que Motomi en oubliait de surveiller son moteur, ils semblaient prêts à dévorer le morceau de ciel bleu où s'apercevait un point noir, la Tortue trop célèbre à présent!
Avec la rapidité qui caractérisait ses descentes, le terrible engin s'élançait du zénith et parcourait trois mille mètres pour exécuter au-dessus des flottes alliées une série de zigs zags, effrayants de régularité capricieuse.
Son premier coup de canon fut lâché à cent mètres au-dessus des flottes, sous un angle calculé pour toucher plusieurs aérocars en enfilade.
Exploit lamentable! Cinq explosions, sous nos yeux, faisaient voler en lambeaux cinq des plus belles unités, trois des nôtres, et deux de l'armée anglaise.
Le Prince of Wales, à ce qu'il me sembla, tombait avec tout son monde. Pauvre Davis!
Il me parut qu'on me poignardât, tant ce coup du coquin yankee m'emplissait le coeur de souvenirs affreux.
Ce fut encore une épouvantable chute de plusieurs centaines d'hommes, sur la colonne allemande, qui les recevait à coups de fusils, sans cesser d'avancer.
A peine le massacre de tant de pauvres gens fut-il consommé que le misérable Keog remontait au fond du ciel bleu, très haut, et pendant quelques minutes y redevenait invisible.
La seconde phase — la plus terrible — de cette journée funeste venait de commencer.

Plan sommaire de la Ville et du cours de la Tamise pour
l'intelligence des Fascicules IX et X de La Guerre Infernale..
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.