
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
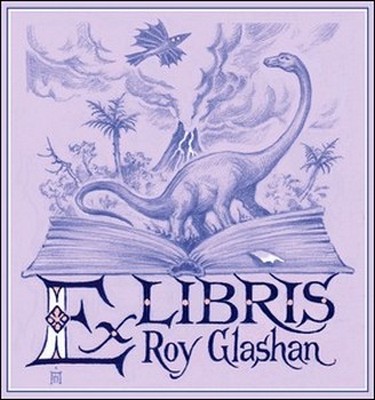

Victime du plus odieux des attentats anarchistes,
l'édifice parlementaire, brusquement soulevé sur
sa base, s'effondrait dans un terrible fracas.

Le préfet partit avec deux commissaires pour
visiter le bateau mystérieux. (Page 146).

Le correspondant du grand journal parisien l'An 2000 a déjà raconté, dans les chapitres précédents, comment la guerre a subitement éclaté entre l'Angleterre et l'Allemagne, sur une ridicule question de préséance, à l'issue du banquet qui clôturait la périodique conférence de la Paix, à la Haye. Il a expliqué les raisons qui ont forcé la France à prendre parti dans la querelle.
Successivement on l'a vu assister au départ de la nouvelle flotte aérienne française, mobilisée en secret dans l'arsenal du Mont-Blanc, puis accompagner nos hardis Monte-en-l'air dans leur raid sur Munich, incendié pour répondre à la destruction de Belfort par les Allemands.
Il enregistre ensuite pour ses lecteurs l'audacieux coup de main de l'aéramiral Rapeau, ministre de l'aérotactique, descendu avec tous ses ballons à Augsbourg, ville ouverte, pour y renouveler sa provision de gaz et rétablir la force ascensionnelle de ses unités les plus fatiguées. Mais un ballon de forme étrange survient tout à coup, fond sur l'état-major de l'armée des dirigeables. L'aéramiral et ses officiers échappent au monstre en se jetant à plat ventre dans la boue. Seul, le reporter de l'An 2000 est happé par un filet et entraîné dans les flancs de la machine volante.
Il y fait connaissance de son inventeur, l'Américain Jim Keog, sorte de condottiere, qui prétend mettre son engin mystérieux, le Sirius ou le Corsaire Noir, à la disposition de celui des belligérants qui le lui achètera le plus cher.
Après avoir obligé son prisonnier à torpiller de sa main le ballon-amiral de Rapeau, sous couleur de lui montrer la puissance foudroyante du Sirius, l'Américain confie à l'infortuné journaliste la mission de décider le gouvernement français à lui verser, à lui Jim Keog, dans le délai d'une semaine, la bagatelle de vingt millions, en échange du secret de son invention.
C'est dans ce but qu'il débarque son voyageur à Paris, sur les toits de l'An 2000, le soir d'une grande victoire remportée à la frontière de l'Est par le armes françaises, grâce à l'intervention du régiment des aviateurs. L'opération ne va pas sans quelque émotion pour le débarqué.
Je fus bientôt remis de cette légitime faiblesse. La main courante des escaliers de fer m'apparut. Je descendis une centaine d'échelons voûté, courbé, comme un monte-en-l'air qui a déjà perdu l'habitude de la marche. Je poussai une porte que je connaissais bien; elle donnait sur le grand vestibule du troisième étage, tout près des locaux affectés à la rédaction.
Mais mon premier contact avec les terriens ne fut pas heureux. Un garçon de bureau, qui fumait sa pipe au dehors, trouva ma présence insolite, inexplicable à cette heure sur les toits de l'immeuble confié à sa surveillance. J'avais à peine touché la porte que je me sentis saisi par derrière et vigoureusement poussé dans le vestibule étincelant de lumières, avec des mots pénibles pour mon amour-propre.
— Nous les connaissons, ces cambrioleurs qui profitent des réjouissances patriotiques pour visiter les étages supérieurs! Au poste, mon gaillard, au poste!

— Nous les connaissons, ces cambrioleurs
qui profitent des réjouissances publiques.
Et ce fut comme un Apache pris en flagrant délit que j'entrai dans les bureaux de mon journal, secoué de belle manière par l'homme zélé.
Ce vestibule est une vaste pièce, meublée de sofas, de canapés, de poufs, de causeuses, où les visiteurs s'assoient par groupes aux heures de la confection du journal, les jours ordinaires.
A pareille heure, un soir de réjouissances patriotiques, comme disait l'autre, je ne fus pas surpris de n'y trouver personne.
Tout à coup, des ascenseurs qui assurent le va-et-vient avec le rez-de-chaussée, je vis sortir quatre hommes, les miens! Coquet, Joubin, Malaval..: et Pigeon!
Pigeon! Ah! par exemple! Les autres, je m'attendais à les trouver à leur poste, mais lui!
Pigeon vivant! Par quel heureux miracle?
Mon sang ne fit qu'un tour. J'envoyai, d'un coup sec, promener l'officieux qui me persécutait et je m'élançai vers mon fidèle collaborateur.
Il eut un haut-le-corps où je devinai une surprise aussi grande que pouvait l'être la mienne. Puis ce furent entre nous tous des poignées de mains frénétiques.
— Comment! répéta Pigeon, devant les autres, hébétés aussi, c'est vous?
— Moi-même, mon bon! Moi-même....
— Vous n'êtes pas mort?

— Comment, s'écria Pigeon, avez-vous échappé au désastre?
— Vous voyez que non. Vivant, bien vivant!
— Tout le monde ici vous croit mort, depuis Koenigsdorf, où vous avez été porté «disparu» par l'aéramiral. Quelle affaire! Ah! par exemple! Mais comment se fait-il?...
— Et vous-même? Vous avez donc échappé au désastre du Santos-Dumont?
— Par une raison toute simple, c'est que j'étais ailleurs. Vous vous rappelez la distribution des gazettes? J'avais pris le paquet de notre bord et celui du Général-Meusnier que son commandant m'avait prié de porter à ses officiers. Pendant que je faisais cette commission, Rapeau envoyait le Santos-Dumont où vous savez... Il n'en est pas revenu. Encore si l'on pouvait dire d'où tomba le projectile! En tout semblable à celui qui a dévasté l'arsenal du Mont-Blanc, paraît-il. Et pas de ballons allemands dans la région! C'est incompréhensible!
— Mais Rapeau? Tom Davis? Les autres du Montgolfier?
Pigeon devint tout triste:
— Morts aussi, tous morts, sauf M. de Troarec, qui avait été détaché sur la Ville-de-Nantes, mandé d'urgence par le gouvernement pour venir ici, où je l'ai accompagné.
— Tous morts? Rapeau, Tom Davis, Ravignac...
— Tous! D'après les dépêches, car je n'étais pas à Francfort, puisque je faisais route pour Paris, ce serait encore le même coup qui venait de pulvériser le Santos-Dumont! Mêmes effets du projectile: traversée de l'enveloppe, rencontre du blindage au fond de la coque, explosion, avec émiettement des gens et des choses.
—Les dépêches sont aux mains des dactylotypographes, dit Malaval. Je vous les montrerai tout à l'heure. C'est épouvantable.
Pigeon me regardait avec une attention singulière. Les autres aussi. Je compris bien qu'ils ne comprenaient pas. Ils se demandaient d'où je sortais, par quel moyen de locomotion je me trouvais à Paris. Je calmai leur curiosité par une promesse.
— Je dois d'abord, dis-je, voir le grand patron, l'informer de ce que j'ai fait depuis quarante-huit heures. Vous allez l'aviser de mon arrivée...
— Monsieur le directeur est prévenu, monsieur... dit une voix derrière moi.
Je reconnus le garçon de bureau, qui réparait sa méprise par un geste d'excuse.
— Dès que je l'aurai vu, continuai-je, je vous dirai des choses auxquelles vous êtes loin de vous attendre, mes enfants, des choses énormes. Mais, vous comprendrez comme moi que j'en réserve la, primeur au grand chef.
La sonnerie du téléphone ponctua ma phrase. Justement c'était M. Martin du Bois qui, de son hôtel en fête, me faisait compliment d'avoir échappé à la mort et m'annonçait son arrivée avant une demi-heure aux bureaux du journal.
Pigeon restait silencieux. Que de pensées tristes nous étaient communes!
— J'ai ramené l'Austral, me dit-il. Comme nous passions par la Bourgogne, l'escale de Brochon s'indiquait. Morel y attendait vos ordres. Je lui ai démontré, avec l'appui de M. de Troarec qu'il était de son devoir de revenir ici sans différer plus longtemps, pour plusieurs raisons dont la première dispensait de toutes les autres puisque vous aviez disparu.
— On m'a donc vu disparaître? Rien en ce cas ne démontrait que je fusse mort.
— Rapeau et Tom Davis ont bien vu la tortue noire fondre sur vous et vous jeter à terre; ils vous ont cherché ensuite dans la nuit, sous les averses que vous entendez encore tomber de là-haut, comme moi... Mais rien, personne! Des battues ont été répétées jusqu'à neuf heures du soir. Le brave bourgmestre d'Augsbourg a fait fouiller toute la ville par sa police. Finalement il fallait repartir. On a repris l'air à neuf heures et demie, vous imaginez dans quelles dispositions d'esprit. Pour comble de malheur, le gouvernement informé de ce qui se passait par la Sans-Fil, revenu à de meilleurs sentiments, ordonnait à Rapeau de lui envoyer son chef d'état-major général. Il veut des explications verbales sur pas mal de points: «Comment n'avions-nous pas découvert la flotte allemande? Comment n'est-elle signalée nulle part? Qu'est-ce que ce Corsaire Noir dont le monde entier parle depuis quarante-huit heures et qui semble doué d'une inquiétante ubiquité, car on le signale dans maints endroits à la même heure?..:»
— Alors vous avez apporté au gouvernement ce que vous savez?
— C'est-à-dire pas grand'chose. M. de Troarec est ce soir même chez le président de la République, où le Ministère tout entier s'est réuni pour entendre ses explications. L'opinion est très montée ici. Si je vous disais comment y fut accueillie ce matin la fin de Rapeau! Il est mort celui-là? Ce n'est pas une grande perte! On n'aura pas de mal à le remplacer! Quel cornichon! Voilà trois jours qu'il cherche la flotte allemande sans la trouver. Et nous avons dépensé un milliard pour en arriver là!
— C'est ainsi qu'on traite l'homme qui à constitué la force nouvelle que vous savez, Pigeon, l'homme admirable que nous avons vu à l'oeuvre, l'homme qui depuis dix ans...
— Ça, mon cher patron, c'est souvent le lot des hommes qui se sacrifient pour leur pays. C'est l'ingratitude des masses.
— Alors que le jour même de sa mort, son régiment des voleurs détermine une inoubliable victoire!
— C'est vrai.
— Il fallait voir ça de là-haut! Quel spectacle!
— Vous y étiez donc?
— Toute la journée!
— D'aujourd'hui? Mais la bataille durait depuis quarante-huit heures.
— Je vous expliquerai cela plus tard. Patientez! Finalement quels sont-ils, les résultats de cette bataille?
— Notre frontière dégagée pour quelques jours; soixante-douze mille hommes environ tués ou blessés dans l'ensemble.
— Soixante-douze mille!
— Et vous avez vu comment, puisque vous étiez là-haut! Ni fumée, ni flamme, ni bruit d'aucune sorte.
Joubin, d'une voix mélancolique, confirma:

Du ballon des télégraphistes, nous n'entendions que les
cris de douleur des mourants et des blessés. (Page 131).
— J'arrive de Mézières en automobile. J'étais dans un ballon captif des télégraphistes. Pendant l'action nous n'entendions que les cris de douleur des mourants et des blessés, des jurons, des plaintes épouvantables, mais tout cela dans un silence relatif, puisque ni chevaux, ni piaffements, ni détonations d'aucune arme à présent. C'est infernal! On voit les hommes tirer, l'arme à la cuisse, puis tout à coup lâcher leur fusil et tomber. Ils sont morts, ou près de mourir, sans avoir lutté, sans avoir agi. Ce spectacle multiplié par mille, dix mille, cent mille, toujours silencieux, comme sur un échiquier, avec la ponctuation des moteurs de l'artillerie et des ambulances qui ronflent aux alentours, fait froid dans le dos, je le crois volontiers, plus que le fracas des poudres au temps jadis. Le bruit devait être atroce, mais il grisait aussi les combattants. Aujourd'hui, ce n'est plus du combat, c'est une espèce de tuerie mécanique à distance.
— Et comment s'appellera cette première victoire?
— Comment voulez-vous qu'on l'appelle? Les forces des deux nations, éparpillées à l'infini, d'après la tactique adoptée depuis le commencement du siècle, occupaient cent kilomètres. C'est qu'il y en a des villes, et des villages, et des hameaux sur cent kilomètres! En progrès ici, en recul par là, Allemands et Français eussent été fort capables de se décimer ainsi pendant un mois, sans les aviateurs. Nous appelons déjà ce succès la victoire N° 1, du 23 septembre. C'est le plus simple et je crois que l'état-major s'y tiendra.
Au même instant, les ascenseurs déposaient trois personnes dans le vestibule.
Le garçon courait, déférent, demander aux nouveaux venus ce qui les amenait. Mais Pigeon n'eut pas besoin d'explications. Sous d'épais vêtements de deuil il avait vite reconnu Miss Ada Vandercuyp, son oncle et sa tante, M. et Mme Wouters.:
Miss Ada! Moi aussi je la reconnaissais à présent.
Malheureuse fiancée!
Tous les cinq nous nous empressâmes auprès des pauvres gens. La jeune fille pleurait, et depuis longtemps, car ses yeux étaient gonflés et bien rouges.

Mort! répétait Miss Ada. Il est mort, les dépêches l'affirment.
— Mort! me dit-elle en tendant vers moi les mains. Mort! Il est mort, affirment les dépêches qu'on a publiées ce soir. Et c'est au milieu d'une fête qui met tout Paris en joie qu'il m'a fallu apprendre une pareille catastrophe! En votre absence je venais demander à ces messieurs si l'affreuse nouvelle ne serait pas inexacte, si quelque lueur d'espoir ne subsisterait pas.
— Hélas, mademoiselle, dit Pigeon, d'une voix dont le timbre affectueux me frappa, je crois qu'il faut renoncer à tout espoir. Le lieutenant Tom Davis a été tué ce matin, au milieu des nôtres, avec les nôtres, par la main d'un inconnu. Qui connaîtra jamais ce misérable? Un anonyme vulgaire, mort déjà lui-même, peut-être...
— Oh! messieurs, s'écria la jeune fille dans un accès de farouche énergie, laissez-moi espérer qu'un jour on le connaîtra! Dussé-je y périr, moi aussi, je veux savoir qui m'a tué mon Tommy. A celui-là je veux rendre oeil pour oeil, dent pour dent. La vie ne saurait plus être pour moi qu'une piste de vengeance. Je suis riche, je suis brave. Je suis citoyenne d'un pays neutre que les Allemands ont déjà dévasté, au mépris des conventions internationales. Je me ferai justice moi-même. Mais laissez-moi espérer encore!
Comme en s'exaltant Miss Ada me regardait avec une fixité persistante, il me sembla que Pigeon me dévisageait de même.
L'émotion du retour, la joie, m'avaient fait oublier le crime commis là-haut. Mais la conscience de mon acte indigne me revenait vite.
Alors, je chancelai, la tête perdue, devant cette jeune fille dont j'avais consommé le malheur, Tandis que Pigeon me soutenait dans ses bras, Miss Ada me prenait la main droite de ses doigts gantés de noir, pour me retenir, car j'allais tomber.
— Non, lui dis-je en retirant ma main d'un geste brusque, que ses parents attribuèrent, je l'espérai du moins, à la délicatesse, non, mademoiselle. Merci! Je souffre cruellement de la main droite. Je me suis blessé en tombant d'aérocar, ce matin. Vous avez raison de vous dévouer à la recherche de ce misérable. Je vous y aiderai, mademoiselle, je vous aiderai.
Une seconde de plus et j'allais divaguer.
Un groom vint, heureusement, m'annoncer que M. Martin du Bois m'attendait dans son cabinet.
Je laissai les Hollandais éplorés aux soins de Pigeon, et, mal remis de ce premier assaut qui m'en présageait d'autres, combien d'autres, je descendis chez le grand patron, d'un pas mal assuré.
M. Martin du Bois, petit, replet, entièrement rasé, ressemble à Napoléon Ier, à César, à François Coppée, à Victorien Sardou, à quiconque reçoit de la nature cette «tête de médaille» caractéristique, que vous rencontrerez assez souvent en France. Elle force seulement votre attention lorsqu'elle est plantée sur les épaules d'un homme exceptionnel.
M. Martin du Bois l'est, exceptionnel, par la grosse fortune qu'il a réalisée dans la compression des denrées alimentaires.
C'est sa maison de commerce, Martin du Bois et Cie, qui la première avait lancé, dans le monde, quinze ans plus tôt, ces délicieuses tablettes de gibier, de poisson, de volaille, de mouton, de veau, de boeuf, qui nous font gagner un temps si précieux aujourd'hui en supprimant les formalités ridicules du déjeuner.
Pendant des siècles on a perdu là deux grandes heures chaque jour.
A quoi bon?
Avec les comprimés Martin, comme le publie appelle économiquement la chose, on ne quitte plus le travail lorsque sonne midi. Boutiquiers, commis, employés aux écritures, artisans même du plein air, de l'usine, des forges, s'arrêtent tout bonnement dix minutes, absorbent leur petite dose nutritive, s'assimilent un doigt de bon vin en suçant une pastille, comme les monte-en-l'air. Et voilà l'épineuse question des heures de labeur résolue!
La journée est réduite à huit heures effectives, de 9 heures du matin à 5 heures du soir. On gagne plus qu'autrefois; on peine moins; on est plus sobre; on est plus tôt libre de regagner son home; la vie est meilleure.
Les millions que M. Martin du Bois a gagnés dans cette épicerie d'un nouveau genre (que l'Etat s'est empressé de copier pour nourrir nos armées) il les a jetés avec une belle audace dans l'exploitation de l'An 2000. qu'il fondait en un moment d'enthousiasme, voilà sept ou huit ans.
Certes, ce titre marque un futur lointain dont l'échéance viendra encore trop tôt, hélas! Mais pour M. Martin du Bois il semble toujours que ce soit demain.
Ses collaborateurs, il les a stylés à son image. Il veut qu'ils aient les yeux fixés sur ce tournant à venir dont quelques lustres à peine séparent l'humanité.
Tout dans son journal doit s'inspirer de la devise anglo-américaine: go ahead! Toujours de l'avant! Aussi n'a-t-il connu que des succès de toute sorte. Succès d'argent, succès d'influence. Il est multi-millionnaire, et la chancellerie n'a pas enregistré à son actif moins de quatre-vingt-dix-huit décorations. On peut dire qu'il les a toutes.
Connu et justement estimé du monde entier pour sa belle confiance dans la presse dont il sait toute la force, le directeur de l'An 2000 est autrement puissant qu'un ministre, que deux, que trois ministres. Peut-être est-il plus puissant que le conseil des ministres tout entier?
Il a derrière lui six millions d'acheteurs, qui disent amen à toutes ses idées, à toutes les campagnes qu'il lui plaît d'entreprendre pour le bien du pays et pour celui de son journal.
Aussi les gouvernants le redoutent. Non qu'il les ait jamais menacés: c'est un doux et un silencieux. Mais eux savent que, s'il le voulait demain, lui, pour peu que la cause fût juste, soulèverait le peuple de Paris, tout au moins ure grande quantité de peuple, contre un gouvernement que l'An 2000 désignerait à sa fureur.
C'est pourquoi des compères malins — sont-ils vraiment si malins? — qui subissent avec ennui la domination muette de l'An 2000 au sein du Parlement, se sont réunis, des gros sacs d'écus à la main, et ont élevé, voilà quelques années déjà, autel contre autel.
En France, il est impossible qu'un homme ait une idée neuve et la mette en valeur sans que subito sorte de terre un copiste qui s'installe en face de lui pour lui faire concurrence.
Edifieriez-vous un café de grand luxe, avec quarante billards, au plus profond d'un bois que, le succès venant, si par improbable il venait, vous verriez bientôt un concurrent inévitable prendre position dans les fourrés d'en face.
C'est ainsi que jamais, en France, une entreprise originale ne dominera les autres.
Elle aura toujours une rivale, copiste impudente qui sortira du néant, sans grands frais d'imagination, dès qu'elle aura la certitude du succès garanti par le succès des autres.
On avait donc suscité à M. Martin du Bois une concurrence assez piquante.
A son An 2000, le groupe de ses adversaires avait opposé l'An 3000.
C'était plus fort.
Puisque notre siècle touchera bientôt à l'an 2000, disaient-ils, puisqu'il faudra sur tous les imprimés s'habituer pour mille ans à mettre un 2 au lieu d'un 1, quand le journal de Martin du Bois arrivera au seuil du prochain siècle, son titre sera périmé.
Il ne sera plus go ahead, mais go backwards, en arrière!
Qui osera parler de l'an 2000, quand nous serons en 2001? Ce sera vieillot, coco, rococo. Nous autres, au contraire, nous aurons devant nous un nouvel astre pour guider notre marche et celle de nos enfants vers le progrès inlassable: L'An 3000! Tête de Martin du Bois!
Il y avait du vrai dans ce raisonnement. C'est bien ce qui atténuait la félicité de notre directeur.
Quand on le voyait soucieux, c'est que sa police particulière lui avait appris de mauvaises nouvelles: l'An 3000 avait monté d'un million en quinze jours; l'An 3000 avait acheté de nouveaux immeubles ou lancé quelque canard sensationnel auquel le public benoît faisait crédit.
Sans la concurrence, M. Martin du Bois eût été l'homme le plus charmant de la terre: bon époux d'une ravissante Provençale, bon père, adoré de quatre enfants.
Sous la préoccupation de la concurrence, il n'était pas à prendre, par moments, avec des pincettes.
Si j'ai insisté sur ce qui précède, c'est pour que le lecteur comprenne bien le déplaisir que j'éprouvai en n'apercevant, dès la porte d'entrée du cabinet directorial, que je tombais en plein dans un de ces moments-là.
Napoléon — nous donnions en petit comité ce sobriquet au grand patron; il le savait et n'y contredisait pas — se tenait debout devant son bureau-ministre, le dos à une superbe verrière au travers de laquelle je voyais flamboyer les illuminations du boulevard.
Je m'avançai d'un pas ennuyé.
La main cordialement tendue, sans me demander ni se demander si je n'avais pas d'extraordinaires choses à lui confier — et c'était le cas — M. Martin du Bois me fit part de la gravité de la situation. Il avait peut-être raison de commencer par là.
— Mon cher ami, dit-il avec une pointe d'émotion, Ça ne va pas ici, pas du tout. Où est la flotte allemande? Le savez-vous?
— Ma foi non, monsieur.
— Je m'en doutais.
— Comment le saurais-je, alors que Rapeau lui-même, avec qui j'ai passé trois jours, en l'air ou à terre...
— Ne parlons plus de Rapeau. Il est mort. Paix à sa mémoire! Mais pour un peu, la nation l'accuserait de nous avoir trahis.
— Déjà!
— Oui. Vous savez, comme moi, que c'est un travers de nos Français. Ils voient des traîtres partout. Il faut les prendre comme ils sont, et pour cause.
— Eh bien?
— Eh bien, je dois vous apprendre, à vous qui tombez de la lune...
— Vous pouvez le dire, monsieur...
— Ce qu'on pense et ce qu'on dit ici-bas depuis vingt-quatre heures, avant de vous écouter. Vous saisirez mieux ainsi quelles sont nos angoisses, ce que nous espérions de cette flotte aérienne, mystérieusement constituée au Mont-Blanc, mobilisée à grand orchestre pour la première fois, et ce qu'elle ne nous donne pas...
J'esquissai un geste de protestation si large que M. Martin du Bois rectifia:
— ...Du moins jusqu'à présent. Or, les heures s'écoulent. On ne vit plus aujourd'hui comme autrefois, avec des mois et des années devant soi pour entreprendre une guerre dont la fin resterait à la charge des générations suivantes. Une guerre, au cours de notre vingtième siècle, ne peut pas excéder un mois. Celle-ci coûte un milliard par semaine à chaque belligérant. Qu'elle se prolonge seulement, trois mois et c'est la ruine de l'Angleterre, de l'Allemagne, des Etats-Unis, du Japon; c'est la nôtre, pour trente, quarante années.
— Mais, monsieur, risquai-je, je n'y peux rien... Ou plutôt, si! Si! J'y peux beaucoup, comme vous le comprendrez dès que vous m'aurez entendu!
Napoléon s'arrêta un instant pour me regarder de travers, comme un homme dont on se méfie. Mais ce ne fut qu'un instant.
Alors ce qu'il m'apprit fut en vérité surprenant.
— Tenez, me dit-il en prenant sur son bureau-ministre le numéro du jour. Voici ce que nous avons publié ce matin, dans la forme concrète que le public affectionne, c'est-à-dire sans littérature, sec, sec, sec:
Londres, 22 septembre. — Le centième cuirassé de la flotte britannique a été lancé ce matin sur la Clyde, juste au moment où notre première escadre ouvrait le feu contre les ouvrages avancés de Kiel, dans la Baltique.
Londres, 22 septembre. — Un avantage considérable a été remporté hier au large de Douvres par notre 4e escadrille sous-marine. Trois sous-marins allemands ont été détruits, sous cinquante pieds d'eau. Nous avons perdu deux unités au complet, sur quatre, dans cette affaire.
Londres, 22 septembre. — L'Ouest, l'Est, et le Sud-Est du Royaume-Uni sont, d'après le Times, actuellement couverts par une flotte de 1.425 navires, tant de guerre que de commerce armés en guerre, qui croisent sans discontinuer. On estime à 500 au maximum le nombre des navires de même ordre que les Allemands ont pu réunir pour nous tenir tête. Ce n'est pas suffisant pour renouveler la tentative de Guillaume-le-Conquérant.
New-York, 22 septembre (par l'Espagne). — Les Anglais sont toujours les mêmes, dit le Sun, infatués de la puissance de leur flotte. Mais leur orgueil sera mis avant peu à une rude épreuve. L'Allemagne a préparé dans le plus grand mystère, nous pouvons l'affirmer, les éléments d'une descente en Angleterre qui ne sera pas effectuée par mer, celle-là... Contre 2.000 aérocars chargés de troupes prussiennes, l'invincible flotte britannique servira-t-elle à grand'chose? On démentira ce que nous venons d'annoncer; nous attendons patiemment que des faits très prochains justifient l'exactitude de nos informations.
New-York, 22 septembre (par l'Espagne). — Le Boston Herald confirme l'étrange nouvelle du Sun. D'après ce journal, le gouvernement allemand aurait réussi à entourer d'un mystère vraiment impénétrable ses préparatifs d'invasion de l'Angleterre par les airs.
J'écoutais avec un sourire incrédule. Pourtant j'étais inquiet.
M. Martin du Bois posa le journal et dit très vite, d'une voix sourde, irritée:
— Voilà ce que les journaux américains nous révèlent.
— N'est-ce pas un bluff pour jeter le trouble dans les esprits! risquai-je.
— Je voudrais l'espérer, mais je n'ose. Quelque chose me dit, monsieur, qu'il y a là-dessous une grosse vérité. Et je reflète l'opinion publique. En France c'est depuis hier un tollé général; car l'opinion, désormais, ne se préoccupe pour ainsi dire plus des opérations sur terre, sur la mer, sous la mer même, où vont se jouer pourtant de formidables parties. Elle regarde en l'air. Elle n'a plus d'yeux que pour le zénith; elle se dit sagement que pour la première fois depuis la formation du globe les forces aériennes de chaque puissance vont être dévoilées et entrer en ligne. Alors vous imaginez de quels yeux irrités elle lit d'aussi étranges nouvelles.
— L'An 2000 l'a pourtant rassurée dans un précédent numéro sur la valeur tactique de notre armée de l'air, à nous. Elle est formidable.
— Eh! voilà précisément ce qu'elle discute. Formidable, c'est tôt dit. Sans doute les cent cinquante aérocars de Rapeau lui ont été révélés par votre article d'avant-hier. Et ç'a été un cri de joie unanime. Nous avons tiré à douze millions d'exemplaires. Hier matin, nos presses gémissaient encore sur ce numéro sensationnel. Je vous félicite, entre parenthèses, de la tranquille audace avec laquelle vous avez réussi à pénétrer dans le secret de l'aérotactique, si jalousement gardé jusqu'ici. Vous trouverez à la caisse un bon de dix mille francs que j'ai signé à votre adresse, à titre de légitime gratification.
— Tous mes remerciements, monsieur!
— Mais... le public français n'a pas été longtemps satisfait. Trente dépêches venues de tous les points de l'Europe centrale lui ont répété c'est vrai: la flotte aérienne des Allemands n'est nulle part... Il en concluait trop vite qu'elle n'existe pas. Voilà qu'elle existe, à présent, et à quel effectif! Deux mille aérocars!
— Faisons la part de l'exagération américaine.
— Faisons-la. Prenons la moitié de ce chiffre fabuleux. Nous restons bien au-dessous de nos adversaires. Et l'Angleterre, qui n'a pas pu arriver, malgré ses immenses ressources, aussi parce qu'elle comptait sur nous, à constituer une force supérieure à cinquante navires de l'air, dont nos officiers ne disent pas beaucoup de bien, l'Angleterre, abusée comme nous-mêmes par des rapports d'espions insuffisants, prend peur comme nous prenons peur. Vous lirez ces autres télégrammes. Ils nous montrent la population de Londres affolée, comme celle de Paris...
J'indiquai du doigt le boulevard en fête.
— Oui, sans doute, on se réjouit ici de la grande victoire remportée sur terre ce matin. Mais demain? Demain vous verrez la terreur régner dans les rues, chaque passant regarder les nuages, s'attendant à les voir vomir du feu sur nos toits, alors qu'il croyait son pays supérieur à tous les autres, nanti d'un outil de guerre incomparable...
— Il l'est, monsieur, il l'est!
— Parbleu! Je sais bien qu'il vient de donner des preuves effroyables de son aptitude à la dévastation. Rapeau a brûlé Munich et Francfort, terrifié toute l'Allemagne centrale...
Une sonnerie vigoureuse interrompit M. Martin du Bois. Le téléphone à l'oreille, il écouta deux minutes, puis continua:
— Voilà encore un beau feu à son actif. On m'annonce de la rédaction que la flotte de Rapeau, sous le commandement d'un chef provisoire, à poursuivi le plan de l'aéramiral en réduisant en cendres, cette après-midi, le fameux trésor des charbons de Duisbourg.

Les entrepôts et les bateaux des trois cités charbonnières
allemandes étaient la proie des flammes. (Page 136).
Je tressaillis de joie.
— Vous connaissez Duisbourg, Rurhot et Hochield, ces trois cités réunies en une seule, au confluent de la Ruhr et du Rhin. C'est de là que toute l'Allemagne tire son charbon. Un million d'habitants, le plus grand port fluvial des deux mondes, vingt-cinq millions de tonnes par an. Tout est en flammes les villes, les entrepôts, les bateaux. C'est un cataclysme habilement déchaîné par nos monte-en-l'air. Mais vous verrez que l'opinion, demain matin, ne leur en tiendra guère compte.
— Que lui faut-il donc?
— Il lui faut... Il lui faudrait une bataille dans les nuages, la certitude que la flotte allemande de l'air n'existe pas ou n'existe plus. L'incertitude où les Américains la plongent, par tactique — c'est de bonne guerre — l'énerve et l'épouvante. Elle eût voulu que Rapeau découvrît les forces aériennes de nos adversaires, qu'il leur offrît le combat et les détruisît, pour commencer. Après quoi le peuple tout entier se fût calmé, assagi; il eût attendu patiemment, ou presque, que nos généraux renouvelassent dans les Vosges le beau succès d'aujourd'hui. Mais Rapeau n'a rien vu, rien trouvé, rien dépisté. Or il semble acquis à présent qu'une flotte allemande redoutable se concentre quelque part, dans le Nord, protégée par des forces terriennes, maritimes et sous-marines, pour fondre, de là, soudainement sur l'Angleterre, trop confiante dans son isolement naturel, oublieuse des leçons de l'histoire. Car enfin l'histoire se recommence. Ce que les Allemands semblent préparer patiemment, tout en laissant brûler leurs villes ouvertes, c'est la répétition de l'expédition des Normands, exécutée avec d'autres moyens, onze cents ans plus tard, par des Prussiens.

Comme Napoléon, M. Martin du Bois marchait, les mains derrière
le dos. «Les Normands de demain, disait-il, seront les Prussiens.»
Napoléon marchait, les mains derrière le dos, les yeux sur une carte du monde, planisphère, accrochée au mur.
— Oui, les Normands de demain seront les Prussiens, et leurs barques des aérocars dirigeables, montés par d'intrépides fantassins, qui débarqueront là-bas et mettront la main sur un pays dont les milices sont insuffisantes. Votre collaborateur Pigeon me donnait tantôt son avis. Je l'ai trouvé précieux.
— C'est un esprit distingué, qui s'assimile à merveille toutes les questions.
— La guerre qui commence, me disait-il, est la première de ce genre. On va voir comment chaque nation a compris emploi qu'il convient de faire de l'arme fameuse qu'est devenu le ballon dirigeable. J'ai idée, sachant ce que je sais depuis trois jours, que la France la spécialisera dans l'incendie offensif, puisqu'il est encore trop tôt pour parler d'une artillerie de l'air. L'Angleterre bornera le rôle de ses aérocars à la défense de ses côtes. Si l'Allemagne a vraiment une flotte aérienne, elle en fera plutôt un instrument de transport pour débarquer des troupes, occuper des villes par coup de main, s'y fortifier et rendre ainsi inutiles les quinze cents navires anglais qui se promènent un peu partout.
— Je me rallie, monsieur, à cet ingénieux aperçu, et je vous demande à mon tour de le compléter.
— Dites.
— De ces trois procédés celui de la France est le plus près de la vérité. La bombe incendiaire, c'est une manière de pièce d'artillerie. Elle permet d'espérer l'obus, pour plus tard, dit-on. Que penseriez-vous si le quatrième moyen de vaincre, celui que vous rêvez, celui que souhaite l'opinion publique, ignorante du labeur qu'il faut accumuler pour arriver à la solution vraie d'un tel problème, que diriez-vous s'il était trouvé, le quatrième moyen, si l'on vous apportait ici même le définitif aérocar de guerre, celui qui enlève à son bord un canon et qui le tire à toutes les hauteurs sans difficulté, dix fois plus terrible, sous un volume dix fois moindre, que les géants construits, avec toute la sincérité de son patriotisme, par le regretté Rapeau?
— Je dirais que nous tenons le bon bout.
— Eh bien cet engin prestigieux, jugé encore impratique par les compétences, il existe, monsieur. Je l'ai sur moi, si j'ose m'exprimer ainsi par une image dont vous allez juger toute la valeur. Et je l'apporte à la France.
— Vous?
— Moi.
M. Martin du Bois me lança de nouveau son regard défiant, puis, fébrile, m'indiquant un siège à côté du sien:
— Asseyez-vous donc là, dit-il, et m'expliquez cette parabole.
— Ce n'est pas une parabole, c'est un fait positif.
Alors pendant une grande heure, je fis à mon tout-puissant directeur le récit de ce qui m'était arrivé depuis mon départ du Mont-Blanc.
J'énumérai les qualités des engins de Rapeau, mais je m'étendis aussi sur leurs désavantages.
J'évoquai la nuit et la journée tragiques que j'avais vécues à bord du Sirius, la personnalité démoniaque de Jim Keog, la promesse que j'avais faite à l'Américain de m'entremettre pour assurer à la France la propriété de son invention, si manifestement supérieure à tout ce que nous possédions, et vraisemblablement à tout ce que l'on possédait ailleurs.
Sans reprendre haleine, sans me troubler, avec une méthode et une clarté d'exposition qui ne me surprirent qu'à moitié, parce que je me sentais animé du plus pur souffle patriotique, je parlai, je parlai... J'omis toutefois de dire comment le fatal coup de canon était parti.
Napoléon m'écouta d'un bout à l'autre de ma petite conférence, la jambe gauche repliée sur la jambe droite, le coude appuyé sur le bras de son fauteuil, un coupe-papier dans la main, pour occuper ses doigts agités par une surprise sans cesse grandissante.
Je devinais, à ses yeux inquisiteurs, qu'il ne perdait pas un mot de mon récit. On eût dit qu'il livrait, dans son for intérieur, un combat douloureux à quelque adversaire invisible.
Quand j'eus fini, M. Martin du Bois resta silencieux deux bonnes minutes.
Puis il se leva, me prit la main droite, que j'eus grand'peine à ne pas retirer, car je venais de revivre une grande heure mon crime involontaire et le remords me montait au cerveau.
— Mon ami, me dit-il d'une voix étranglée par l'émotion, dites-moi que vous n'êtes pas fou.
J'eus un haut-le-corps. Mais aussitôt je pensai que cette invitation blessante me serait plus d'une fois adressée.
— Non, monsieur, répondis-je froidement. J'ai tout mon bon sens. Je reviens de là-haut avec une résolution dont vous avez saisi toute l'importance. Seul, je ne pourrais pas grand'chose. Mais j'ai compté sur votre aide. Pour que je sauve le pays en tenant ma promesse, il me suffira de votre incomparable appui.
Napoléon réfléchit quelques secondes,puis s'écria:
— Vous l'avez! Je ne me dissimule pas que la partie est difficile. Nous aurons contre nous la Jalousie, la Routine, l'Incapacité, mais la cause est belle. L'An 2000 peut monter de deux millions d'exemplaires avec une campagne faite là-dessus sans délai.
— Il faut que dans sept jours...
— Compris! Je prends l'affaire en mains.
Je rayonnais. Pendant quelques minutes j'oubliai les avanies dont m'avait abreuvé ce Keog, le sang qu'il avait inutilement répandu, j'étais tout à la joie d'un triomphe dès à présent escompté. La France allait lui acheter son affaire, à ce misérable de génie. Elle allait mettre ainsi le plus précieux des atouts dans son jeu.
Ne fût-ce que pour empêcher les autres de se l'approprier, M. Martin du Bois jouait là comme un maître et comme un grand patriote.
— Merci, lui dis-je en serrant avec effusion ses deux mains, merci.
— A présent, surmontez quelques heures encore la fatigue qui vous accable visiblement, car vous êtes tout pâle, vous avez les yeux tirés. On serait abattu à moins. Montez à la rédaction pour y faire l'article dans lequel vous raconterez en détail au public tout ce que vous venez de me dire. C'est par là qu'il faut commencer. Nous voulons le bien de la France: mettons la France avec nous!
— Il est dix heures? Il me faudra bien deux grandes heures pour dicter tout ce que j'ai là.
— Il n'importe, on attendra pour tirer s'il le faut. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Combien ferez-vous de colonnes?
— Cinq ou six.
— C'est bien. Vous n'avez pas pris de photographies?
— Hélas! Mon appareil était resté à bord du Montgolfier. Quand même, je crois que l'inventeur ne m'eût pas permis...
— C'est juste. Je vais vous envoyer le dessinateur en chef; vous lui ferez des croquis d'après lesquels il reconstituera la Tortue Noire, la silhouette de Jim Keog, et les principaux épisodes de votre aventure. Les photographes reprendront tout cela, et nous aurons demain un numéro illustré qui battra tous les records. Pendant ce temps-là je vais m'informer de ce qui s'est passé au Conseil des Ministres. J'inviterai M. de Troarec à conférer avec vous, ici même, après minuit. Et demain je serai à l'Elysée pour demander en votre nom une audience au Président de la République.
J'eus vite fait de remonter à la rédaction et d'appeler deux dactylotypographes.
Ayant installé des fils et leurs machines dans mon cabinet, ceux-ci coulèrent directement à l'imprimerie, sous ma dictée, les lignes de plomb qu'on aligna bientôt sur la table du «marbre», par mètres entiers.

Deux dactylotypographes composaient sous ma dictée pendant
qu'un dessinateur reproduisait le Corsaire Noir suivant mes croquis.
Pigeon était entré sur l'entrefaite, en compagnie du dessinateur et du photographe.
Ces derniers me parurent ahuris par mon histoire et parfaitement incrédules. Mais mon collaborateur les fixa d'un mot. Il avait vu, lui, le ballon noir par deux fois. Il avait presque assisté à mon enlèvement.
Quand le texte fut achevé, je pris un crayon et fis de mon mieux une douzaine de croquis.
Mon devoir professionnel était rempli. J'eusse plongé avec joie dans de bons draps blancs, et la hâte de retrouver ma famille, que Pigeon avait vite informée de mon aventure, m'incitait à une retraite prudente. J'avais tant besoin de refaire des forces pour les jours suivants!
Mais il me fallait revoir mon directeur, me mettre au courant des derniers télégrammes, et attendre M. de Troarec.
Comme je pensais à lui, on l'annonça au premier étage. M. Martin du Bois me fit appeler aussitôt.
Le commandant en second du Montgolfier m'avait paru jusqu'alors un peu triste, rêveur, avec deux grands yeux bleus que le sourire n'éclairait pas souvent. Je le trouvai presque épanoui. Sa joie de me revoir fut sincère. Mais je compris bientôt qu'elle avait un autre motif.
Après avoir félicité mon directeur, comme la courtoisie l'y conviait, sur les talents de ses collaborateurs, le commandant nous dit qu'il avait, non sans peine, justifié son chef défunt des accusations que la foule abusée portait contre lui.
Le président du Conseil venait de le complimenter. Finalement, il le chargeait d'un ordre du jour chaleureux pour l'armée aérienne.
Puis il l'avait conduit chez le Président de la République lequel avait, séance tenante, signé un décret par lequel le commandant Alain de Troarec, chef d'état-major général de l'armée aérienne, était promu aéramiral et nommé au commandement des nouvelles forces de la République, en remplacement de Rapeau.
Toutefois pour donner une satisfaction à l'opinion publique, on ne lui avait pas confié le portefeuille de l'aérotactique. L'intérim en serait fait jusqu'à nouvel ordre par le ministre de l'Agriculture.
Tous trois nous eûmes, à ce mot, un même sourire, pour mieux dire, la même grimace.
Je dus refaire une troisième fois le récit de mon odyssée, en l'écourtant. Le nouvel aéramiral l'entendit avec un vif intérêt.
— Il est avec nous, pensai-je.
Mais contre mon attente, M. de Troarec se montra de glace quand je parlai de faire acheter par la France l'invention de Jim Keog.
Je compris à la façon dont il parla de la Tortue Noire que sa conviction n'était pas faite par mon récit.
Avec toutes sortes de circonlocutions polies, il me démontra que j'avais été joué par un farceur, que rien au monde, pour le moment, n'était supérieur aux aérocars de guerre que nous possédions; que l'heure des constructions, à tout prendre, était passée; que nous étions arrivés, depuis quatre jours, à celle des combats, et que ce qu'il avait dans la main défiait tout ce que les autres puissances pouvaient mettre en ligne.
Au surplus il était renseigné; il savait de première main et il l'avait dit au Conseil des Ministres, que l'Allemagne ne cherchait pas à nous rencontrer dans l'air parce qu'elle n'était pas prête, à telles enseignes qu'il avait télégraphié au commandant intérimaire de faire prendre un repos de vingt-quatre heures à tous les équipages, à terre, au confluent de la Ruhr et du Rhin, dévasté de main de maître dans la journée...
Je compris que cet officier général suivait aveuglément le sillage de son prédécesseur.
Le souvenir d'une autre tortue me vint à l'esprit. Je revis la Phalange macédonienne, une et indissoluble, que forment chez nous les aînés et cadets des grandes écoles. Celle de Chamonix ne déparait pas la collection.
A tout ce qu'un «cher camarade» avait conçu, combiné, arrêté, il fallait dire: amen. Et on le disait.
Il m'apparut — heureusement — que M. Martin du Bois goûtait peu cet esprit de routine.
Napoléon eut deux ou trois mots assez mordants sur les doctrines des chapelles; puis après quelques phrases de banale politesse, on se sépara.
— Et d'un, me dit le patron quand l'aéramiral fut parti. Ce ne sera pas le dernier adversaire que nous rencontrerons sur notre route. Mais je veux perdre mon nom, mon cher ami, si l'oeuvre à laquelle nous nous dévouons dès ce soir n'a pas abouti dans sept jours au succès.
Dans l'instant un brouhaha prolongé remua le boulevard.
M. Martin du Bois ouvrit la verrière. Par la grande baie qu'elle dégageait nous aperçûmes des milliers de badauds, le nez en l'air, la face incendiée par les reflets d'annonces lumineuses qui au-dessus de nous annonçaient quelque nouveau fait de guerre aux Parisiens. Le télégraphe et le téléphone ne cessaient d'en apporter dans les bureaux du journal.
— Regardez maintenant là-bas, me dit le patron, au delà des vitrages, en plein ciel, vers l'Opéra. Voyez-vous?...
Alors sur les nuages qui couraient, sombres et rapides, je vis projeter des images énormes, de toutes les couleurs, mais surtout des aérocars.
Puis de suggestives réclames allèrent les rejoindre.
DEMAIN MATIN
LISEZ TOUS DANS L'AN 2000
LES INCROYABLES RÉVÉLATIONS
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL.
A 4000 MÈTRES AVEC UN BANDIT GÉNIAL!
LA MAÎTRISE DE L'AIR EST A NOUS!
IL S'AGIT DE VOULOIR ET D'Y METTRE LE PRIX.
UNE OPTION DE SEPT JOURS
DANS LA POCHE DE NOTRE RÉDACTEUR.
NOUS DEMANDONS QU'ON RÉALISE LE MARCHÉ.
VINGT MILLIONS Y SUFFIRONT.
EN AVANT POUR LA PATRIE!
VIVE LA FRANCE!
Tout Paris, de ses carrefours, lisait et commentait.
J'avais hâte d'être au lendemain, aussi m'empressai-je de prendre congé de chacun et de regagner à pied, au milieu des promeneurs loquaces, mon appartement de la rue Saint Florentin, où je soupai en famille, après les premiers embrassements. Habitués à mes ordinaires voyages à travers le monde, les miens avaient tremblé en me sachant parti pour celui-là. Lorsque je les eus convaincus qu'il ne pourrait jamais être dépassé en originalité par aucun autre, ils consentirent à me faire grâce d'un quatrième récit, mais décidèrent de ne pas se coucher avant l'apparition de l'An 2000. C'était une affaire de quelques heures à peine.
Moi qui n'avais pas les mêmes raisons pour attendre le jour, moi qui n'avais pas dormi dans un lit depuis La Haye, je leur souhaitai la bonne nuit avec le ferme espoir de faire la grasse matinée.
En dépit de cette résolution, j'étais levé au petit jour. Quelques heures avaient suffi pour rendre un peu de calme à mes nerfs; mais je n'oubliais pas quelle tâche énorme j'avais assumée.
Je trouvai ma camériste abîmée dans la lecture du journal, encore humide des baisers de la presse, comme disait le poète. Elle m'exprima toute son admiration pour le récit qui s'y étalait, dans six colonnes de la première page.
Les illustrations la faisaient frémir, et espérer, car elle était patriote avant tout.
— Bien sûr, me dit-elle, que la France achètera son invention à cet Américain! C'est un sale type, mais il est bien fort! Il faut que le gouvernement le mette avec nous.
Cette première approbation me plut. Elle me donnait sans délai la note populaire.
Victorine — c'était le nom de ma fidèle servante — m'apprit en apportant le café au lait que toute la famille avait lu, depuis le commencement jusqu'à la fin, mes incroyables révélations avant de s'aller coucher. On m'avait laissé reposer dans ma chambre, isolée tout au fond de l'appartement.
Je laissai, à mon tour, chacun dormir tranquille et descendis dans la rue, la canne à la main.
J'avais une démangeaison folle dans les jambes: le besoin de marcher.
Après quatre jours de translation aérienne en distance et en hauteur, il me fallait mettre pendant quelques quarts d'heure un pied devant l'autre, l'appuyer sur le sol, bien me convaincre de cette vérité que je n'étais plus emporté par le Sirius, le Montgolfier ou même l'Austral à travers les nuées.
Le temps était gris, mais sec, plutôt agréable. Je pris le chemin des écoliers pour me rendre aux bureaux du journal, où personne ne se trouvait encore, au surplus, à cette heure matinale.
Par la place de la Madeleine et la rue Royale je gagnerais les Champs-Elysées, l'avenue de la Grande-Armée.
Au travers des squares superbes, véritables oasis de verdure, que la Ville de Paris a ménagés sur l'emplacement des anciennes fortifications, je rejoindrais l'avenue de Villiers, les rue de Constantinople, de Londres et de la Chaussée d'Antin.
Cet exercice hygiénique me ferait du bien autant qu'un nouveau somme. Je m'élançai donc sur les trottoirs encore tout frais du lavage quotidien.
On ouvrait les devantures.
Les étalages des magasins de nouveautés artistement combinés suivant l'usage, m'attirèrent par de singuliers objets, auxquels les yeux n'étaient plus guère accoutumés, certes, en plein vingtième siècle.
C'étaient des plaques multiformes, brillantes, de larges panneaux nickelés ou bronzés, des casques, beaucoup de casques, de toutes les formes et de toutes les dimensions.
Je leur accordai d'abord un coup d'oeil distrait, sans comprendre. Mais bientôt j'eus compris, et demeurai tout surpris que la mode eût été ainsi transformée en quatre jours, sous l'influence d'une crainte de toutes les minutes, disons le vrai mot: de la peur.
Un monsieur d'un certain âge, l'air d'un savant, d'un professeur ou d'un avoué, s'avançait au-devant de moi dans la rue Royale.
Son costume n'avait rien d'anormal. Mais sur le dos, attaché aux épaules par des courroies, il portait une sorte de bouclier en métal très dur, qui lui descendait jusqu'aux talons. Il lisait son journal — et c'était l'An 2000 — tout en gagnant à petits pas un labeur quotidien. Mais toutes les dix secondes ses yeux abandonnaient le papier pour se diriger vers le ciel, où ils redoutaient, je le devinai bien, de voir apparaître quelque Corsaire Noir ou les deux mille aérocars de l'Allemagne, lancés dans les airs par ces fumistes d'Américains! Ce monsieur était prêt à se fourrer sous sa plaque de tôle à la première alerte, c'était clair.
Je ne pus m'empêcher de le trouver un peu ridicule.
Quelle fut ma stupéfaction lorsque je vis venir derrière lui, rejoignant leur atelier de couturières ou de modistes, trois gentilles midinettes, coiffées chacune d'un casque protecteur.

Quelle fut ma stupéfaction lorsque je vis toute la collection
des couvre-chefs antiques circuler dans nos rues modernes!
Oui, d'un casque, comme les Walkyries de Richard Wagner, dont la crâne silhouette les avait évidemment séduites!
Mais ce fut bien autre chose: pas une femme, ouvrière allant à son ouvrage, bourgeoise se rendant aux provisions qui n'eût la tête ainsi protégée! Casques ronds, pointus, italo-grecs, assyriens, daces ou polonais; bourguignottes, salades, morions ou heaumes, toute la collection des couvre-chefs en métal se promenait dans la rue moderne.
Les hommes s'accoutraient à l'avenant. Sur les autobus on ne voyait que des casques et des boucliers de tous formats: égyptiens, assyriens, étrusques, romains; ceux-ci carrés, ceux-là en amande; écus ornés de bêtes fantastiques, plus spécialement de salamandres invulnérables.
Je devinai tout de suite que la souplesse imaginative des fabricants parisiens s'était donné libre carrière et tablait ferme sur l'émotion populaire. En quelques jours le blindage individuel était devenu un cri. Le dernier cri.
Il ne reste plus de chevaux dans les rues de la capitale depuis longtemps déjà; le moteur les a rendus à la tranquille existence des campagnes. Toutefois les gagne-petit du pavé parisien en possèdent encore quelques-uns par-ci par-là, qu'ils attellent à leurs voitures.
Chacun de ces animaux avait sur la tête une visière protectrice en métal, et sur le dos, la tôle d'acier en forme de couverture, assujettie par-dessus les harnais, comme au temps des tournois.
L'avouerai-je? Je fus tout d'abord pris d'une certaine pitié pour mes concitoyens à la vue d'un attirail qui m'apparaissait un peu enfantin.
Puis des idées plus saines me vinrent. Qui mieux que moi savait à cette heure les terribles effets que produirait un incendie déchaîné par la voie aérienne?
Je voyais encore Munich et Francfort flamber, et leurs habitants fuir sans raisonner le feu qui du ciel leur tombait sur la tête et les brûlait horriblement.
Qui mieux que moi eût renseigné ces passants effrayés, vaguement ignorants, sur les dommages que pouvait causer à leurs personnes une pluie de feu tombant de là-haut?
Ils se protégeaient de leur mieux; ils avaient raison.
Sur la place de la Concorde, je fus étonné de trouver un va-et-vient de voitures et de piétons, comme s'il eût été trois heures de l'après-midi. Tout à coup, trois ou quatre aérocars du service de la guerre apparurent dans les airs. Ils venaient du Mont-Valérien, où le grand parc aérostatique militaire fut transporté par Rapeau voilà sept ou huit ans déjà...
Je n'ose dire la crainte qui s'empara de tout ce monde.
Sans se demander si les ballons qui venaient sur Paris n'étaient pas d'honnêtes engins français, employés à quelque manoeuvre d'exploration au-dessus de la capitale, la foule n'eut qu'un geste, expressif, angoissé: les boucliers en l'air!
Je les vis tous s'élever du même coup. Les piétons, les gens en voitures, les hommes, les femmes se blottirent dessous, incontinent.
Ceux qui n'avaient rien pour se protéger contre une chute de feu possible se jetèrent sous les portes cochères, comme lorsqu'il tombe une grosse averse.
D'aucuns ouvrirent leurs parabellums, de larges ombrelles en métal que je n'avais pas autrement remarquées.
En un clin d'oeil cette foule qui zébrait en tous sens la place de la Concorde fut à l'abri, ou crut s'y mettre, sous une infinité de petits toits en acier, en bronze, en tôle de fer.
C'était risible au premier coup d'oeil. Mais, je le répète, à la réflexion rien ne me parut plus logique.
Contre un danger nouveau le commerce industrieux avait eu tôt fait d'imaginer des protections nouvelles. Et le public leur faisait un succès fou.
J'eus bientôt gagné le milieu de la place immense, sous la protection des agents au bâton blanc, bardés de fer et coiffés de l'armet de Mambrin. Ils se multipliaient pour faciliter le passage aux piétons et aussi aux députés qui se rendaient à pied à la Chambre pour la séance du matin. Quelques honorables portaient en sautoir leur petit bouclier.

Sous la protection d'agents bardés de
fer, les piétons circulaient librement.
Mais là mon étonnement grandit encore.
Les statues séculaires qui encadrent la place avaient disparu. Ou du moins il n'était plus possible de les voir. D'énormes baraques en tôle éprouvée les entouraient. Celle de la statue de Strasbourg était dorée aux angles. Un gardien de la paix m'expliqua que l'on avait travaillé nuit et jour à monter ces mannequins défensifs, faits de pièces et.de morceaux par centaines, que dans tout Paris on protégeait ainsi les oeuvres de l'art contre les surprises à venir d'en haut.
Les fontaines aussi disparaissaient sous deux cloches de bronze. Quant à l'obélisque, on achevait de lui confectionner une housse, une véritable housse en métal sous laquelle le monument égyptien pourrait sûrement braver toutes les fusées et torpilles aériennes. Aucune d'elles n'avait encore le pouvoir d'entamer l'acier, le bronze, ni le fer.

Pour braver sûrement les torpilles aériennes, les monuments
eux-mêmes disparaissaient sous de véritables housses de bronze.
Les masses ignoraient Jim Keog et ses obus.
Pauvre obélisque! Qui eût dit aux Pharaons, lorsqu'ils l'édifièrent là-bas, qu'on lui confectionnerait à Paris, quatre mille ans plus tard, un éteignoir pour le défendre contre la foudre artificielle, déchaînée par la sottise des hommes!
Le lecteur ne s'étonnera pas quand je lui aurai dit que sur dix passants, sept ou huit tenaient à la main l'An 2000 et faisaient un échange d'impressions très animées sur les révélations que contenait son dernier numéro.
J'en écoutai deux qui suivaient ma route vers la Seine.
— En voilà une affaire! disait l'un.
— C'est incroyable, faisait l'autre.
— Est-ce bien vrai?
— Oh! vous pouvez le dire. L'An 2000 ne bluffe jamais.
— Alors il faut que son rédacteur ait gain de cause!
— Et qu'on achète l'invention de l'Américain!
— Sûrement!
— C'est mon avis. Ce sera l'avis de toute la France dès qu'elle aura lu ça. Vous allez voir demain ce pétard si les Chambres ne veulent pas écouter Martin du Bois!
— Ce n'est pas le Parlement que je crains, moi, ce sont les bureaux.
— Ah! voilà! Les bureaux! Faudra voir tout de même. Il y a là un cas tellement urgent!....
Mes deux causeurs venaient de monter comme moi sur le trottoir du pont qui conduit au Palais-Bourbon.
Avec une centaine d'autres badauds, nous regardions sur la Seine. Au pied du pont, au coin du quai d'Orsay, une péniche à moteur venait d'être amarrée. Elle portait un chargement de pommes. Je demandai ce qu'il y avait là de si extraordinaire.
— C'est, me dirent mes voisins, que le gouverneur de Paris a défendu à toutes les péniches de remonter plus haut que Suresnes. On est surpris de voir celle-ci arriver en plein Paris sans accroc. La police a été prévenue. Elle la visite en ce moment.
— Ah! dit un garçon boucher en signalant trois hommes noirs et des soldats qui sortaient du ventre de l'embarcation, il faut croire qu'on n'a rien trouvé de suspect, car voilà ces messieurs qui s'en reviennent bredouille. Le patron en sera quitte pour une amende. Elles sont belles, ses pommes!
— C'est pour la buvette des députés, hasarda un loustic. On va leur faire avec ça du cidre mousseux en vue de l'été prochain. Parole... Ça fera pan!
A peine si ce garçon avait, d'un geste, scandé le mot qu'une explosion épouvantable se produisait, justement au Palais-Bourbon.
L'édifice parlementaire était brutalement soulevé sur sa base; les pierres, les colonnes, le toit, tout se disjoignait dans un terrible fracas, au milieu d'un nuage de poussière noirâtre.
Il n'y avait pas à s'y tromper: c'était un attentat; la Chambre des députés venait de sauter.
Fidèle à mon habitude, je consultai ma montre; il était 9 h. 24 minutes.
Il y eut un silence fait d'épouvante.
Instinctivement mes voisins s'étaient jetés à terre, sous leurs boucliers.
Puis ce furent des cris assourdissants, une ruée de la foule, par toutes les voies qui accèdent au Palais-Bourbon.
Je n'oubliai pas mon rôle d'informateur en chef. Encore que je fusse délégué pour le moment à des événements d'un autre ordre, je me précipitai dans le monument embrasé.
Le désordre des premières minutes y laissait entrer tout le monde. Je ne vis que des gens qui s'en éloignaient, tête baissée. Députés échappés à la chute du plafond vitré de la salle des séances, dans un formidable cliquetis, garçons de service, spectateurs des tribunes, rares en raison de l'heure matinale, tous fuyaient, atrocement livides, le lieu du sinistre.
Les gens criaient, sans trop savoir. Ils devinaient plutôt:
— Ce sont les anarchistes!
— Les antipatriotes!
— Les sans-patrie!
Il semblait bien que le coup vint de là.
Ainsi nous n'avions pas assez de la guerre avec l'étranger! Il fallait subir l'affront de cette misérable cohorte des sans-patrie! Toujours peu nombreux, mais toujours plus audacieux dans le crime!
Quelque chose me disait que la péniche suspecte jouait un rôle dans l'affaire.
Je ne me trompais pas.
En cinq minutes les automobiles des pompiers les plus voisins, la police, la troupe, les ambulanciers arrivaient. On dégageait le monument pour l'entourer de cordons rigoureux.
Il fut impossible, pendant un grand quart d'heure, de rien savoir de ce qui s'était passé exactement. Les pessimistes disaient que la plupart des députés étaient tués ou blessés. Mais combien étaient-ils en séance? J'appris bientôt, par le commissaire de police du quartier, ce qui s'était passé exactement.
La séance du matin venait de commencer. Par bonheur il n'y avait pas — c'est la coutume — plus de vingt-cinq députés dans la salle, sur près de six cents. Le vice-président qui occupait le fauteuil ayant fait voter sur une motion, celle-ci avait réuni quatre cent quatre-vingts suffrages contre soixante-seize, ce qui pouvait laisser croire à une hécatombe de législateurs.
Mais les initiés comprirent bien vite d'où venait l'erreur. Nos députés ont la manie de voter de loin, par procuration. Vingt-cinq honorables avaient pu émettre ainsi l'opinion de cinq cents et plus.
D'où la méprise.
Il demeurait acquis, pourtant, que douze malheureux représentants étaient tués et qu'une dizaine d'autres, dont le président et deux secrétaires, râlaient sous les décombres aussi, très grièvement blessés.
C'était affreux!
La secousse avait été si terrible que tous les murs s'étaient lézardés, puis désagrégés pour tomber avec le plafond lumineux, comme un château de cartes, dans l'intérieur de la salle.
Le sauvetage s'organisa vite.
Je regardai passer les civières sur lesquelles de courageux infirmiers emportaient les victimes, péniblement dégagées des débris fumants, car les court-circuits avaient déterminé l'immédiat incendie.
Dans un coin le Préfet de police, le président de la Chambre, vite accouru de son hôtel tout proche, les questeurs, se demandaient d'où pouvait venir le coup et s'égaraient sur la piste des révolutionnaires, antimilitaristes et autres suspects, lorsqu'une voix leur cria lentement, à cinq pas:
— Cherchez donc plutôt, messieurs, sous la péniche aux pommes!
Cette voix, c'était la mienne.
Le préfet m'avait reconnu. Il fit un geste de remerciements et partit aussitôt avec deux commissaires pour visiter à nouveau le bateau mystérieux.
Je l'eus bientôt rejoint. Il m'autorisa, d'un mot courtois, à l'accompagner dans son expédition.
Mes pressentiments ne me trompaient pas.
Le pénicheur, qu'on avait laissé libre tout à l'heure, avait disparu avec sa femme et ses enfants, authentiques ou embarqués pour les besoins de la cause.
On fouilla la cale. Un agent découvrit sans mal qu'elle avait un double fond.
A la faveur des interminables travaux du Métropolitain — on construisait alors la ligne 43, de Belleville au Gros-Caillou et les chantiers étaient ouverts au même endroit depuis quatre ans déjà — les dynamiteurs s'étaient glissés sous le Palais-Bourbon et l'avaient miné sans être inquiétés. Une bonne mèche, un mouvement d'horlogerie; leur plan venait de réussir.
Si quelque doute eût subsisté dans l'esprit des magistrats, une lettre insolente, trouvée ouverte sur la table de la cambuse, bien en évidence, l'eût certainement dissipé. Elle disait en italien:
«Voici qui ne vaut pas l'incendie de Munich et de Francfort; mais c'est un commencement. Le reste viendra. Vous ne perdrez rien pour attendre. À bas la guerre! A bas les patries! Vive l'humanité sans frontières! Si vous voulez dépister les compagnons qui vous ont fait cette surprise, prenez vos meilleurs dirigeables, car dès à présent les gaillards sont loin.»
Pas de signature. Nous n'en avions pas besoin. L'indignation fut générale. Assurément les compagnons, s'ils eussent été là, ne seraient pas sortis vivants des mains de la foule exaspérée.
Comme je remontais sur le pont de la Concorde tandis que les magistrats poursuivaient leur enquête sous le quai d'Orsay et dans les chantiers du Métropolitain, j'aperçus Coquet et Malaval qui accouraient pour faire leur office. Brièvement je les mis au courant de l'affaire, qu'il leur appartenait de suivre pour le journal et je m'empressai de courir aux bureaux de l'An 2000. Ma promenade hygiénique était loin.
Courir eût été difficile. Cent mille curieux emplissaient la place de la Concorde et demandaient force détails à quiconque revenait du Palais-Bourbon.
J'en donnai aux premiers qui m'interrogèrent, et de tels qu'on me pria vite de monter sur les omoplates de deux d'entre eux pour haranguer la foule aussi loin que ma voix pourrait porter.
L'effet de mes révélations fut saisissant. Il me vint alors une idée.
Comme je voyais l'An 2000 dans presque toutes les mains, je dis brusquement qui j'étais. Je criai que c'était moi le prisonnier de Jim Keog et le mandataire qualifié de ce méprisable homme de génie...
Alors on oublia l'explosion pour m'entendre.
Oh! impression tragique que me fit cette mer humaine, devenue subitement silencieuse devant l'inconnu qui lui certifiait, de visu, la réalité de tout ce que le journal lui racontait ce matin-là.
Grisé par l'enthousiasme des autres, je me laissai entraîner à un plaidoyer si chaleureux pour l'achat du Sirius que j'en eus bientôt du regret. La conviction que j'avais fait passer dans l'esprit de la foule était si forte, si volontaire, que sans délai des chefs improvisés formulèrent un plan de bataille pour obtenir satisfaction du gouvernement.
— Pas de mitaines! Allons droit chez le président!
— Oui, tous à l'Elysée! Réclamons l'achat des brevets de l'Américain!
— Oui, oui! A l'Elysée!
En un clin d'oeil je fus happé par des bras vigoureux, installé sur le cou d'une espèce de colosse et placé en tête du cortège populaire, qui, sans autre formalité, se dirigea vers le palais du Président.
— Oh! me dis-je, voilà qui va se gâter et ce n'est pas ainsi que nous ferons réussir notre affaire! Par la légalité, oui, mais non par l'émeute! Du calme, mes amis, du calme! Laissez-moi rentrer à mon travail, demander une audience courtoise au président, je suis sûr que cette façon de procéder sera mieux accueillie.
Je criais toutes ces bonnes choses à mes caudataires, mais le cortège avançait toujours vers l'avenue des Champs-Elysées, en criant sur l'air séculaire, et bien peu varié, des Lampions:
— Jim Ke-og, Jim Ke-og!
Il ne faut pas que ce tumulte d'un instant se prolonge, pensais-je; nous perdrions tout droit à l'examen de la proposition. Et que dirait le patron? Déjà il est au courant de ce qui se passe, par les téléphones et les phonographes.
J'entendais en effet le phonographe-géant installé sur la terrasse de l'Automobile-Club qui hurlait par-dessus nos têtes les nouvelles de haute importance. Il me semblait l'entendre:
— Le rédacteur de l'An 2000, à la tête de cent mille manifestants, marche sur l'Elysée.
Et mille autres phonographes-géants allaient répéter la nouvelle à travers Paris.
— Nous avons d'autant plus de torts, sentais-je, que dans cette foule, il y a peut-être vingt pour cent de fauteurs de désordre par profession, d'apaches qui n'en connaissent aucune, de révolutionnaires dont le pillage est le but suprême.
Quelle idée!
Je pris vingt francs dans la poche de mon gilet; je les glissai dans la main du lutteur forain qui me portait sur ses épaules comme un panier de cerises.
— Je ne veux pas aller à l'Elysée aujourd'hui, lui dis-je à mi-voix. Conduisez-moi plutôt à l'An 2000. Ce sera suffisant pour une première manifestation. Là, je distribuerai un bon pourboire aux camaraux.

En un clin d'oeil, je fus happé, installé sur le cou d'une
espèce de colosse et placé à la tête du cortège populaire.
Ils étaient une vingtaine, les camaraux, amalgamés spontanément, comme les atomes ronds et crochus, autour du colosse qui me servait de monture.
— Compris, patron! répondit mon cheval de triomphe.
Aussitôt les dirigeants du mouvement, devenus mes salariés et fiers de l'être, obliquèrent à droite, pointèrent sur la rue Royale, canalisèrent la manifestation vers la Madeleine puis, par la rue Tronchet, tout le long du boulevard Haussmann.
Ce fut dans ce singulier équipage, suivi d'une foule innombrable, que j'arrivai sous le colossal vitrage de l'An 2000.
M. Martin du Bois était au balcon, radieux.
Il agita son mouchoir pour remercier discrètement les manifestants, et me fit comprendre par ses gestes que cette démonstration populaire était du meilleur augure pour le succès de notre entreprise.
Tout le monde voulait entrer dans les bureaux; mais une escouade de police, diligemment accourue, prévint les excès de la sympathie. J'eus soin de faire grouper les camaraux. On les autorisa par exception à pénétrer dans le hall du rez-de-chaussée, où la récompense promise leur fut comptée par le caissier, de façon discrète.
J'entrai chez le directeur. Il rayonnait.
— Ignorez-vous donc, lui demandai-je, la catastrophe du Palais-Bourbon?
— Je ne l'ignore pas. Je la déplore comme il convient; mais ce sont là des malheurs inévitables. Estimons-nous heureux dans ce malheur! La Chambre pouvait être au complet. C'eût été alors une boucherie lamentable. Une douzaine de députés ont péri. Une perte, assurément! Mais il y a tant de candidats qui attendaient la mort de chacun d'eux pour solliciter son siège! Je me réjouis pour deux raisons: la première c'est que cette séance — je l'avais oublié hier soir — n'aura pas été, comme elle devait l'être, la dernière de la session. Les députés comptaient s'y séparer, pour laisser à l'exécutif la direction de la guerre, sauf à intervenir en cas de besoin. Supposez que cette explosion eût raté. Nous étions mal partis, avec notre campagne pour Keog! Le Parlement désagrégé, c'eût été le diable pour le réunir à nouveau, sous le prétexte de lui faire acheter un ballon...
— Et pourtant!
— A qui le dites-vous? C'est une préoccupation qui doit devenir celle de tous les vrais patriotes, dès qu'ils auront lu votre article. Mais encore, mieux vaut tenir que courir. A la suite de l'attentat de ce matin, le gouvernement a pris une décision révolutionnaire. Il va demander aux deux Chambres de siéger en permanence au lieu de se séparer. On me téléphone à l'instant du ministère de l'Intérieur, que la Chambre des Députés et le Sénat vont se réunir en congrès dans la salle de l'Opéra, et déclarer que l'un et l'autre siégeront ainsi tout le temps que durera la guerre. Excellente combinaison pour notre affaire... Mais vous me voyez enchanté pour une autre raison. Lisez ce télégramme de Londres. Ou plutôt, non... ouvrons la fenêtre, vous allez écouter avec moi notre phonographe-géant le crier aux enthousiastes qui vous ont amené. Vingt mille d'entre eux restent dans la rue, attendant quelque nouvelle à sensation. Celle-là en est une, ou je ne m'y connais pas.
Nous ouvrîmes la verrière.
Le phonographe, coiffé d'un pavillon énorme, lançait par-dessus les têtes des curieux, d'une voix tonitruante, et combien nette, un récit singulièrement inattendu.
«On annonce de Bruxelles, disait-il, que la plus bizarre des catastrophes financières vient de se produire à Berlin.
«L'effet s'en est répercuté presque aussitôt dans les principales cités de l'Empire. Demain ce sera au tour des petites villes, des villages. Et ce sera la ruine de l'Allemagne entière.
«Ne s'est-on pas aperçu hier à la Banque de Berlin que tous les billets présentés aux guichets étaient faux, depuis les plus gros jusqu'aux plus petits? Ceux qui ne l'étaient pas disparaissaient dans la masse des autres et les employés eux-mêmes ne savaient plus les reconnaître. L'éveil donné, on a vite appris des choses désastreuses.

«On annonce de Bruxelles, lançait l'énorme pavillon du phonographe, qu'une catastrophe financière bizarre vient de se produire à Berlin.»
«Divers télégrammes avaient bien signalé, dans plusieurs grandes villes comme Leipzig, Dresde, Cologne, Dusseldorf, Hambourg, la présence de personnages louches, qui s'occupaient d'opérations financières depuis l'ouverture des hostilités. Mais leurs qualités de citoyens belges, ou suisses, norvégiens, roumains, turcs, empêchèrent la police de s'immiscer dans leurs affaires. On les soupçonnait de travailler isolément à quelque machination commune contre le crédit de la Banque impériale. C'était exact. Depuis ce matin, le pot-aux-roses est découvert. «En prévision de la guerre qui vient de commencer, la perfide Albion n'a pas hésité à employer, pour combattre son adversaire, un moyen que les honnêtes gens réprouveront sans doute; mais il faut bien convenir que le coup est de bonne guerre. Porté aux Allemands, dès le début de la campagne, il apparaît plus terrible que dix batailles perdues par leurs armées sur la frontière française, sous les eaux de la mer du Nord ou dans les plaines de l'éther..»
Un murmure de curiosité surexcitée s'était par trois fois faufilé dans les rangs pressés des badauds.
Ils étaient là vingt mille, qui écoutaient, bouche bée, le phonographe débiter, tranches par tranches, ces étranges nouvelles.
L'appareil continua, au milieu d'un grand silence. Tout le premier, j'étais impatient de connaître la suite de ces révélations.
M. Martin du Bois se frottait les mains.
«Il paraît établi, dès à présent, que ce coup de Jarnac était préparé de longue main à Londres, en prévision de la guerre inévitable. Par centaines de millions les billets de banque allemands, admirablement falsifiés, dormaient dans de mystérieux coffres-forts au bord de la Tamise, en attendant que l'occasion se présentât aux Anglais de lancer en avant ces auxiliaires d'un nouveau genre, bien modernes on en conviendra.
«Si d'habiles faussaires, traqués par la police et par cela même imparfaitement outillés, parviennent à imiter les billets de banque de tel ou tel pays, et à créer de périodiques paniques, quels résultats effrayants peut obtenir un gouvernement audacieux, en falsifiant sans scrupules les billets de banque de son adversaire de manière à ruiner en quelques jours son crédit!...»
On entendait, après chaque phrase, monter des rumeurs joyeuses d'approbation.
— Ça, par exemple, ça ne s'est pas encore vu!
— Voilà une idée! à la bonne heure! Ce sera plus tôt fini!;
— Bravo!
Le phonographe, inexorable, poursuivait «Bruxelles 10 h. 40. Les directeurs des grands établissements financiers ont téléphoné, des quatre coins de l'Empire, que le commerce était inondé de billets faux, depuis hier. On estime à plus d'un milliard la somme représentée par ces monceaux de papier falsifié. Ils ont été répandus adroitement, en quarante-huit heures, par une multitude de complices, conscients et inconscients.
«Aussi la plus épouvantable panique s'est-elle déclarée partout à la fois. L'Indépendance belge certifie les faits ci-après, que lui a téléphonés son correspondant: plus de cent mille personnes assiègent les banques et les bureaux de poste à Berlin pour y réclamer en or ou en argent le montant de leurs dépôts. Aucun commerçant ne veut plus recevoir de billets de banque d'aucune sorte. Les acheteurs qui en présentent aux marchés et dans les magasins sont impitoyablement éconduits. Les ordinaires accapareurs de métal ont ainsi beau jeu pour exercer leur industrie.
«Comme aucun envoi postal, même de ville allemande à ville allemande, ne peut plus se faire par suite de la dépréciation totale du papier fiduciaire, toute transaction est arrêtée. Les gens qui ont de l'or le gardent en prévision de la détresse qui va suivre cette effroyable révélation. A la Bourse qui s'ouvrira tout à l'heure, l'argent au jour le jour, si quelqu'un peut en offrir, vaudra, dit-on, 200 pour 100 l'an. Toutes les valeurs vont s'effondrer. Le fonds d'Etat est déjà tombé à rien chez les coulissiers. On parle dans les sphères gouvernementales d'empêcher l'ouverture de la Bourse, précisément, pour atténuer autant que possible l'étendue du désastre.»
Il y eut un instant d'arrêt. Mais aussitôt une nouvelle communication compléta la précédente.
Le phonographe hurla:
«Berlin, 11 heures matin. On ne pourra pas empêcher la ruine du commerce et de l'industrie. Dès à présent, l'Allemagne, accablée d'un papier-monnaie dont l'équivalent n'est plus représenté en or à la Banque, est en état de banqueroute, de fait. Quatre régiments de ligne viennent de prendre position autour de la Banque impériale, qui refuse, jusqu'à nouvel avis, de rembourser en numéraire aucun billet.
«Le scandale le plus violent a éclaté dans les rues. Les rixes sont nombreuses. On entend pleurer des familles entières, ruinées du coup. La police a dû requérir des troupes pour garder les banques privées et les établissements des changeurs. On estime à dix mille le nombre des maisons de commerce qui vont déposer leur bilan avant ce soir. Et nous ne sommes qu'au premier jour de ce cataclysme effroyable, provoqué par une machination véritablement diabolique!
«On dit à Bruxelles que c'est le ministère Grey, prédécesseur de l'actuel, qui a combiné toute cette affaire, engagé des dessinateurs hors ligne, des graveurs, construit les presses dans le plus grand mystère, au fond de l'Ecosse, et tiré sans relâche, pendant près de six mois, les faux billets destinés à remplacer, dans la guerre attendue par tous les Anglais, ce que l'Histoire appelle encore la cavalerie de Saint-Georges (1).
(1) L'or qui servait à rémunérer les services rendus au gouvernement britannique. La pièce d'or anglaise porte au revers un Saint-Georges à cheval.
«La suite dans une heure.»
— Que dites-vous de ce coup droit? me demanda Napoléon en feuilletant une liasse de dépêches qu'on venait de lui apporter?
— Je dis qu'il n'est peut-être pas très droit, précisément, mais qu'aux temps où nous vivons il semble de plus en plus évident que la doctrine nouvelle l'emporte sur l'ancienne. A la guerre comme à la guerre! Ruiner les forces de l'adversaire par tous les moyens.
— Voilà la vérité! Maintenant deux mots de notre affaire!
M. Martin du Bois me confirma l'effet produit par nos révélations. Elles étaient allées droit au coeur du peuple parisien. Les marchands de journaux assiégeaient l'imprimerie pour redemander du papier, on avait fait un tirage fabuleux.
— J'ai bien compris tout à l'heure, quand je me suis vu porté en triomphe, dis-je. Je pouvais, d'un geste, déchaîner à propos de ce Keog une véritable émeute dans Paris.
— C'est que la foule est simpliste, mon ami. Elle se croyait très forte, mieux outillée que quiconque. Or, vous venez lui apprendre qu'un homme est capable d'anéantir aisément le travail de dix années, un travail qui a coûté plus d'un milliard au pays. Vous lui dites par surcroît qu'on peut acheter l'invention de cet homme extraordinaire, qu'on l'aura pour vingt millions et que la commission qu'il vous a promise, vous l'abandonnez d'avance, avec un beau geste, ma foi, aux pauvres de Paris... C'est la fin de votre article.
— Je ne m'en dédis pas.
— C'est ce que j'avais prévu. La foule, étant avec nous, va presser sur le Parlement. On va le réunir en congrès dès demain. J'ai interrogé trois ministres sur quinze, au mégaphone, ce matin. Ils sont émerveillés et donnent les deux mains à votre projet. J'ai causé aussi, de chez moi, avec de solides amis des deux Chambres. L'un d'eux s'en allait justement à la séance matinale du Palais-Bourbon, dès neuf heures. J'ai appris qu'il a évité l'explosion par un heureux hasard. Il s'était arrêté chez un armurier pour y acheter un casque et un écu, ayant très peur de ce qui peut, à chaque instant, nous tomber de là-haut. L'avis est unanime. Notre proposition, que je demanderai à ce député de déposer, précisément, avant quarante-huit heures, ne rencontrera pas d'opposants. S'il s'en montrait quelques-uns, assez osés pour remonter le courant que l'An 2000 vient de déchaîner, ils seraient emportés comme des fétus, vous verriez..
Je vis, en attendant, M. Martin du Bois tressaillir.
Il avait prêté l'oreille.
Il levait un doigt.
— Ecoutez, fit-il, l'oeil inquiet, la bouche tordue par un ricanement d'homme agacé.
J'écoutai. Au milieu des curieux qui stationnaient toujours sur le boulevard, se glissaient des. gamins dont le cri rauque m'ouvrit tout de suite des horizons.
— Demandez l'An 3000! Edition spéciale! L'An 3000! hurlaient ces gnômes évidemment envoyés sous nos fenêtres par la concurrence pour que nous fussions plus vite au courant de quelque vilenie nouvelle, imprimée à notre intention sur leur méchant papier.
L'ordre d'acheter l'An 3000 dès qu'il lançait ainsi quelque supplément tapageur était donné une fois pour toutes.
Automatiquement, le personnel l'exécutait. Avant que M. Martin du Bois eût eu le temps de me dire: A vous le poulet du jour! un groom apporta dans son cabinet deux numéros du «canard enragé» comme notre Napoléon qualifiait le journal de ses rivaux.
C'était bien moi qu'on mettait sur le gril.
Je parcourus les «manchettes». Elles n'étaient pas tendres, dans leurs formules pour ma modeste individualité. Qu'on en juge:
UN BLUFF IMPUDENT. — L'ARTICLE D'UN LOUFOQUE.
A CHARENTON! — ENQUÊTE DE L'AN 3000
SUR L'ÉTAT MENTAL DU MONSIEUR
QUI CROIT QUE C'EST ARRIVÉ.
FRANCE, ON TE TROMPE!—DÉFIE-TOI DES INDIVIDUS!
SURTOUT QUAND ILS SONT A COURT DE COPIE.
PAS D'ACHAT!
UN HAUSSEMENT D'ÉPAULES ET UNE DOUCHE!
TELLE EST LA VRAIE PROPOSITION.
CELLE QUE FORMULE L'AN 3000.
LISEZ TOUS! LISEZ! LISEZ!
ET DEMAIN MERCREDI, A 3 HEURES,
SUR L'ESPLANADE DES INVALIDES
GRAND MEETING D'INDIGNATION.
Plus bas, en bonne place pour une réclame:
AMPLIFICATEURS DE LA MAISON STENTOR
Il y en avait deux colonnes, accompagnant une trentaine de lignes sur la catastrophe du Palais-Bourbon.
Tandis que mon directeur les parcourait en silence, digérant avec peine sa fureur, je les avalai, si l'on peut dire, avec le sourire du martyr sur les lèvres. C'était un tissu de démentis plus bêtes les uns que les autres.
J'étais d'abord un farceur; je m'étais égaré dans quelque Kursaal à bord de l'Austral, et pour justifier mon absence, j'avais raconté cette aventure dans les airs, cette histoire de brigands.
Deuxième hypothèse: j'étais fou. Alors c'était le traitement des aliénés qu'il me fallait, l'internement, la douche, etc. Je vous fais grâce de cette littérature imbécile. Finalement, on ameutait les mécontents sous ce nouveau prétexte pour créer quelques embarras de plus au gouvernement.
— Que faut-il faire? demandai-je par déférence à mon directeur. Je vais provoquer en duel l'auteur de ce stupide factum...
— Ne faites pas ça! Tout, excepté ça! Le dédain, voilà notre arme. Voyez d'ici le public, en bas. Voyez de quel oeil indifférent il suit les crieurs du confrère! Personne n'achète leur marchandise! On sait ce qu'elle vaut! Jalousie que tout cela, jalousie! J'ai un ballon; il n'en a pas. Il en rage. Nous le retrouverons sous un autre prétexte! En attendant, voici 11 h. 20. Le secrétaire général de la présidence m'attend à l'Elysée à 11 h. 45. J'y cours. Il n'y a pas d'explosion au Palais-Bourbon qui tienne. Il faut que nous soyons reçus par le chef de l'Etat dès demain matin, pour couper l'effet de leur meeting. Voyez donc les dépêches, allez déjeuner, faites un tour et trouvez-vous ici à trois heures.
J'étais tout de même un peu troublé, non par l'article idiot qui me représentait comme une espèce d'hurluberlu, mais par la convocation finale, par l'appel au meeting d'indignation (sic). Quelque chose me disait, dès cette minute, que je ne laisserais point passer une réunion de ce genre sans m'y rendre en personne, afin d'y prononcer un discours et de convaincre jusqu'à mes adversaires, ceux du moins qui gardaient une parcelle de bonne foi.
Cette virile résolution prise, je me trouvai plus calme pour parcourir les télégrammes. Les événements se succédaient avec une terrible rapidité.
A la frontière de l'Est, les armées en présence se fortifiaient dans les nouvelles positions que leur avait attribuées la bataille de la veille. Moralement notre succès restait très grand; mais nous n'avions guère avancé.
Nos avant-postes occupaient tout juste les premières villes ouvertes de la Lorraine. Quels carnages pour de piètres résultats! Et dire que désormais il en serait souvent de même!
Si bien organisés que fussent le service des ambulances, le corps actif des médecins, la cohorte dévouée des dames françaises de la Croix-Rouge ne parvenaient pas à évacuer très vite nos quarante mille blessés.
Même désordre, au surplus, chez l'adversaire.
Et que de disparus!
L'envoi en arrière de deux véritables armées d'indisponibles se faisait péniblement à grand renfort d'automobiles.

Le carnage commençait et l'envoi en arrière de deux véritables
armées d'indisponibles se faisait péniblement à grand renfort
d'automobiles réquisitionnées dans les régions voisines. (Page 151).
Pendant ce temps-là, d'autres convois, par centaines, exécutaient une opération inverse et affluaient vers les derrières de chaque armée pour lui porter des projectiles, dont chaque belligérant faisait, avec les armes automatiques, une invraisemblable consommation.
Ce n'est plus faute de combattants, comme à l'époque du Cid, que cesseront les combats désormais; ce sera faute de munitions.
Dans le détroit et autour des Iles Britanniques, le calme provisoire continuait, précurseur de quelque redoutable tempête. Grâce à ses navires, et aux nôtres, l'Angleterre tenait jusqu'ici l'agresseur en respect.
Il n'en était pas de même sur divers points du globe, où les croiseurs et sous-marins des belligérants, surpris par la soudaineté de la guerre, se portaient d'abominables coups.
Au long de la côte orientale de l'Afrique, une division anglaise, venant des Indes, avait détruit deux navires allemands en quinze minutes de combat. Pas un seul des hommes qui les montaient n'avait échappé au désastre.
Les navires, deux superbes bâtiments de seconde classe, étaient descendus sous les flots au son de leurs musiques, les commandants ayant préféré cet engloutissement stoïque à une reddition qui eût blessé leur amour-propre.

Préférant l'engloutissement à une reddition, deux
superbes bâtiments allemands étaient descendus sous
les flots au son de leurs musiques. (Page 151).
Et pourtant ils pouvaient invoquer le fameux: fors l'honneur, d'un roi de France. Deux contre sept!
De la flotte aérienne allemande, toujours rien. Celle de l'Angleterre au grand complet manoeuvrait dans les environs de Londres avec de multiples incidents, à quelques centaines de mètres de hauteur, considérablement gênée, c'était à prévoir, par les brouillards qui enveloppent si souvent les Trois-Royaumes.
Dans le nouveau monde, les deux forces navales adverses, des Etats-Unis et du Japon, couraient au-devant l'une de l'autre à travers le Pacifique. Soixante-quinze unités du côté américain, quatre-vingt sept du côté japonais! A quel choc effroyable devait-on s'attendre!

A San-Francisco, cent mille Japonais, équipés et
armés, pillaient tout sur leur passage. (Page 151).
Les télégrammes de San-Francisco annonçaient d'autre part que cent mille Japonais, acclimatés ou soi-disant tels dans l'ouest de la République, s'étaient vite réunis, équipés et armés en pillant tout ce qu'ils avaient rencontré. Et le gouvernement de Washington paraissait peu rassuré sur le rôle que les milices de cette région pourraient jouer en face de cette poussée des Jaunes, prévue sans doute, annoncée, dénoncée cent fois par avance depuis des années, mais que le gouvernement espérait toujours mater.
A Denver se concentrait aussi une flotte aérienne. Mais contrairement à ce qu'on eût pu croire, elle n'avait rien de bien menaçant. C'étaient des ballons de plaisance, appartenant à des touristes milliardaires, que le département fédéral de la guerre armait tant bien, que mal, sans parvenir, disait-on, à leur recruter des équipages en nombre suffisant. Je me disais en moi-même que les Etats-Unis eussent dû nous surpasser tous. N'avaient-ils pas chez eux un Sirius et un Keog?
Certes, mais nous avons vu que master Jim ne brillait pas précisément par le patriotisme.
Ubi money, disait-il en parodiant l'axiome d'un ancien, ibi patria. Ma patrie, c'est le pays qui me donnera le plus d'argent.
J'allais me mettre à rêver sur ces choses, comme si l'heure eût été aux rêveries, lorsque Pigeon me fit prévenir qu'il m'attendait pour déjeuner.
C'était une bonne idée.
Attablés dans un restaurant discret du quartier, nous pûmes passer en revue les événements des derniers jours à tête reposée, et nous congratuler d'être sortis tous deux, à bon compte, en somme, de cette première phase des opérations, si surprenante que les gens de mauvaise foi refusaient de croire à nos récits.
Il me parla de mon article sensationnel et de ses conséquences.
Il me parla surtout de Miss Ada, comme un homme qui eût bien voulu prendre la suite des affaires du lieutenant Davis.
— Attendez au moins la fin de la guerre, lui dis-je, pour présenter votre candidature! J'ai vu, dès notre voyage sur l'Austral, que Miss Ada ne vous regardait pas d'un oeil hostile. Le temps arrangera peut-être les choses. Patientez! Pour le moment, je crois qu'elle ne songe guère au mariage... Venez donc faire un tour de boulevard avec moi, en attendant trois heures...
Nous prîmes au boulevard des Italiens le trottoir roulant qui va de la Madeleine à la place de la République. Il faisait beau; animation y était à son comble.
Des soldats de toutes armes nous entouraient, qui gagnaient par les différentes gares des places de l'Est, ou l'une des sept armées que nous avions en campagne.
Hommes, femmes, enfants, que nous rencontrions, tous plus ou moins affublés des ustensiles en métal protecteur, s'entretenaient de la catastrophe du matin.
Les phonographes en avaient fait connaître les détails à tout Paris. On ne parlait que de cette explosion provoquée par en dessous. Et pourtant c'était encore en l'air, toujours en l'air, que se portaient les regards d'un chacun.
Dès qu'un aérocar de la flotte auxiliaire, réunie au Mont-Valérien au nombre de soixante et quelques unités, me dit Pigeon, apparaissait au-dessus des rues, vite le même geste qui m'avait tant frappé le matin même!
Je remarquai que beaucoup de balcons étaient protégés par des stores en bronze percés de trous Les habitants des étages les plus élevés perdaient ainsi le bénéfice de la lumière, mais ils dormaient plus tranquilles. Quant aux toits mêmes des maisons, me dit Pigeon déjà renseigné sur toutes choses, nombreux étaient ceux qu'une habile compilation d'argile sans cesse arrosée protégeait tant bien que mal contre des incendiaires aériens.
Nous roulions, emportés par le mouvement un peu rude du trottoir qui se déplaçait pour nous éviter de marcher.
Comme devant un cinématographe nous vîmes défiler les terrasses des cafés, remplies de promeneurs qui attendaient les nouvelles en sirotant des boissons variées.
Un tas de bruits discordants les assourdissaient et nous aussi: phonographes-monstres, qui de partout clamaient les nouvelles et les réclames; camelots, marchands de vues instantanées prises la veille sur les champs de bataille, vendeurs de l'An 2000 qui trouvaient encore des acheteurs en plein après-midi, vendeurs de l'An 3000 qui, je le constatai partout, en trouvaient beaucoup moins.
Je remarquai que les enseignes des Compagnies d'assurances portaient des avis tout fraîchement imprimés en noir sur du calicot blanc. Les unes élevaient à des hauteurs inconnues le taux de leurs primes sous le coup de mes révélations; et elles le disaient.
L'une d'elles allait plus loin:
A LA SUITE DE L'ARTICLE PARU CE MATIN
DANS L'AN 2000 NOUS N'ASSURONS PLUS
AUCUN IMMEUBLE EN FRANCE
A N'IMPORTE QUEL TAUX.
Un service de ballons publics à moteurs fonctionnait depuis quelques mois déjà entre Vincennes et Passy.
Nous vîmes ses mastodontes, lourdauds et sans grâce, passer à cent mètres au-dessus de nos têtes. Il me sembla qu'ils portaient peu de voyageurs.
— Sûrement, déclara Pigeon, la terreur s'est emparée des bonnes gens. Chacun croit qu'il va voir le Sirius et Keog fondre sur lui, l'un portant l'autre, pour happer quelques Parisiens et les emmener en captivité dans les nuages.
Déjà la police faisait circuler des écriteaux avertisseurs sur lesquels on lisait: Baissez la tête!
Un voisin complaisant nous renseigna. Depuis les cinq jours que la guerre était commencée, le nombre des vols de montres, de chaînes, de portefeuilles, avait considérablement augmenté!
Instinctivement je tâtai la poche de mon gilet, où se tenait d'ordinaire mon chronomètre à phosphorescence. Il avait disparu.
Notre interlocuteur sourit. Je n'osai pas requérir son arrestation, supposant bien que, s'il avait détourné mon objet tandis que j'avais le nez en l'air, il s'en était prestement débarrassé dans les mains d'un complice.
Vers le Gymnase, les amplificateurs des phonographes nous envoyèrent des nouvelles lugubres: une longue liste d'officiers et de soldats tués sur je ne sais quel point de l'immense conflagration de la veille.
Aussitôt un rassemblement énorme se formait, et comme il arrive toujours, des mères, des enfants recevaient de cette voix brutale la sinistre nouvelle que leur fils, leur père, leur frère était mort devant l'ennemi.
Des fenêtres d'un vaste immeuble, où l'An 3000 avait installé ses bureaux, on jetait à la foule des listes de dix mille noms qui complétaient les renseignements phonographiques.
Il fallait voir la ruée des femmes angoissées, la main tendue vers les fragiles tables de mort.
De même que jadis elles se fussent emparées d'une liste de numéros gagnants à n'importe quelle loterie, je les voyais se jeter, voraces, sur ces bandes de papier qu'elles se disputaient qu'elles déchiraient pour en avoir plus vite un lambeau.

Les mères, les épouses se disputaient la liste funèbre des
dix mille noms que transmettait le ministre de la Guerre.
Et vite, dans un coin, leurs yeux cherchaient, ainsi que ceux de leurs petits, si le nom du chef de la famille n'était pas là, inscrit avec tant d'autres sur les listes funèbres.
Depuis la veille au soir, me dit Pigeon, les états-majors transmettaient ainsi d'urgence, par ordre du ministre de la Guerre, les noms des morts, du moins ceux des morts que le service sanitaire pouvait identifier sur les champs de bataille et aux environs.
Les portes Saint-Denis et Saint-Martin étaient cuirassées de bronze, elles aussi, pour éviter la détérioration par le feu d'en haut.
Sur la place de la République, où nous descendîmes du trottoir roulant afin de revenir à pied, nous apprîmes d'un mégaphonophotographe que nos troupes avaient fait environ dix mille prisonniers.
On les échangeait à l'instant même avec un nombre égal de nos soldats tombés vivants aux mains de l'ennemi.
Sous globe aussi, comme disait Pigeon, la statue de la République, au milieu de la vaste place!
L'ancienne caserne du Château-d'Eau, devenue l'Hôtel des Eaux municipales, nous parut fort animée.
Nous y entrâmes, sur la présentation de nos cartes, pour constater que mon article avait provoqué une singulière mesure d'affolement. Sur l'ordre du préfet de la Seine, tout le personnel s'apprêtait à faire fonctionner le service d'inondation de la capitale au premier signal.
On sait que depuis peu la ville de Paris est desservie en eau potable par le lac suisse de Neuchâtel, ce qui donne à ses ingénieurs la faculté d'employer à une inondation habile toutes les rivières captées depuis un siècle: Vanne, Dhuys, Avre, Loing, Lunain, Voulzie, Ourcq, sans compter la Marne, la Seine et l'Oise.
La terreur des ballons, toujours!
En deux heures Paris peut devenir Venise. Beaucoup de fusées de l'ennemi seraient alors autant de coups d'épée dans l'eau.
J'avais hâte à présent de rentrer, car il était plus de deux heures, et il me tardait de connaître le résultat de la démarche faite à l'Elysée par M. Martin du Bois.
Nous revînmes bon pas en fumant, nous arrêtant à peine aux curiosités du boulevard, toutes bizarres, toutes orientées vers cet objectif unique, vers cette préoccupation fixe: les ballons ennemis, capables aussi bien que les nôtres, mieux que les nôtres peut-être, d'apparaître à tout instant au-dessus de Paris et de le mettre à mal.
Le théâtre des Variétés faisait annoncer du haut de son toit que le soir même, il offrirait à ses spectateurs le cinématographe d'un coin de la bataille du 23.
Comme nous nous étonnions de voir subitement éclater une grande allégresse vers la rue Montmartre, le mégagramophone du passage Jouffroy, dont la voix de basse-taille amusait depuis six mois Paris et les étrangers, nous apprit que la flotte de M. de Troarec venait d'arriver à Langres, n'ayant perdu depuis les cinq jours que trois unités — hélas, lesquelles!
Hospitalisée sous les hangars et dans les vallées couvertes autour de Langres, elle rassurait la population par sa proximité de la capitale.
La sachant à quelques heures d'eux les Parisiens respiraient; ils tremblotaient moins.
A trois heures précises je me retrouvais en présence de M. Martin du Bois. Il n'était pas content de sa visite.
— Je n'aime pas les échecs, me dit-il avec nervosité. Or, je crois bien qu'on nous en prépare un. Ce n'est pas fini; mais tout de même, ça ne va pas comme je voudrais.
Napoléon me résuma ce que lui avait dit le secrétaire général de la présidence.
Des fleurs, beaucoup de fleurs, pour commencer. La grande autorité de l'An 2000, certes. La haute intelligence de son directeur, sans doute. La sérieuse influence qu'il exerçait sur la majorité dans les deux Chambres, sur les millions d'électeurs et de lecteurs qui achetaient chaque matin son journal. Jusqu'à ma personnalité dont le chef de l'Etat connaissait soi-disant la valeur, la carrière probe, exempte de compromissions avec des puffistes qui font si souvent tort à notre profession...
Sur le principe de l'audience il n'y avait pas de doute possible.
Je saluai ironiquement au passage cette brassée de roses et j'ajoutai aussitôt:
— Mais?...
— Mais, voici le mais, en effet! Le président ne peut nous recevoir aujourd'hui. La catastrophe de ce matin représente un malheur public. Le chef de l'Etat est tout au chagrin que lui a causé l'explosion de la Chambre. Enfermé dans ses appartements, il n'a voulu recevoir personne, en signe de deuil.
— Bon. Mais demain?...
— Demain matin, il a Conseil des Ministres, et réception de plusieurs ambassadeurs des puissances étrangères. En plus, toutes les audiences fixées à ce matin sont reportées à demain dans la journée.
— La nôtre pourrait venir à la fin?
— C'est ce que j'ai insinué. Mais là j'ai compris que quelqu'un travaillait contre nous. Les gens de l'An 3000 ont agi. Notre secrétaire général, bon diplomate, n'a pas cherché à me le dissimuler. Ils ont réussi à faire reporter notre entrevue au jour suivant, et encore avec un conditionnel qui me choque. En d'autres termes, M. Lirondel, l'aimable et subtil secrétaire général, m'avisera par un coup de téléphone, après-demain matin, de l'heure à laquelle le chef de l'Etat pourra nous recevoir, si la chose lui est possible ce jour-là... Vous avez saisi?
— Parfaitement. Si le meeting organisé contre nous tourne en notre faveur, on nous écoutera. Si nous y prenons la pipe, on nous renverra, sous un prétexte quelconque, aux calendes.... Patron, il faut que ce meeting soit notre triomphe.
— Je ne demande pas mieux.
— Pour qu'il en soit ainsi, je m'y rendrai.
— Vous?
— En personne.
— C'est une idée qui me plaît. Elle est crâne.
— Je tiendrai tête à mes calomniateurs. Je convaincrai les plus incrédules par la sincérité de mes déclarations. Laissez-moi faire. Pigeon et Coquet me prêteront assistance. On ne nous étranglera pas, je pense!
— Soit! C'est une partie à jouer. Mais méfiez-vous de nos gaillards! Ils sont canailles! Ils ont des tours dans leur sac! Pour faire échouer votre proposition si patriotique et si juste ils feront l'impossible. Si je racolais un millier de braillards, à tout hasard?
— Ça ne peut pas nuire. Malaval, en deux heures, retrouvera mon lutteur de ce matin et ses camaraux. Eux se chargeront du reste.
— Ne vous inquiétez pas des détails.
— Qu'il fasse beau, monsieur, voilà tout ce que je souhaite! Vous verrez que la vérité triomphe toujours du mensonge et de la jalousie.
M. Martin du Bois ne me parut pas convaincu.
Et moi je l'étais à ce point que j'avais hâte d'arriver au lendemain, au milieu de la foule ameutée, de crier aux détracteurs de notre combinaison leur sottise, leur antipatriotisme inconscient, et cætera, et cætera.
Un feu intérieur me brûlait. Je me disais, parbleu, que chaque jour qui s'écoulait raccourcissait le délai de l'option consentie. Et que de temps perdu déjà!
Je passai la soirée en famille et dormis, cette nuit-là, quatorze heures à poings fermés.
Levé à midi, j'avais vite déjeuné. Pigeon vint me prendre avec Coquet, et tous trois, par une radieuse journée de cette fin de septembre, nous nous rendîmes au fameux meeting.
On n'avait guère de nouvelles du dehors, à ce que me dit Pigeon. Toute l'attention des Parisiens désoeuvrés se concentrait donc sur ma proposition. Elle les révolutionnait, surtout à présent que l'An 3000, avec des semblants d'arguments, cherchait à la faire avorter.
Cinquante mille personnes, au moins, couvraient l'Esplanade des Invalides. Devant le vieil édifice consacré aux gloires militaires, une tribune, presque une scène de forains se dressait sous des tentures de velours rouge relevées par des embrasses à glands d'or.
Nous prîmes place aux premiers rangs.
Les gens qui avaient formé le bureau nous étaient inconnus.
Un orateur occupait la tribune et y pérorait devant un amplificateur comme je n'en avais encore jamais vu. Ce n'était pas un pavillon acoustique, c'était la trompette du Jugement dernier.
À l'orifice de cet engin, commode, après tout, pour se faire entendre d'une foule aussi considérable, l'homme n'avait pas besoin de s'égosiller. Il parlait, en plein air, sur cette place noire de monde, comme il eût parlé dans une salle de théâtre, à deux pas en arrière de l'embouchure, de telle sorte que bien peu de spectateurs perdaient la vue de ses jeux de physionomie.
Sa voix, amplifiée dans l'appareil mégaphonique de la maison Stentor, annoncé la veille en belle place par les organisateurs, prenait alors une tonalité superbe, qui en portait les moindres éclats jusqu'à la Seine.
Ainsi compris, le meeting en plein air devient vraiment une assemblée intéressante, où des milliers d'auditeurs peuvent écouter un orateur et l'entendre. Les Grecs et les Romains avaient eu l'idée de cette amplification du son, sur leur proscenium aussi bien que sur les rostres. Acteurs et tribuns ne parlaient-ils pas de leur temps avec des porte-voix? Il leur manquait le métal utile, et le tour de main de la maison Stentor, voilà tout.
Je remarquai tout d'abord que le citoyen qui pérorait là ne parlait pas du Sirius ni de Jim Keog. Son discours constituait une espèce de lever de rideau, une thèse à côté, en attendant que la foule fût plus dense encore.
Il était du Midi, et avec un fort accent de Béziers ou de Pézenas, attaquait le gouvernement.

— Citoyeins, vociféra un fils de Pézenas, je
vous ai
monntré le dédaing que prôfèsse pour les einventeurs
un gouvernemaint d'emmpotés et d'eincapables.
Il lui reprochait de décourager les inventeurs et leurs inventions. Je prêtai l'oreille à ce thème qui m'était à présent familier.
— Citoyeins, dit-il dans sa péroraison — et l'amplificateur Stentor donnait à ce mot prononcé comme à Béziers une saveur particulière — citoyeins, je vous ai monntré le dédaing que prôfèsse pour les einventeurs et leurs einventions un gouvernemaint d'emmpotés et d'eincapables. La propositionn que je lui ai faite était pourtant bien seimple. Ajouter aux fusées brûlantes de notre aérotactique la fusée délétère, chargée de miasmes qui empoisonnent l'air ammbiant et détruiraient les Prussieins comme des mouches. Et biengue, ces messieurs des bureaux n'ont même pas daigné me réponndre...
Je pensai, avec Pigeon, au premier bonbon que Keog nous avait envoyé aux environs de Verdun et je compatis aux doléances de ce pauvre diable, lorsque la foule, ou du moins une partie de la foule, un clan très discipliné d'auditeurs, évidemment envoyés là par l'An 3000, se mit à protester contre l'audition de tout orateur qui ne traiterait pas la question portée à l'ordre du jour.
L'homme du Midi fit observer que son cas ressemblait à celui de Jim Keog, désormais connu du peuple entier. On lui répondit avec violence que si l'on s'était réuni sur cette esplanade, ce n'était pas pour défendre les thèses de l'An 2000 mais pour les attaquer.
Le bonhomme descendit de la tribune.
Alors, s'y succédèrent trois ou quatre types aux coupes de cheveux bizarres, aux gilets romantiques, aux phrases redondantes. Je compris bien vite que tout un jeu d'orateurs avait été engagé par le concurrent pour nous démolir.
A tour de rôle, en effet, de 2 à 3 heures et demie, ces misérables gagistes me mirent plus bas que terre, injurièrent mon journal et son directeur, dirent pis que pendre de ses doctrines, de ses manières d'agir, de ses finances même. Bref ce fut un éreintement en règle, où il transparaissait que j'étais fou à lier, et que la proposition dont je demandais l'adoption au Parlement n'avait pas le sens commun.
Assis entre Coquet et Pigeon, aux premières chaises, je bouillais de colère et d'impatience.
L'aile gauche de l'assistance, environ dix mille personnes, était pour nos adversaires.
L'aile droite, bien moins nombreuse, semblait tenir tumultueusement pour moi.
Je reconnus dans ses rangs mon géant de la place de la Concorde et les camaraux.
Mais ces deux groupes ne m'intéressaient qu'à demi; je savais ce qu'il en fallait penser. C'était le centre qui me préoccupait!
Le centre, un amalgame de trente mille hommes, femmes et enfants, qui étaient venus là, sincèrement, avec les boucliers et les casques, pour entendre l'attaque et la riposte.
Les arguments du dernier agresseur, pour n'être cousus que de fil blanc, venaient d'ébranler la conviction de la foule, visiblement.
Elle croyait moins, à présent, aux dires de son journal favori, au récit extraordinaire de son rédacteur.
Pour les deux tiers de tout ce peuple, je commençais à n'être plus que le fou représenté par la médisance jalouse du concurrent, dans son numéro de la veille et aussi dans celui du jour, où j'étais criblé de nouvelles railleries.
Je comprenais bien que cette affaire, devenue par l'énorme publicité que nous lui avions faite, une affaire d'État, vacillait sur sa base, et que si par malheur une nouvelle charge à fond de train succédait à ces divers assauts, tout espoir de réussir s'évanouirait.
Le moment décisif était venu pour moi de sauter sur l'estrade et d'y demander la parole.
J'y sautai, le bras droit en avant, l'index fatal tendu vers le président.
Le bureau tout entier me regardait comme un gêneur
— Descendez! — Vous n'êtes pas inscrit. — D'où sort celui-là? — Qui êtes-vous?
— Je suis, répondis-je au président qui cherchait à m'escamoter, je suis l'homme qu'on vient de traîner dans la boue, celui qui a passé vingt-six heures dans les airs avec Jim Keog!
Il y eut une poussée violente de curiosité.
Puis, comme les premiers auditeurs, mis au courant, avaient vite passé le mot aux suivants, on cria de la foule:
— Il est là!
— C'est celui qui discute sur l'estrade!
— Parlez! Parlez!
Il y eut dans l'assistance une explosion de sentiments divers. Un instant je crus que les revolvers allaient partir. On échangea des horions. Finalement je fus autorisé à présenter ma défense. Il n'était que temps.
J'eus un petit frisson quand je m'approchai de l'amplificateur.
L'énorme appareil me médusa trois secondes lorsqu'il transmit au loin mes premiers mots Mesdames et messieurs...
Mais bientôt je repris toute mon assurance. Mon plaidoyer partait du coeur. Je sentis bientôt qu'il me ramenait le peuple un instant égaré par la malignité des jaloux.
Je refis, en somme, mon article de la veille, et chaque période de mon discours improvisé commençait à provoquer des tonnerres d'applaudissements, soulignés, sur la gauche, par le silence du groupe embrigadé par le confrère, lorsque je vis tout à coup les têtes se lever en l'air.
C'était derrière mon dos, au-dessus du dôme doré des Invalides, qu'il se passait quelque chose.
La foule poussa bientôt des cris tels que je dus m'interrompre.
Le bureau s'était levé pour regarder aussi. J'en fis autant.
Quel ne fut pas mon ahurissement, et pour dire le vrai mot, à ce moment-là, ma joie, mon orgueil d'homme indignement calomnié, lorsque j'aperçus, dans l'azur, un point noir qui s'avançait sur l'Esplanade des Invalides, comme le Sirius à Koenigsdorf.
J'eus tôt fait de comprendre.
C'était bien le Sirius qui, dans un rush terrible, venait offrir aux Parisiens un échantillon de sa mobilité.
Jim Keog, renseigné, s'était dit que le meilleur moyen de convaincre les foules, c'était encore de les terrifier.
Et sur cette masse de peuple qui en poussant des cris d'effroi s'était jetée contre terre, ses boucliers sur le dos, la Tortue Noire fonçait avec la rapidité d'une comète.
Quel moment! Quel spectacle! Ceux qui osèrent lever la tête virent la bête noire — leur bête noire, c'était bien le mot — qui fendait l'espace à toute allure, à cent mètres au-dessus de l'esplanade.
On distinguait nettement le ventre du bizarre engin. J'aperçus les yeux de la nacelle, ces trous pratiqués dans l'acier par Keog pour regarder la terre, pour lancer son obus à mitraille et ses «marrons somnifères».
Le misérable! Dire qu'il m'avait tenu la main deux jours avant, pour me faire assassiner, de là-haut, tant de braves gens, et que je me trouvais, par l'enchaînement des circonstances, presque fier de le voir passer au-dessus de nous en plein Paris, inoffensif cette fois — J'étais sûr de sa parole, pour de bonnes raisons!
L'aéroplane inexplicable et inexpliqué — c'était ainsi que l'An 3000, pour faire de l'esprit, désignait le Sirius dans ses philippiques — s'en fut du dôme des Invalides au pont Alexandre III sans dévier d'une ligne, en lançant deux ou trois de ses éclairs singuliers.
Arrivé entre les deux Palais qui décorent les Champs-Elysées depuis l'Exposition Universelle de 1900, il fit à gauche, à droite, et finalement bondit vers les plaines éthérées où bientôt les meilleurs yeux renoncèrent à le poursuivre... L'apparition n'avait pas duré deux minutes.
— Il est parti, il est parti! criait-on autour de moi.
L'admiration qu'on ressentait pour l'agile aérocar se doublait d'une constatation: il n'avait en passant rien détérioré.
Je crus qu'il était bon de saisir l'instant propice, et d'achever la déroute de mes contradicteurs.
Je m'élançai sur l'estrade où le bureau reprenait ses places, assez penaud, pour crier à la foule:
— Un hasard vraiment extraordinaire, que je bénis, mesdames et messieurs, vient d'apporter à ma protestation quelque chose de mieux, en fait d'appui, que tous les discours du monde. Le roi des airs, Jim Keog, l'homme que la France peut acheter demain, avec son invention, pour vingt millions de francs, a su que son existence même était mise en doute par un parti sans nom, dont je ne veux pas caractériser l'attitude en cette circonstance. (Bravos prolongés de toutes parts.) Il s'est dit qu'en se montrant il convaincrait peut-être les pires incrédules — je dis peut-être, car on ne sait jamais avec ces messieurs — de ce fait patent qu'il existe. Vous avez vu qu'il vole à miracle dans le ciel, et que rien de tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre aérotactique ne peut être comparé à son énigmatique Sirius. (Bravos frénétiques.) Après cette démonstration inopinée, dont le succès a été foudroyant, si j'en juge par le nombre d'entre vous qu'il a précipités la face contre terre (Rires et applaudissements), je n'ai plus à parler... (Si! si! un vote final!) Je veux dire; je n'ai plus qu'à vous demander de transformer ce meeting, qui devait être d'indignation, en un meeting d'approbation! (Bravos répétés sur toute l'étendue de l'esplanade. Le clan des organisateurs, voyant la partie perdue, déménage à la muette, et le bureau, derrière mon dos, fait de même.) je vous propose donc de voter par acclamations l'ordre du jour que voici... (Oui! oui!):

— Voyez tous le Sirius et Jim Keog, le roi des airs,
l'homme que la France peut acheter demain, avec son
invention, pour vingt millions de francs. (Page 158).
Pigeon avait rédigé en hâte un papier. Il me le passa et je lus:
«L'assistance,
«Pénétrée de la supériorité du modèle Sirius, que son inventeur a eu la bonne idée de faire évoluer sur Paris pendant la réunion, sans en profiter pour causer à la capitale aucun dommage,
«Approuve hautement la proposition de l'An 2000, la recommande aux pouvoirs publics de toutes les forces de son patriotisme, et compte que, dans les courts délais impartis, la trouvaille magnifique de Jim Keog deviendra la propriété de la France, au prix de vingt millions que l'inventeur lui-même a fixé. (Tonnerre d'applaudissements.)
Enfin! c'était le triomphe! Je criai dans l'amplificateur:
— Que ceux qui sont d'avis de voter cet ordre du jour lèvent la main!
Toutes les mains se levèrent. C'était prestigieux, magnifique!
Je continua:
— Baissez les mains! L'avis contraire! Que ceux qui sont d'un avis contraire.
— Personne! Personne! vociférèrent cinquante mille bouches.
Et des cris d'enthousiasme s'élevèrent, pour se prolonger pendant des minutes.
— Vive l'An 2000! À bas les jaloux! Conspuez les antipatriotes! Vive l'An 2000!
Un remous indescriptible se fit de tous les côtés. Des automobiles, par centaines, débouchaient des rues adjacentes, lancées des points les plus éloignés de Paris à la poursuite de la Tortue Noire, qu'on avait aperçue de partout.
Les nouveaux venus s'informaient, criaient à leur tour, répétaient cent fois de chaleureux vivats. La partie était gagnée de haute lutte.
Il ne nous restait plus qu'à sortir de cette fourmilière humaine avant qu'elle ne commît quelque faute. Aussi modérai-je de la main les propositions fanatiques du lutteur et de ses camaraux, prêts aux plus bruyantes démonstrations en faveur d'un journal où l'on rémunérait si largement l'enthousiasme, à caisse ouverte.
Mais Napoléon veillait. Tenu minute par minute au courant des incidents qui se succédaient autour de nous, il avait tôt pris un parti.

En saluant la foule qui nous acclamait, je gravis
avec une lenteur calculée l'échelle de l'Austral.
Quelques aérocars de l'armée auxiliaire apparaissaient dans le ciel.
L'un d'eux, venant du Nord, nous adressa des appels chaleureux à l'aide de sa sirène. Un pavillon blanc barré d'une croix de Saint-André bleue et rouge, nous indiqua vite que c'était l'Austral.
Des milliers de prospectus descendirent d'abord sur la foule, célébrant les mérites de l'An 2000, énumérant ses succès, les tirages fabuleux auxquels il atteignait depuis le commencement de la guerre et le prix de ses abonnements. C'était un peu «zim boum boum,» mais je connaissais le travers de M. Martin du Bois.
Je distinguai notre directeur à bord dès que le ballon stoppa au-dessus de nos têtes. Morel cria très fort l'invitation au peuple de saisir les guideropes et d'autres amarres de sûreté qui pendaient au-dessous du poste.
Docilement l'Austral fut amené à dix mètres au-dessus du sol. On me lança l'échelle. Je la gravis avec une lenteur calculée, en saluant tout ce monde qui nous acclamait, tandis que Pigeon et Coquet surveillaient, à terre, le bon ordre de la manoeuvre.
— Lâchez tout, cria Morel.
Et majestueusement, l'Austral nous emporta vers le boulevard Haussmann, aux cris assourdissants de la foule en délire.
C'était beau, beau, beau.
A peine si j'avais pris place dans le fauteuil et envoyé un bonjour au brave Morel, que M. Martin du Bois me prit la main, ravi.
— Saperlipopette, fit-il, quelle victoire! Nous tenons le bon bout. Vous allez voir les indécis nous revenir en vitesse.
Il disait vrai. Nous étions à peine entrés dans son cabinet que le mégaphone nous mettait en présence de l'aimable figure de M. Lirondel, le secrétaire général de l'Elysée, homme adorné d'une belle barbe blonde et de cheveux frisés à la Titus.
Il ne dit que peu de mots, mais ces mots valaient de longues phrases:
— Messieurs, le Président de la République vous recevra ce soir même, à 6 heures.
A cinq heures et demie je descendais l'escalier du journal en compagnie de mon directeur. Nos redingotes et nos tuyaux de poêle, vestiges assez ridicules d'un passé disparu, indiquaient que nous allions à un rendez-vous de cérémonie.
Quand le cab électrique qui nous emmenait s'arrêta devant l'Elysée, le chef des gardiens du Palais ordonna au conducteur de pénétrer dans la cour, ce qui ne se fait que pour les ambassadeurs.
— Matin, murmura Napoléon, le père Dupont-Durand nous gâte. Hier il nous eût laissés au long du trottoir.
M. Dupont-Durand, treizième Président de la République depuis 1870, occupait, avant d'entrer dans la politique, les fonctions modestes de professeur d'espéranto à la Faculté de Douai.
Le succès ne l'avait point grisé. Il était d'humeur plutôt joviale.
Je m'en aperçus à la façon souriante dont il nous fit asseoir, dès que l'officier de service nous eut introduits dans son cabinet.
Assez grand, avec de belles moustaches et une barbiche poivre et sel comme les généraux de jadis, le président me fit, de visu, l'excellente impression que j'avais ressentie devant ses portraits.
Son consulat commençait à peine, et sans aucun doute cette guerre inattendue l'assombrissait.
Néanmoins, il nous parla sur un ton presque enjoué de l'occasion qui se présentait à la France d'acheter l'invention de Jim Keog.
Il avait lu l'An 2000; il était au courant du meeting et de l'incident énorme qui l'avait signalé; il savait tout.
M. Martin du Bois exposa donc notre requête avec brièveté. Je la complétai par quelques paroles émues qui m'attirèrent de chaleureux compliments.
Je crus, ma foi, que tout irait comme sur des roulettes.

— Votre Américain, messieurs, croit que je suis
un président comme le sien. Grave erreur! Vous le
savez, je suis un prisonnier de la Constitution.
— Hélas, nous dit alors le président, subitement contristé, mon opinion personnelle, si favorable qu'elle soit à votre projet, messieurs, ne pèse pas lourd dans la balance. Votre Américain croit que je suis un président comme le sien, armé de quelque initiative. Grave erreur! Vous voyez en moi, ainsi que le disait tristement l'un de mes prédécesseurs, le prisonnier de la Constitution. Je ne peux rien pour votre affaire. Il faudrait d'abord voir Thomas, mon ami Thomas, le président du Conseil des Ministres... Mais je puis vous promettre de lui en parler. Je lui en parlerai, et chaleureusement, vous pouvez y compter.
L'audience prenait fin, c'était clair, sur ces paroles décevantes. Nous nous retirâmes après quelques phrases de politesse.
— Rien de fait, dis-je avec humeur quand nous fûmes dans le cab. Et les jours passent! Que de temps perdu!
Napoléon restait songeur. Les événements lui paraissaient tels, néanmoins, qu'il ne doutait plus de la réussite.
— On mettra les bouchées doubles, dit-il en m'offrant un cigare. Je verrai Thomas dès ce soir. Et je suis archi-sûr, à présent, que nous aboutirons. Mais quel pays que le nôtre, n'est-ce pas, pour la succession des formalités à remplir, des portes à ouvrir, des ronds-de-cuir à secouer. Quel pays! Quel pays!
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.